
« Une femme est une femme » de Jean-Luc Godard : Scène de ménage entre son et image
Analyse d'une scène de ménage faite leçon de cinéma par Jean-Luc Godard dans « Une femme est une femme », l’un des films emblématiques de la Nouvelle Vague : 4 minutes 30 de variations entre ce qui est dit, entendu et montré pour autant de décalages pédagogiques et comiques.
Une femme est une femme (Jean-Luc Godard, 1961)
Troisième long-métrage de Godard, Une femme est une femme (1961) est l’un des films emblématiques, quoique généralement classé comme mineur, de la Nouvelle Vague. Dans ce film où le couple formé par Émile et Angela (interprétés par Jean-Claude Brialy et Anna Karina) ne cesse de se chamailler, laissant de ce fait la voie ouverte à un troisième personnage, Alfred Lubitsch (Jean-Paul Belmondo), amoureux d’Angela, une scène de ménage entre les deux premiers reste particulièrement mémorable. Montrant la mésentente entre les deux protagonistes, cette scène, longue de quelque 4 minutes 30 sur un film de 84 minutes, propose un ensemble de variations sur les rapports entre entendu et montré, entre dit et entendu, entre dit et montré, entre dit et tu. Le décalage que le film opère dans ces relations génère l’effet comique de la scène, en même temps qu’il offre une expérience de cinéma déroutante pour le spectateur d’aujourd’hui comme pour celui d’hier.
Le début de la scène montre Angela assise frappant régulièrement et bruyamment la table de bois avec une paire de ciseaux. Si l’image vue coïncide avec le son entendu, elle le dénonce dans le même temps comme inutile, puisqu’elle montre Angela occupée à rien, n’ayant d’autre but que de manifester son agacement et énerver Émile. Au même moment, un autre son, acousmatique celui-ci, se fait également entendre : celui d’un rasoir électrique. On imagine Émile, hors-champ, occupé à se raser. Or le plan suivant montre le personnage masculin, encadré par la porte de la salle de bains, imitant le son du rasoir en se contemplant dans le miroir. L’entrée d’Émile dans le champ détrompe donc sur la nature du son qu’il produit. L’homme n’est pas pris dans une activité ordinaire de la vie quotidienne, mais à l’instar d’Angela, il n’a d’autre activité que de faire du bruit, produire du son pour agacer sa partenaire.

Dans la suite de la scène, les deux personnages apparaissent dans le même plan, pour la première fois, et engagent le dialogue – autre première dans cette scène. Rassemblés par l’image, ils explorent une autre forme de discordance par le son, puisque leur échange – un dialogue cette fois – tourne à la dispute. C’est d’abord Angela qui demande à Émile s’il préfère qu’elle porte un pyjama ou une chemise de nuit ; Émile ayant répondu le pyjama, elle opte pour la chemise de nuit parce que « c’est plus commode ». Après cela, Émile s'énerve sur sa partenaire parce qu’elle a laissé le savon ramollir. Le ton monte et Émile continue à exposer ses reproches à sa compagne, mais il se brosse les dents en même temps : on le voit et l’entend parler, mais ses mots sont incompréhensibles. Il n’extrait sa brosse à dents de sa bouche que pour conclure : « Tu es d’accord, Angela ? » – ce à quoi celle-ci répond brosse à dents en bouche, imitant ostensiblement l’attitude d’Émile. Ce dialogue marque une évolution nette dans la scène. Au début, les deux personnages se tenaient à l’écart l’un de l’autre, et tout en prétendant ignorer leur partenaire, chacun s’attachait à produire des bruits qui envahissent l’espace de l’autre pour lui signifier son hostilité. Avec l’épisode des brosses à dents, Émile et Angela sont réunis dans le même espace physique et sont censés discuter, mais les mots qu’ils s’échangent deviennent des bruits audibles mais incompréhensibles. Du « je ne te parle pas mais je communique avec toi quand même » qui ouvrait la scène, on passe ici à une sorte de « je te parle, mais je ne communique pas avec toi ».
L’escalade se poursuit avec une réplique que les personnages reprennent tour à tour, avec quelques variantes. « Je ne te parle plus », dit Émile. « Moi aussi, je ne te parle plus », lui répond Angela. « On s’parle plus ? », demande alors Émile. « Non, on ne se parle plus », confirme Angela. Les paroles, répétées, sont cette fois destinées à être parfaitement compréhensibles par l’autre, mais elles visent à nouveau à interrompre la discussion. On ne parle plus pour ne rien se dire, on se parle pour se dire qu’on ne se parle pas (ou plus). Au paradoxe du langage répond le paradoxe de la situation : les personnages tombent tous les deux d’accord sur leur désaccord et n’ont jamais semblé aussi unis. C’est en effet le moment du coucher et, réunis dans le lit, Émile et Angela exécutent les gestes de préparation (repousser la couverture, se frotter les pieds, s’allonger) à l’unisson, selon une chorégraphie bien huilée – celle d’un couple vivant ensemble depuis un certain temps déjà.
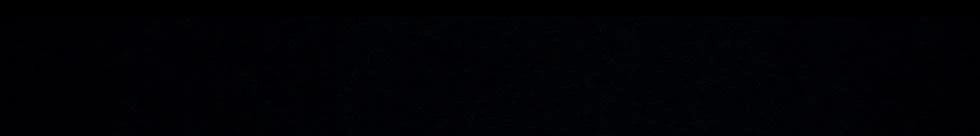
Malgré son affirmation précédente, Angela parle à Émile dès la lumière éteinte : « J’ai froid au derrière », dit-elle plusieurs fois. Elle tente, d’une certaine manière, de renouer le dialogue avec son compagnon : cette fois, elle lui reparle réellement, même si on ne sait pas très bien ce qu’elle attend de lui. Bien qu’Émile lui parle lui aussi, il ne répond pas à son interpellation, puisqu’il se borne à demander à Angela de se taire (« Dors », avant de l’interrompre d’un définitif : « On a dit qu’on s’parlait plus »). Pendant cet échange, les deux personnages sont dans le noir, invisibles l’un à l’autre aussi bien qu’au spectateur. L’image suit donc elle aussi une évolution, passant d’un seul personnage dans le cadre (Angela puis Émile) au couple, pour finir sur les deux personnages invisibles alors même qu’ils se trouvent tous deux dans le cadre. Rassemblés (et invisibles) dans l’image, l’homme et la femme sont une nouvelle fois séparés par le son, puisque les mots prononcés échouent encore à faire dialogue.
La dernière réplique d’Émile (« On a dit qu’on s’parlait plus ») conditionne la dernière partie de la scène, dans laquelle plus aucun mot ne sera prononcé. Ce qui ne signifie pourtant ni le silence, ni l’absence d’échange verbal. La scène est en effet saturée de sons acousmatiques. La musique off (signée par Michel Legrand), qui a démarré dès que le couple se dirige vers le lit, retentit avec force. On entend également un orage – tonnerre et pluie – sans qu’il soit possible de dire s’il est hors-champ ou off.(1) Que ce soit l’un ou l’autre, il vient souligner, de manière triviale, la discorde dans le couple. Il y a de l’orage dans l’air. Émile et Angela, quant à eux, ne se parleront plus, dans le sens où ils ne prononceront plus un seul son, mais ils ne vont cesser de dialoguer par livres interposés : ils vont s’adresser l’un à l’autre des titres d’ouvrages comme autant d’insultes. L’expression « Je ne te parle plus » est ainsi ici prise littéralement et détournée de manière ludique, comme l’ont été, plus tôt dans le film, « Laisse tomber » (Émile s’adresse à Angela, et dans le plan suivant celle-ci laisse accidentellement tomber les œufs qu’elle tenait) et « Qu’elle aille se faire cuire un œuf » (les mots sont encore d’Émile, et ils appellent le plan suivant, dans lequel on voit Angela cassant des œufs dans une poêle).

C’est Angela qui rallume la lumière et la première, recourt au livre pour insulter son partenaire sans prononcer un son (« Monstre »). La répartition des rôles demeure donc inchangée : Émile parle et Angela exécute littéralement sa demande, tout en s’en jouant. Cette dispute livresque rappelle l’usage des cartons des premiers temps du cinéma, qui donnaient à lire au spectateur les parties essentielles de dialogues qu’il ne pouvait forcément pas entendre, les films étant muets. Dans le cas d’Une femme est une femme toutefois, les « cartons » apparaissent au niveau de la diégèse. S’agissant d’un film sonore, ce n’est pas en raison d’une limite technique que le spectateur n’entend aucun dialogue, mais bien parce que les personnages ne se parlent plus et font silence. C’est donc d’abord à eux que les cartons (ou plutôt les couvertures de livres) s’adressent. Il est remarquable que par le recours à ce stratagème, le dialogue entre Angela et Émile se borne à un échange de mots insultants, sans construction grammaticale et avec les approximations qu’impose le choix limité aux ouvrages disponibles dans la bibliothèque (« momies péruviennes », par exemple). Cette épuration extrême du dialogue rappelle elle aussi le dispositif minimaliste des cartons du cinéma muet, qui « ne prétendaient pas mettre sur l’écran tout ce que les personnages prononçaient, traduire tout ce qu’on voyait être dit, seulement les mots essentiels. Il en résultait ce qu’on peut appeler un halo verbal non transcrit. »(2) Le rapprochement n’est toutefois que superficiel : si les cartons du muet indiquaient quelques mots pour laisser entendre tout un dialogue, les quelques mots écrits échangés dans le film de Godard soulignent au contraire le silence qui sépare les personnages et leur dialogue réduit à l’insulte.
L’appartenance des livres à la diégèse, par opposition aux cartons du muet, s’exhibe de manière récurrente. Cela se marque tout d’abord par la présence du corps d’Angela ou d’Émile dans le cadre en même temps que la couverture du livre : c’est a minima leur doigt qui indique le texte à lire, mais on voit aussi, dans certains cas, leurs visages. Par ailleurs, à l’inverse des cartons classiques, les mots que s’échangent les protagonistes viennent de couvertures de livres hétéroclites dont la matérialité et la singularité sont elles aussi particulièrement soulignées. Chaque insulte provient d’un livre différent, pris au hasard par l’un ou l’autre personnage dans la bibliothèque. Les formats de livres et les typographies disparates se succèdent ; certains mots inutiles au « dialogue » apparaissent à l’écran, comme le nom de l’auteur du livre ou l’éditeur, tandis qu’Émile ajoute au crayon les mots manquants (il sélectionne le livre Eva et ajoute « te faire foutre »).

Si les titres d’ouvrages permettent d’abord aux personnages de dialoguer sans se parler (c’est-à-dire sans prononcer un son), ils s’adressent aussi au spectateur. C’est, évidemment, le cas de tout (le) film, Une femme est une femme n’hésitant d’ailleurs pas à briser la convention de la séparation entre monde du film et spectateurs lorsque Karina et Brialy interrompent leur tirade pour saluer le public. Mais plus particulièrement, dans cette scène de ménage, certains livres surgissent dans l’axe optique de la caméra (c’est le cas de « Monstre », à la différence de « Filou ») – comme adressés, donc, directement au public de l’autre côté de l’écran. Le spectateur se trouve silencieusement insulté en même temps qu’Émile et Angela. Godard l’avait déjà insulté dans À bout de souffle de manière sonore cette fois, lorsque Belmondo s’adressait à lui avec la fameuse réplique : « Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre ». Cette tirade était prononcée regard caméra : un dispositif que reprend, de manière certes plus discrète, le positionnement de livres dans l’axe optique de la caméra. Les livres jouent alors un rôle extradiégétique, à l’instar des cartons qu’ils parodient.
En filmant cette scène de dispute entre les deux personnages principaux de son film, Godard a en fait surtout filmé une scène de ménage entre son et image, évidant le rapport naturaliste que le cinéma plus traditionnel installe entre eux pour explorer un vaste spectre de relations possibles.
Et la discorde entre deux amants devint leçon de cinéma.
Poursuivre l'analyse du cinéma de Godard…
Sébastien Barbion, « Pierrot le Fou (1965) : Matières littérales », dans Le Rayon Vert, 3 mai 2016.

Notes
