
Les Épiphanies : Tentative de ne pas faire un Top Cinéma 2023
Les épiphanies sont pour nous autant d'occasions de ne pas faire de top cinéma 2023 : ni hiérarchie, le moins de jugement de goût possible, que le passage d'affects quelque part entre les écrans de cinéma et les pensées et les corps des spectateurs.
Les Épiphanies ou l'art de ne pas faire un Top Cinéma 2023
Les épiphanies, ou comment ne pas faire un top cinéma 2023, marquent quelque chose qui a basculé à l’écran comme dans la perception. Elles consistent en un sauvetage d’affects. De diverses natures, il ne faudrait pas les exclure ou les taire comme on le fait habituellement au moment d’établir un top cinéma et de classer les films en fonction de canons esthétiques ou cinéphiliques, bien souvent déterminés sociologiquement, en expliquant rarement comment les films et les affects ont opéré et donné à penser. Mettre des mots sur nos affects revient ainsi à penser avec le cinéma mais aussi à panser avec lui, comme le disait Bernard Stiegler. C'est un exercice difficile mais au plus près de ce que notre position de spectateur traverse et conserve : un travail de passeur. Sauver ses affects s'oppose au dictat d'une ligne éditoriale mais aussi à toute forme de système. C'est pourquoi nos épiphanies peuvent s'emboîter comme se contredire. Bien entendu, c'est aussi lorsque les déterminismes et les attentes sont déjoués que faire un non top cinéma devient intéressant : les affects sont imprévisibles et à nous de les raconter le mieux possible.
Lire les épiphanies de...
Saad Chakali et Alexia Roux (Des Nouvelles du Front cinématographique)
Lire les épiphanies des années précédentes
Guillaume Richard
Comme chaque année au moment d'écrire mes épiphanies, l'inspiration manque. Les affects expérimentés, parfois intensément, laissent une trace de plus en plus lointaine tandis que pour certains films, les mots ne sont jamais venus malgré de multiples tentatives d'écriture. L'opération de sauvetage s'est effectuée tant bien que mal alors que de nombreuses séquences m'ont marqué. Je constate d'abord que j'ai plus de facilités à écrire sur les films détestés, ce qui est plutôt triste et en opposition avec ce qui anime au départ l'écriture au Rayon Vert. J'ai toujours été un iconoclaste doublé d'une sorte de Don Quichotte combattant dans le vide (l'insignifiance du cinéma belge, le réalisme psychologique et ses clichés, le film coup-de-poing, etc.) sans que cela ne constitue une ligne éditoriale même si les tentations sont grandes et que certains textes se recoupent inévitablement. Cette année, plus que les autres, j'ai ressenti le besoin de rester dans la marge. Si ce point était clair pour mes camarades depuis le début de notre aventure, je voulais, de mon côté, que la revue occupe le premier plan et soit bien implantée dans le milieu du cinéma belge et de la cinéphilie francophone. Si nous y sommes arrivés d'une certaine manière au vu des retours et des statistiques de fréquentation du site, cette réussite est toute relative tant notre travail n'a rien à voir avec ce que la critique pratique aujourd'hui. Plus que jamais, j'ai ressenti cette année le besoin de cultiver mes affects dans notre jardin loin de la place publique, dans l'ivresse de l'amitié et la joie toute personnelle de se sentir plus vivant encore grâce au cinéma. Notre jardin reste évidemment accessible à tous à condition de sortir des sentiers battus et de traverser quelques marécages.
Qui voudrait en effet occuper une échoppe sur la place du marché où on gueule à l'unisson que Steven Spielberg, le grand infantilisateur à l'ardoise lourde, est un génie ? Et côtoyer ceux pour qui il est la référence ultime, les bouffons du Youtube game coincés dans leur chambre d'adolescent ou même ceux, plus curieux, qui massacrent Godard sans la moindre gêne (Sir Oderable, Pamfiyt, Ju de Melon, Cinfiles,...) ? Le rire et l'indignation accompagnent aussi la lecture des éditos d'Adrien Corbeel, l'hilarant rédac' chef de Surimpressions qui semble définitivement moins intéressé par la qualité des textes de son magazine que par la possibilité d'en vivre (jusqu'à mendier à chaque édito parce que la culture les mérite !) et de faire de la publicité (14 sur 46 pages dans le numéro 9, par exemple). Pour Surimpressions, ce qui semble compter avant tout est de plaire au plus grand nombre et d'exister dans le petit monde du cinéma belge, peu importe comment tant que ça paye, et de trouver grâce aux yeux des distributeurs et des attaché(e)s de presse. Je rêvais de cela aussi au début du Rayon Vert avant d'y renoncer définitivement : je suis soulagé d'avoir abandonné cette grande vanité. Qui voudrait côtoyer l'usine à gaz Mehdi Omaïs, l'homme-sandwich de X, et son club, dont l'inénarrable Caroline Vié de 20 minutes, la journaliste ciné qui aime tous les films ? Je n'ai pas ouvert la Septième Obsession depuis longtemps, et ça ne manque pas. Et que dire encore de la décadence apparemment inarrêtable des Cahiers du cinéma sous Marcos Uzal, dont les éditos ronflants sont encore pires que ceux de Delorme ? Qu'il est bon de s'éloigner de tous ces gens pour retrouver l'essentiel : une culture des affects, l'amitié pratiquée au cœur d'un jardin partagé, la volonté de n'être contemporain de rien et de ne pas avoir son mot à dire sur ce qui fait débat.
Raconter ses épiphanies, faire son non-top 2023, c'est remettre les films à égalité au regard des affects plutôt que de faire un état des lieux de la vitalité du cinéma contemporain. Certes, j'ai écrit sur des problèmes qui selon moi gangrènent la production et la réception des films, mais sans pour autant les appuyer avec des discours (méta)critiques et des généralisations (et dont le running gag par excellence est « Comment se porte Hollywood ? ». Ma réponse : on s'en fout.) ou, pire encore, avec des éditos, une pratique que je déteste par-dessus toutes les manières de regarder le cinéma de haut (et n'importe quoi, d'ailleurs), soit à l'exact opposé de l'écriture que nous recherchons au Rayon Vert et qui ne fait jamais système. Il y aura toujours des images qui déjoueront nos savoirs et nos attentes, dans tous les films, toutes les filmographies, et surtout dans des films pas forcément aimés. Parfois ce n'est presque rien. Parfois aussi on semble être seul à aimer ces moments. Des petits quelques choses qui suffisent grandement. S'il y a du jugement dans les textes que j'ai écrits cette année, ma fidélité aux affects est mon seul mot d'ordre, la seule et unique position de spectateur que j'adopte quand je m'installe devant un film, en espérant de ne pas me laisser emporter par la colère.
Cette année aura été marquée par le retour au premier plan de deux cinéastes aimés depuis les premiers balbutiements de ma cinéphilie : Aki Kaurismäki et Víctor Erice. Leurs films, respectivement Les feuilles mortes et Fermer les yeux, ont offert l'antidote tant espéré, un refuge même, face à un cinéma moribond et à l'actualité politique d'une année noire. Kaurismäki évoque d'ailleurs le conflit ukrainien. Ce qui pourrait passer pour de l'engagement inoffensif constitue au contraire la marque d'un profond humanisme : Kaurismäki a toujours laissé une place aux victimes collatérales des guerres et de l'immigration, celles-ci intégrant ses tableaux des faubourgs où les laissés-pour-compte retrouvent leur dignité. C'est la grandeur de Kaurismäki qui, s'il faut encore le rappeler, en fait l'hériter de Chaplin — le chien de son film porte d'ailleurs son nom. L'humanisme des Feuilles mortes nous a aussi consolé de la médiocrité d'un cinéma d'auteur qui s'enfonce toujours plus dans ses travers (réalisme psychologique plat, film coup-de-poing, formalisme maniéré et aride, misanthropie déguisée, etc.). Il faudrait lister les films plébiscités mais détestés : Sur l'Adamant, Le Barrage, The Old Oak, etc. Le titre du film d'Aki Kaurismäki pouvait annoncer de la tristesse mais, comme toujours chez lui, c'est tout le contraire qui se produit. Quand l'automne arrive dans Les feuilles mortes, et que celles-ci tombent des arbres, Ansa et Holappa vont réussir à trouver le moyen de s'aimer après plusieurs mésententes. La tristesse ne dure jamais bien longtemps chez Kaurismäki, tout comme les couleurs ne sont jamais ternes, et le recours furtif à quelques plans automnaux est détourné de son sens initial pour rendre vain ce qui aurait pu pousser les personnages dans la morosité. Le génie de Kaurismäki réside aussi dans cet équilibre trouvé entre les tonalités sans jamais sacrifier la dignité des personnages. Autre antidote : Fermer les yeux, dont la magnifique fin m'a longtemps hanté au point de vouloir écrire un texte qui n'aura jamais vu le jour, un texte-fantôme à l'image du film-fantôme auquel participe Julio Arenas avant de disparaître. Le plan où l'acteur ferme les yeux devant l'écran reviendra un jour, c'est certain. Plus généralement, retrouver l'élégance et la grandeur du cinéma de Víctor Erice suffisait à constituer un événement esthétique à part entière.
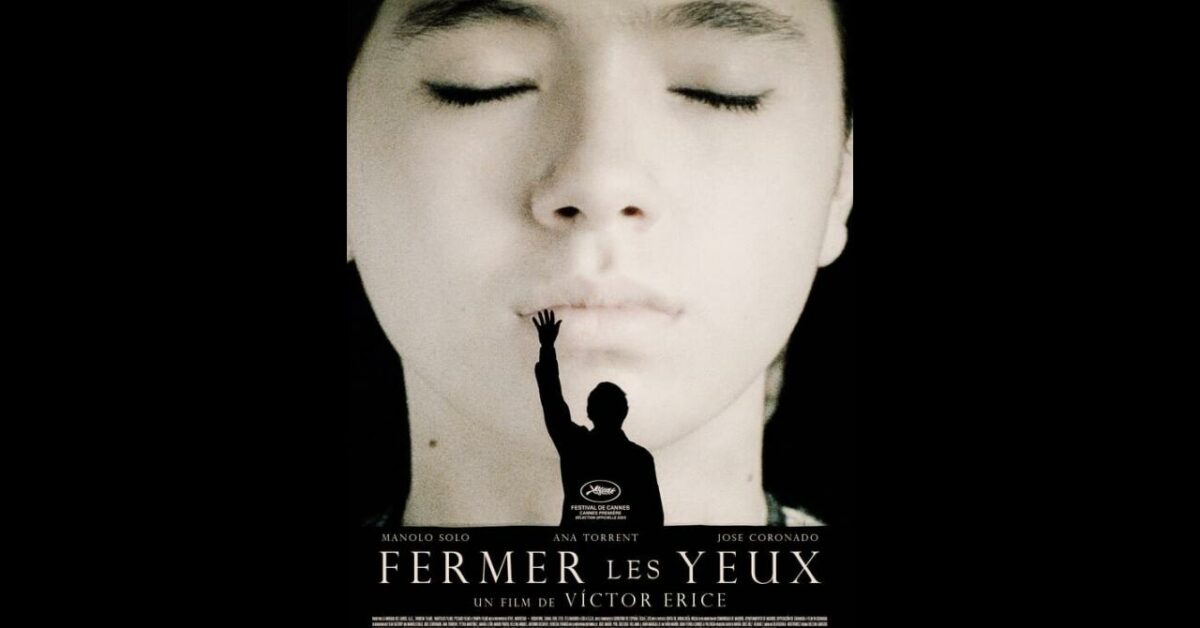
Showing Up de Kelly Reichardt tient aussi dans son travail sur les détails. Le pigeon recueilli au début et libéré pendant le vernissage final porte le secret caché du film : celui de l'amitié entre Lizzy et Jo (une de plus chez Kelly Reichardt), ternie par les aléas de la vie, qui va peut-être pouvoir prendre un nouveau départ. La cinéaste, comme toujours d'une grande délicatesse, ne prémâche jamais le travail du spectateur. Aucun mot ni image en trop pour nous divulguer que le cœur du film est son histoire d'amitié. Les trajectoires de Lizzy et Jo s'effleurent en laissant une place hors-champ et ses non-dits, avant se rejoindre dans le plan final. J'ai été lent à la détente en ne voyant rien venir, ce qui a rendu le rayon vert plus lumineux encore.
Si on en croit tout ce qui a été écrit à propos de Perfect days, Hirayama (Koji Yakusho) vivrait une vie simple et heureuse à la recherche du beau comme du bien, avec un côté un peu réactionnaire par rapport à l'évolution de la société. Le synopsis précise qu'il se « satisfait d'une vie simple où, en dehors de sa routine quotidienne très structurée, il s'adonne à sa passion pour la musique et les livres. Son passé va ressurgir au gré de rencontres inattendues ». Hirayama ne vit-il pas d'abord contre quelque chose ? Ne fuit-il pas, dans ses journées monotones, ce qui se dissimule dans ses nuits, lui qui rêve ou cauchemarde en noir et blanc et qui est visité par d'étranges figures semblant raviver des événements lointains ? Qui pourrait vivre dans une forme de solipsisme en retrait du monde sans jamais céder à une tentation ? Hirayama y arrive comme il peut parce qu'il sait ce qu'il y a dans le dehors qu'il fuit. Mais Perfect days raconte comment son quotidien varie sensiblement, sur une période de deux semaines, et laisse entrer ce qu'il avait déplacé dans ses marges. Hirayama, aspiré par cette altérité, est tenté de replonger. Il parviendra à résister pour reprendre sa routine, mais celle-ci est bien plus fragile qu'elle n'y paraît, comme pour n'importe qui, au fond, car tout ascétisme a ses limites et sa cartographie composée de territoires plus mouvants et opaques. Au fond, j'aime peut-être le film de Wenders uniquement pour tout ce qui s'y joue dans l'ombre.
Avec Asteroïd City, Wes Anderson fait aussi le pari de la contemplation. Ses détracteurs diront qu'il se morfond dans une forme de (im)posture, en proposant, comme me le disait Saad Chakali, des slides dignes d'un powerpoint exposé dans une réunion de travail. Wes Anderson prend ici le temps de filmer un petit monde à l'arrêt dont l'activité principale est de regarder, du plus près (la fenêtre d'une maisonnette) au plus lointain (une bombe qui explose ou le ciel). À la fin du film, les derniers personnages qui n'ont pas encore quitté la quarantaine se retrouvent dans le diner désertique et, étrangement, quelque chose fonctionne, comme si le sens de cette parenthèse enchantée révélait sa profondeur, sans pour autant arriver à produire le même effet que celle racontée par The Holdovers d'Alexander Payne. Comme il est question partout du regard, Asteroïd City réussit même à faire éclore son propre rayon vert. Révélée par les résidents en quarantaine observant ensemble les étoiles à travers une boîte en carton, une lumière verte apparaît dans le ciel. Il s'agit en réalité d'un vaisseau spatial qui va descendre dans la petite ville et duquel un alien animé filiforme s'extrait pour venir récupérer le petit astéroïde au milieu de l'assemblée. La séquence, baignée dans une lumière verte constante, témoigne, dans une sorte de rayonnement, du grand cœur du cinéma de Wes Anderson, sa bonté et son innocence.
Anatomie d'une chute, au-delà son impressionnante maîtrise formelle et des polémiques diverses qui ont animé de stupides débats politico-médiatiques, tire sa force de tout le contraire, à savoir une histoire de voyance et de croyance qui met en crise toute forme de contrôle et de discours réifiants. Cette histoire se joue entre un enfant aveugle et presque mutique qui questionne son amour maternel, mais aussi avec un chien et une flaque de vomi. C'est cette profonde indécision, cette faille irréductible, ces taches rouges sur la neige et de vomi dans une chambre, qui marquent encore durablement aujourd'hui. L'esthétisation de ces fluides par Justine Triet ridiculise tous les films putassiers urologico-scatologiques qui les utilisent comme le symptôme d'un misérabilisme épuisant.
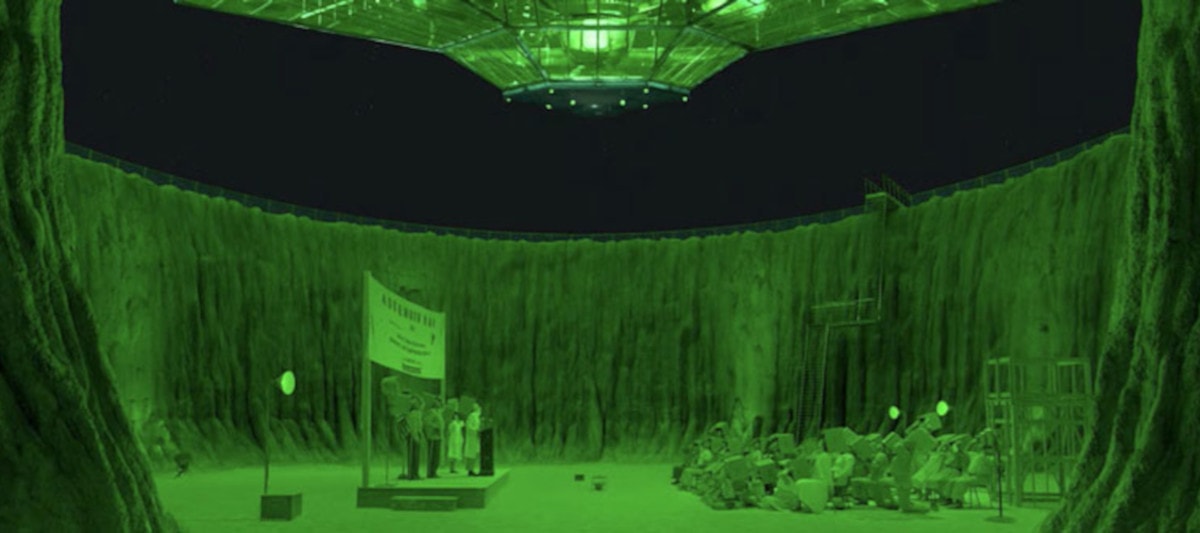
Des corps auront également mis en crise leurs récits et les clichés qu'ils auraient pu véhiculer. Raphaël Quenard fait imploser une certaine forme de représentation de la banlieue dans Chien de la casse de Jean-Baptiste Durand. Son érudition et sa prolixité donnent à voir autrement la jeunesse des villages de province généralement filmée à travers un arsenal naturaliste. On se plaît à suivre le trio du film graviter entre la norme et les marges, jusqu'à un très beau final qui remet tout à plat. Le plus beau déplacement d'un corps vu cette année s'est produit dans La romancière, le film et le heureux hasard de Hong Sang-soo. À la fin, on découvre le film dans le film, tourné en couleur, qui est composé de quelques plans de Kim Min-hee accompagné d'une voix off disant simplement "je t'aime", comme si Hong Sang-soo s'adressait directement à la femme qu'il aime. Cette séquence contraste avec le reste du film et la neutralité avec laquelle l'actrice était filmée jusque là. Quelque chose comme une transsubstantiation, un changement d'état d'âme et de corps, s'opère alors, et la femme reprend le dessus sur l'actrice en changeant complètement le régime perceptif du film. Il y a aussi bien sûr Voyages en Italie de Sophie Letourneur, mais je n'ai pas les mots. Citons encore un film pas aimé mais dans lequel il se passe quelque chose : How to Have Sex de Molly Manning Walker. La cinéaste revisite le conte de fée, en particulier celui de La belle au bois dormant, à travers une histoire de consentement et de viol dans laquelle Tara, notamment par les vêtements qu'elle porte (jusqu'à une capuche à la fin du film), est une sorte de princesse déchue et salie qui voulait être réveillée par le prince charmant.
Enfin, de nombreux films m'auront emmené dans des mondes nouveaux et étranges, et c'est toujours réjouissant de se laisser porter par ce type d'expérience même s'il y a parfois pas grand chose derrière. Ari Aster, dans Beau is afraid, offre l'aventure la plus généreuse et insolite de l'année, certes atténuée par sa portée symbolique, mais le voyage en vaut la peine. Même sentiment pour Dream Scenario de Kristoffer Borgli, produit justement par Ari Aster (et ce n'est pas un hasard), qui nous faire pénétrer dans l'inconscient collectif d'une ville qui rêve puis cauchemarde du personnage incarné par Nicolas Cage. Accepter de se retrouver sans explication sur un terrain vague en banlieue parisienne avec Ramsès, le faux voyant de Goutte d'or de Clément Cogitore, et accompagner le trouble dans ses croyances et son mode de perception, valait aussi le détour, surtout lorsque le film repose sur ce basculement au départ imprévisible. Enfin, citons encore l'immersion délirante et satirique dans Rotting in the Sun de Sebastián Silva où on suit le quotidien du cinéaste, qui joue son propre rôle, et de toute une série de mésaventures qui revitalise le cinéma d'immersion généralement bien putassier.
Classer ce qui vient d'être sauvé tant bien que mal dans un Top 2023 n'a donc aucun sens. Citons encore, pour ne pas clôturer, les films aimés dont j'ai tout oublié, et cela même si un texte existe : L'envol de Pietro Marcello, How to Blow Up a Pipeline de Daniel Goldhaber, Emily de Frances O'Connor, De nos jours de Hong Sang-soo, Tengo sueños eléctricos de Valentina Maurel, Eternal Daughter de Joanna Hogg, All the Beauty and the Bloodshed de Laura Poitras, Suzume de Makoto Shinkai, La Tour de Guillaume Nicloux, Mon pays imaginaire de Patricio Guzmán et Babylon de Damien Chazelle.
Une année de cinéma, ce sont aussi des histoires de spectateur, qu'il ne faudrait pas non plus taire. Car le cinéma nous permet aussi de créer des souvenirs. C'est la première fois que j'allais à la Mostra de Venise, dont je garderai le trajet en vaporetto entre la ville et le lido, au coucher du soleil, comme un moment hors du temps. Il y a eu aussi cette projection intimiste de Apolonia, Apolonia de Lea Gblob à CinéFlagey où je n'avais pas été depuis longtemps, à tort. La découverte de Past Lives et Emily avec ma mère, deux des rares visionnages à la maison dont nous garderons une trace, contrairement à la redécouverte de l'horrible Polisse de Maïwenn. Revoir tout Kaurismäki dans la foulée des Feuilles mortes a d'abord été ce genre d'expérience qui nous fait ressentir notre humanité. Dire adieu aux personnages de de la série Sex Education qui s'est terminée en automne. Il y a encore eu une journée au FIFF où nous avons effleuré Amin de Mektoub My Love. Et nos virées à Lille avec Thibaut et Jessica pour voir les films qui ne sortent pas en Belgique. Sans oublier mon séjour parisien chez les amis Saad & Alexia, avec la projection de Yannick, avant de remettre le couvert à Bruxelles quelques semaines plus tard.
Retour à la liste des épiphanies
Thibaut Gregoire
Une fois n’est pas coutume, pour ces épiphanies, je voudrais parler de la manière dont les films ont été vus, reçus, et aussi du nombre de fois qu’ils l'auront été. Car, cette année, la plupart des films qui m’ont marqué auront été vus au moins à deux reprises, ce qui m’aura permis de me rendre compte de l’évidence : un film n’est jamais aimé de la même manière, avec la même intensité, selon ses différentes visions.
1.
Parmi mes quinze films « préférés » de l’année, trois n’auront été vus qu’une seule fois. Et si ces trois films persistent quand il s’agit de dresser le bilan, c’est pour des raisons très différentes. Dans le cas du film de Hong Sang-soo, De nos jours, nul doute que c’est l’attachement très fort qui me lie à cet auteur qui l’a fait se maintenir à flot et continuer de me hanter plusieurs mois après sa vision, notamment par l’intermédiaire de sa très belle scène de « climax » - mais y a t’il vraiment des climax dans le cinéma de Hong Sang-soo ? - lors de laquelle les trois personnages principaux se livrent au débotté à une partie de pierre-papier-ciseaux. S’il fallait choisir les meilleures scènes de cette année cinéphile, celle-là serait certainement en belle position.
Autre film vu une seule fois : Le Gang des bois du temple de Rabah Ameur-Zaïmèche, que sa vision tardive, à quelques semaines seulement de tirer le rideau, a probablement favorisé. Il se peut qu’une deuxième vision amenuise mon lien au film. Mais ce qu’il m’en reste aujourd’hui, ce sont également des scènes, des scènes qui déjouent certaines attentes que la perspective d’un « banlieue-film » pouvait engendrer : la scène de l’enterrement qui ouvre littéralement le film, mais aussi la scène de braquage étonnamment fluide et rapide, et surtout les scènes de « restauration » entre amis, à la fois anodines et constituant probablement le véritable moteur du film.
Enfin, Et la fête continue ! de Robert Guédiguian m’a réconcilié avec ce cinéaste que je pensais définitivement passé du côté de la misanthropie et du pensum édifiant avec ses deux derniers films (Gloria Mundi et Twist à Bamako). Avec ce film-ci, il revient aux fondamentaux de ce qui fait sa singularité, cet engagement empreint de naïveté mais surtout d’un humanisme qu’il semblait avoir délaissé. La fin du film a été comme un soulagement, celui d’avoir retrouvé un auteur qui semblait s’être éloigné de mes radars.
2.
Parmi les films vus deux fois, certains ont attendu la seconde vision pour réellement me plaire, m’intéresser et m’impacter. Il s’agit notamment de Retour à Séoul de Davy Chou dont le caractère brut et opaque du personnage principal m’avait d’abord empêché d’entrer véritablement dans le film avant d’en être la porte d’entrée lors de la seconde vision, jusqu’à presque en devenir un point d’identification. Comme quoi, la manière dont on se voit soi-même peut changer radicalement en très peu de temps, et influer sur la manière dont on perçoit des films et/ou des personnages.
L’Envol de Pietro Marcello n’a également été véritablement aimé qu’à la seconde vision, et la « beauté » du film, sur un plan purement plastique et narratif, au premier degré, ne m’a frappé que devant un écran de télévision alors qu’elle m’était complètement passée à côté sur un écran de cinéma. Et au-delà, ce sont également les personnages, celui du poilu ébéniste Raphaël et celui de la jeune Juliette, sorcière/sirène à l’univers personnel singulier, qui entretiennent mon lien au film plusieurs semaines après sa vision.
Enfin, la richesse et le propos même d’Anatomie d’une chute de Justine Triet ne me sont apparus que lors d’une deuxième vision fort bienvenue. Il a fallu que j’aille le revoir en salle seul, pour n’avoir comme point de vue sur le film que le mien, et voir se déployer tout le discours sur la vérité, notamment par l’entremise du chien, sorte de passeur malgré lui, par lequel le dilemme du personnage de l’enfant se débloque, donnant lieu par la suite au plus beau monologue face caméra de l’année.
2 bis.
Si certains films vus deux fois n’ont pas eu autant d'impact sur moi lors de la seconde vision, il n’empêche que certains sont restés malgré tout importants au moment de faire le bilan de l’année. Ce fut le cas par exemple de Babylon et la démarche de chercheur d’or dans un déluge de crasse opéré par Damien Chazelle, tout comme celui de Showing Up de Kelly Reichardt, avec son final énigmatique, où la disparition d’un pigeon rapproche in extremis deux personnages que le film mettait jusque-là un point d’honneur à séparer. Et aussi celui de Chien de la casse de Jean-Baptiste Durand où, là encore, la disparition d’un animal est le vecteur d’une révélation pour les personnages et pour le spectateur.
D’autres films déjà considérablement aimés ont au contraire encore pris plus d’ampleur et d’importance à la deuxième vision. C’est le cas d’Asteroid City de Wes Anderson, dont les mots me manquent pourtant actuellement pour en parler. C’est aussi celui de Rotting in the Sun de Sebastian Silva, dont la première vision était surtout l’occasion d’être étonné et décontenancé par un film « surprise », sorti pour moi de nulle part, et auquel la deuxième vision est venue apporter de l’ancrage, toujours à travers ses scènes de « basculement » : une chute qui bouleverse le film dans son ensemble, ses personnages, et indirectement ses spectateurs, mais aussi un final où le monologue - dans une démarche contraire à celle d’Anatomie d’une chute - tire sa force de sa rapidité, de son manque de limpidité, et de sa répétition « dégénérée ». À y repenser, les liens entre le film de Justine Triet et celui de Sebastian Silva sont à creuser, et Rotting in the Sun à revoir encore.
Enfin, et surtout, le film qui a le plus « évolué » dans ma réception, est l’autre Hong Sang-soo de l’année, La Romancière, le film et le heureux hasard. Si ce que j’en gardais était principalement sa « révélation » finale, lors de laquelle Hong Sang-soo amenait de front la couleur et un dévoilement de sa propre intimité, pour donner sens au film et aux motivations de ses personnages, c’est plutôt sa théorie du hasard, et sa manière ludique d’en faire le sujet de son film, qui m’a totalement emporté lors la deuxième vision.
(Il me faut mentionner aussi Venez voir de Jonas Trueba, et La Montagne de Thomas Salvador, deux films vus pour la première fois en 2022 dans le cadre de festivals, et dont la revisite plus d’un an plus tard a permis de les ré-ancrer fortement dans leur année « officielle », sans que les mots - encore une fois, satanés mots ! - ne répondent présents pour en parler plus longuement ici.)

4.
Pas moins de quatre visions pour ce qui est « mon » film de l’année, sans conteste : Voyages en Italie de Sophie Letourneur. C’est probablement en évoquant ce film-ci que cette tentative de parler du nombre de visions des films aimés - tentative qui, a posteriori, au moment où l’écriture s’achève, paraît un peu vaine et forcée, je dois bien l’avouer - va enfin prendre du sens. Car les quatre visions de Voyages en Italie auront eu chacune une impulsion et une résonance particulière. La première avait un but « professionnel » dans le cadre d’une présélection et n’était qu’une porte d’entrée vers un film dont je savais déjà que j’allais le revoir au moins une autre fois, très vite. La seconde avait un but de partage, partager ce film aimé avec un proche. La troisième était de nouveau « professionnelle » mais teintée d’une envie plus personnelle, puisqu’elle précédait l’entrevue très attendue avec Sophie Letourneur. Enfin, la quatrième fois était tout simplement présidée par une envie de voir le film, seul, en dehors de toute pression ou obligation.
Et puis, le fait que ce soit mon rapport à ce film-là en particulier, que j’aie le plus creusé, approfondi au cours de l’année, est également assez parlant quant à mon état d’esprit. Il s’agit d’un film sur le quotidien, les petites choses, qui peut certainement paraître banal, sans intérêt, à certains spectateurs qui chercheraient plus de spectaculaire, de romanesque, ou d’allégorie. Mais c’est précisément dans les petits détails et dans la manière dont Sophie Letourneur les examine, les « nettoie » en se les remémorant, que ceux-ci prennent de la profondeur, peut-être jusqu’à pousser les spectateurs se reconnaissant dans cette démarche à s’identifier. L’identification n’est pas quelque chose que je recherche personnellement devant un film, et je ne pense d’ailleurs même pas que ce soit un effet intéressant, mais il faut bien avouer que, concernant ce Voyages en Italie, c’est peut-être ce qui m’a rattaché au film si durablement, quand bien même je ne serais pas du tout dans la même position sociale et/ou familiale des personnages dépeints dans le film. Comme quoi, ce sont bien les petits détails qui ont de l’importance, et pas les grandes lignes d’une histoire ou d’un passif.
Petit classement subjectif et dispensable :
Voyages en Italie
La Romancière, le film et le heureux hasard
Asteroid City
Anatomie d’une chute
Showing Up
Et la fête continue !
Le Gang de bois du temple
Rotting in the Sun
Chien de la casse
Babylon
Venez voir
Retour à Séoul
L’Envol
De nos jours
La Montagne
Retour à la liste des épiphanies
Saad Chakali et Alexia Roux (Des Nouvelles du Front cinématographique)

Dans l'après-coup
– et l'attente du coup d'après
« C'est l'hiver, ça va mal, les fleurs sont fanées, mais rien ne nous empêchera de chanter »
(vieille chanson géorgienne)
Un des 70 Proverbes de l'Enfer de William Blake serait peut-être approprié pour commencer. Celui qui instruit : « Au temps des semailles, apprends ; à la moisson, enseigne ; l'hiver, jouis ».
De quoi jouir toutefois quand l'hiver est là, et qu'il nous promet de faire durer ses froidures ? Comment se réjouir en effet quand les semailles auront été à ce point, et pour une nouvelle année, si peu disposées à la générosité ? Et la moisson d'être frappée de très grande pauvreté.
Le cinéma nous manque, auquel nous avons tant demandé. Le cinéma manque, à quoi nous demandons ce qu'il nous a déjà donné. Nous exigeons du cinéma ce qu'après tout il nous aura en effet offert, et dont quelques noms peuvent ici valoir d'emblèmes quand le temps est venu de célébrer, dans la mort de leur porteur, les immortels qu'ils auront été, Jean-Marie Straub et William Friedkin, Jocelyne Saab et Otar Iosseliani, Jean Eustache et puis Jacques Rozier.
Les films sont toujours plus nombreux, partout disponibles, dans les salles, sur les sites d'hébergement de vidéo et autres plateformes de streaming. Pourtant, le cinéma nous manque. De cinéma il y a peu, déserté comme si l'art qu'il nomme avait été confiné, confisqué. Un cinéma qui aurait le courage de la vérité, brisant le gel de l'actuel en ouvrant à la possibilité d'une nouvelle époque, par la violence esthétique des grands forçages ou la douceur des caresses qui tiennent dans leur paume des potentialités dans l'attente encore d'être réalisées.
L'extermination en cours des peuples, de l'air et du vivant, le cinéma n'y échappe pas. La guerre civile mondiale à laquelle se livre rageusement le capital à son âge impérial, qui est son stade terminal, et disons même apocalyptique, conduit à l'extinction massive et les industries culturelles y participent en colonisant les imaginaires pour les siphonner. Les imaginaires carbonisés par toutes les pompes lucratives, la dilapidation déprédatrice comme jamais.
Comment aimer des films qui aiment si peu ou si mal le cinéma ? Comment désirer voir qu'il y a encore du cinéma dans un monde irradié, implosant de fureurs sacrificielles, nécrosé ?
Les désastres sont connus, les émerveillements inconnus
Critiquer n'a jamais été une distribution de bons ou mauvais points, c'est une pharmacie. À l'origine, la critique témoigne d'une crise et le texte qui en fait l'inscription tient du diagnostic. Le cinéma est en crise, tout le vivant est en phase critique. C'est pourquoi nous n'avons jamais eu autant besoin de la critique à l'heure où elle est toujours plus incorporée dans la conversion hyper-industrielle de l'opinion en production globale de commentaires à fonction publicitaire.
Les fabricants de contenus s'enrichissent, le cinéma n'a jamais été aussi paupérisé. On le dira aussi de la chose publique, intoxiquée par les virulents progrès de la fascisation. Il faut voir comment la politique des auteurs a depuis quelques temps désormais viré en anti-politique des (h)auteurs pour admettre comment l'auteur personnifie surtout l'autoritarisme de ses manières, son style griffé, au mieux allié à des conservatismes, au pire à la tyrannie du surmoi.
Il faut voir comment tout régresse, tout déchoit, les bassesses du monde dans celui du cinéma.
Les désastres sont connus, annoncés, programmatiques. Les émerveillements, eux, sont toujours imprévisibles, à chaque fois des étonnements – des événements. Il y en a eu en 2023, peut-être même plus que ces deux dernières années, des films capables de redonner des forces quand celles-ci viennent à manquer, qui rendent au cinéma ce qu'ils lui doivent, tirant du chaos des propositions nouvelles, des configurations qui déplacent les centres de gravité, des cosmogonies qui bousculent les mythologies ancrées. Beaucoup ont été peu vus, de rares l'ont davantage été. Le cinéma se tiendrait là, ses forces dans ses faiblesses, dans une fragilité qui n'est pas contradictoire avec la vertueuse souveraineté de ses formes, sublimes, incorruptibles.
Le temps est aujourd'hui à l'après-coup, c'est la vertu de l'hiver. Les regards sont rétrospectifs en capitonnant trous et bosses de l'année et y déceler en pointillés les orientations dont nous avons besoin pour tracer notre sentier. L'après-coup intéresse surtout en préparant au coup d'après, qui est toujours déjà engagé dans les films qui s'essaient à redonner au cinéma ce que le cinéma leur aura donné – une dignité dans la justice que l'on doit rendre à son endroit.
L'hiver joue les prolongations mais, comme le dit la chanson, on ne cessera pas de chanter.
Chaud, froid, incorruptible
(Catherine Breillat)
L'Été dernier est le grand film d'amour du cinéma de Catherine Breillat, et l'un des plus grands du cinéma français – de tous les temps et pour tous les temps. La queue de comète de ce qui s'appelait naguère cinéma d'auteur et mise en scène en ayant encore du sens. Et ce film arrive au soleil couchant d'une œuvre qui scintillerait encore une fois, la dernière peut-être, le dernier été avant la nuit définitivement tombée dont le règne, griffé d'étoiles filantes, est au rayonnement fossile. Si le désir est une levée – orior –, l'or des alliances peut protéger du vortex affamé des orifices. Un bracelet offert peut bien ressembler à la menotte conjugale d'un mari jaloux. L'alliance maritale luit toutefois pour les étoiles mortes qui constellent nos vieillissements en sertissant nos secrets.
Pas un cinéma de la victimologie, non, mais de grandes batailles livrées pour défaire ce qui anémie le cinéma. Le cinéma est une princesse captive que délivrent d'autres princesses se révélant des dragonesses. Filles et femmes y sont moins de feu que des reines des neiges et leurs royaumes sont des banquises dont les confins relient le cinéma qu'il y a dans notre tête à l'écran de la projection.
Un cinéma du cerveau et le sexe en est l'X et la terminaison nerveuse, jusqu'à la pointe des plans. Comme Hélène dans Les Dames du Bois de Boulogne, le film de Robert Bresson et les mots de Jean Cocteau, le cinéma de Catherine Breillat est comme l'or : à la fois chaud et froid – incorruptible.
Avocats et commis du cinéma français
(Justine Triet, Cédric Kahn, Quentin Dupieux, Stéphan Castang)
Tout tribunal a pour visée la dissection, tout procès a pour horizon d'anatomiser les faits de société en oubliant qu'ils servent aussi à faire diversion. Anatomie d'une chute voudrait le démontrer, disséquant l'objet de l'accusation (une femme accusée du meurtre de son conjoint l'est pour l'échec de son couple) pour mieux en préserver le fondement (le droit n'y est jamais contesté).
Si le film de procès n'intrigue pas, soumis à la rhétorique d'un match mal engagé par la défense avant d'être remporté au finish pour le plus grand malheur de la victime, qui l'aura surtout été de son ressentiment, intrigue davantage l'antique loi qui en représente la part aveugle. La loi de l'enfant malvoyant qui fait le choix d'un scénario préférant à la vérité des faits la justice des affections asymétrique, différente selon que l'on soit papa ou maman. La balance tranche en revenant à l'enfant aux yeux gris, Daniel (formidable Milo Machado-Graner), tellement plus mature que ses parents.
Encore un procès avec Arthur Harari (comme acteur après avoir été coscénariste du film de Justine Triet), désormais l'avocat commis d'office du cinéma français. Refaire celui de Pierre Goldman n'appellera pas, pour Cédric Kahn, la possibilité de faire le procès du procès. Chacun des protagonistes n'a d'autre motivation que de camper sur ses positions, les accusateurs qui accusent, les défenseurs qui défendent, les témoins qui témoignent, les journalistes qui griffonnent comme les greffiers qui consignent. Et le public d'obéir à la loi d'airain des tautologies, que résume assez bien la maxime de défense de l'accusé du meurtre de deux pharmaciennes, un temps choisi pour être le titre du film : « Je suis innocent parce que je suis innocent ». Pour tous, un commandement sans exception à rester à sa place, croyant ou non en l'innocence du présumé coupable. Pour tous, vraiment ? Le fer croisé des perspectives conduit à la neutralisation facticement objective des antagonismes, pour à la fin déboucher sur un cas de divorce. S'il y a une exception, elle concerne la conversion d'un seul, l'avocat Georges Kiejman, dont la plaidoirie consent à la profession de foi.
S'il y a un effort de clarification que Cédric Kahn voudrait proposer, ce serait alors celui-là : l'identité juive sauvée de ce qui l'obscurcit, le communisme héroïque des pères dévoyé par l'Œdipe fatal de leurs fils. Le « juif de salon » que moque Pierre Goldman le reconnaît dans sa plaidoirie : l'avocat reconnaît à son client ce qui le caractérisait déjà sans l'avoir jamais admis jusque-là, soit une judéité blessée par l'Histoire. Il y eut un temps où un juif se reconnaissait une communauté de destin avec des maghrébins et des antillais. Ce temps-là n'est plus, le divorce est consommé. La clarification opère contradictoirement par obscurcissement de ce qui aura été magistralement rappelé en 2014 par Ivan Segré dans son livre Judaïsme et révolution : d'un côté, la rupture subjective avec l'État est le noyau profond et secret du judaïsme ; de l'autre, il n'y a d'émancipation singulière sans émancipation universelle et la réciproque demeure rigoureusement vraie. Moyennant quoi, Le Procès Goldman ressemble surtout à un épisode grand format de la série Cas de divorce.
Interrompre une mauvaise pièce, qui n'y a jamais songé ? Interrompre un mauvais film, non moins. Quentin Dupieux a été l'ouvre-boîte du flat beat, il se flatte depuis de faire du flat cinema. Avec Yannick, celui qui rêve haut et fort d'être un nouveau Blier en serait seulement le Jeff Koons (l'art idiot frisottant de connerie) et le Monsieur Meuble (meubler c'est le comble du remplissage d'une fosse laissant sceptique). À filer le je-m'en-foutisme ainsi, on va finir par ouBlier Dupieux.
Vincent c'est Karim Leklou, et le film de Stéphan Castang, le marteau qui lui tape dessus en lui (et nous) mettant jusqu'au cou. Philosopher à coup de marteau a brisé les glaces de la métaphysique, le cinéma à coup de marteau tape peu sur les nerfs, pas davantage sur les doigts.
Dans Vincent doit mourir, Karim Leklou est le culbuto d'une fable poussive qui jouit de son concept (la start-up nation, on n'en sort pas) comme d'un punching-boule de gomme. Les coups infligés y sont autant de rappels que le temps est à la décompensation paranoïaque tous azimuts, pour un regard de travers, pour un oui, pour un non. Ici, la pulsion s'étale en gras partout sur l'écran. Le surmoi, lui, daube tant qu'il peut de l'autre côté de la caméra. Vincent doit mourir martèle le sottisier du moment, l'ensauvagement ad nauseam, en ne voyant pas que le purin ne mène à rien.
Entre le cinéma des avocats commis d'office et celui des commis de bureau, y a-t-il lieu de choisir ? D'autant que le pire a été produit au nom des justes causes, Le Consentement de Vanessa Filho, qui crève en effet tous les plafonds de l'indignité. Le récit de la sordide capture exercée par Gabriel Matzneff sur Vanessa Springora, avec le consentement de sa maman, autorise à consentir à toutes les obscénités, des acteurs qui jouissent éhontément de jouer les victimes et les bourreaux, une représentation qui croit bon de se vautrer dans une pornographie à la petite semaine. Le pire étant que l'autrice du Consentement, ce récit autobiographique, y ait consentie. Seule l'archive avec la journaliste québécoise Denis Bombardier rappelle qu’il y a encore dans ce monde, où le succès du film a bénéficié des rituels conjuratoires d'adolescents postés sur TikTok, des sursauts de vergogne.
L'âge de la Terre
(Yosr Gasmi et Mauro Mazzocchi, Élisabeth Perceval et Nicolas Klotz)
Nomades et exilés sont les gardiens de la mémoire tellurique de Pangée. La mythique Terre unique et ses dérives tectoniques jusque dans leurs yeux, la séparation originaire au fondement de tout mouvement, écartement et distance jusque dans leurs pas. Géologie de la séparation est une nouvelle balade au grand air, un autre vagabondage dans l'amicale compagnie de réfugiés pas bien vus et si mal regardés. 150 minutes redonnent au serpent toute l'amitié nécessaire à faire la peau des poisons de l'enracinement, préalable à la fête des grandes retrouvailles. L'éternel retour est le dernier œil, il était déjà le premier, qui à l'origine nous regardait depuis la verticale de sa pupille.
Tourné à quatre mains et sans argent entre l'hiver et le printemps sur l'île d'Ouessant, Nouveau Monde ! (Le monde à nouveau) est un poème des métamorphoses à l'heure de tous les dangers, qui s'offre à la reconnaissance des amis sur lesquels on pourra toujours compter. Dédié à François Tanguy, le film l'est autant à Jean Epstein qu'à Béla Tarr, à Günther Anders qu'à René Char, à Mahmoud Darwich qu'à Léonard de Vinci, à Jean-Marie Straub qu'à Jean-Luc Godard Une grande fête des retrouvailles et de l'amitié. L'île bretonne, cette finis terrae où brille l'Or des mers, s'y montre comme l'ombilic du monde – nouvel Omphalos. L'endroit où rayonne le cinéma depuis l'élan des premières projections du Big Bang a pour envers notre monde atomisé, implosant à force d'irradiations, du cimetière marin qu'est la Méditerranée aux Tchernobyl de l'impérialisme russe.
Chant pour la ville enfouie (2022), Nouveau Monde ! (le monde à nouveau), désormais Cosmocide 2022 : c'est un triptyque en forme de tripode, un trépied comme celui d'une caméra, trois jambes et un pied dans chacun des sites d'élection des cinéastes, Jungle de Calais, Ouessant, Fécamp. C'est depuis ces territoires qu'Elisabeth Perceval et Nicolas Klotz trament une carte de piraterie à l'endroit des ruines de l'histoire et de la géographie, la Méditerranée en miroir des brasiers phosphorescents du néocolonial, la traite négrière et atlantique en arche raciale du capital – mers et océans du thanatopolitique. La piraterie est une économie de cinéma, alter et infra, loin des corsaires qui bandent et mouillent pour l'industrie ; c'est faire pirater aussi les oppositions de l'ailleurs et de l'ici.
Parades documentaires, fous et follies
(Véréna Paravel et Lucien Castaing-Taylor, Nicolas Philibert)
Rendre au cinéma ce que la médecine chirurgicale lui aura emprunté, à savoir l'usage des caméras, c'est extraire de l'imagerie médicale une force de transgression et d'excès qui manquerait au cinéma d'horreur en général. Sur ce plan-là, Lucien Castaing-Taylor et Véréna Paravel marquent à l'évidence un point, même si son caractère décisif était couru d'avance. Le documentaire bat à plate couture la fiction, à moins d'avoir l'inventivité figurative d'un H.R. Giger ou figurale, orgiaque et aorgique de La Chose de John Carpenter, quand ses images exposent ainsi l'intérieur des corps.
Le grand retournement des corps opéré par De Humani Corporis Fabrica se réduit pourtant à un strict inventaire de l'intérieur. Chaque opération de valoir en effet comme une performance sans transition – une parade, le coup de sonde comme un coup de force. Accouchement par césarienne et retrait d'une prostate, opérations de la colonne vertébrale, du pénis et du cerveau, pose d'une prothèse oculaire et dissection d'un sein rongé par le cancer ou d'un placenta tout frais sont des numéros, un freak show mené par un duo de bateleurs qui s'y connaît en monstres. La chirurgie est un festin pour les yeux, c'est une fête de la transgression, une orgie néo-païenne, un carnaval post-moderne. Follies pour eux, pour les autres une nef des fous. Et tant pis si ceux-ci sont filmés, morts-vivants évoluant entre couloirs et chambres, comme des organes malades ou des tissus nécrosés.
Le flair des bateleurs qui jouent au docteur Maboul les voue alors à concevoir des films comme autant de cabinets de curiosités. La dernière curiosité, l'ultime obscénité reviendrait peut-être aux curieuses vanités abritées par l'art contemporain quand la souffrance des uns, malades et médecins, donne aux autres, le blair dressé et la vue si courte, la permission esthète de jouissances mesquines.
En trouvant son site dans un centre d'accueil de jour pour adultes en souffrance psychique, Sur l'Adamant en confine l'hétérodoxie dans une acclamation (et ça marche, de la Berlinale aux salles) qui a pour synonyme grec celui de doxa. Continuer à défendre la psychothérapie institutionnelle, après Le Moindre geste (1997), à l'époque d'une souffrance qui accable aussi les institutions alternatives de soin, tient de la « doxographie » pour employer un néologisme de Pierre Bourdieu. Une cinématographie de la doxa joue la surdité (les contradictions ne se disent qu'à la fin, aussitôt étouffées) en rejouant l'enfermement (le patient ne démérite pas à produire sa prestation, à se faire l'animateur de ses fêlures). Le film de Nicolas Philibert tend ainsi à l'émission de variétés.
Sur l'Adamant n'est pas une variation neuve de La Nef des fous de Bosch, c'est une nouvelle édition de la Maison de la Radio, avec rires et chansons, anecdotes savoureuses et ambiance potache, poésie pour amateurs et clins d'œil au cinéma. Ici, même la confiture faite maison doit rapporter.
Du genre des films qui jouent du genre
(Dario Argento, Alex van Warmerdam,
Lav Diaz, Laura Citarella, Lindsey C. Vickers)
Une éclipse solaire, c'est comme un doigt dans l'œil. Ce qui s'impose dans le ciel dégagé de Rome, c'est un trou noir qui absorbe les métaphores aveuglantes. Si, soudainement, certains chiens se mettent à aboyer, alertés par la portée et l'énergie forcément métaphorique d'un phénomène astronomique, c'est pour crier que la métaphore, justement, ne saurait les éblouir. La cécité c'est alors pour les autres, les amateurs désargentés de Dario Argento qui s'échineraient à voir dans Lunettes noires le retour gagnant du maître du giallo après une absence des écrans longue de dix ans. L'éclipse solaire est cependant un doigt dans l'œil si l'on ne voit pas que s'y joue un certain régime de l'assombrissement qui, par des voies tout à fait spéciales et typiques du maniérisme argentien, conduit étonnamment à la douceur, c'est-à-dire à ce toucher qui se défie de pénétrer.
Lunettes noires est un film mineur, il n'y a pas à en douter. Mais le petit giallo de série comme on n'en produit plus est une touchante réussite pour un cinéaste qui, âgé de plus de 80 ans, revient de loin en sachant que ce retour n'induira jamais la répétition des grands éclats aveuglants d'hier.

Des répétitions théâtrales soumises à un jeu de variations qui a pour caution formelle l'expérimentation et pour vérité cachée des affects mal digérés, des surveillances redoublées qui projettent une paranoïa à des hauteurs insoupçonnées, une généalogie troublée qui décolle dans les étoiles : N°10 d'Alex Van Warmerdam est un émerveillement, noir et jubilatoire, l'absurde en toute logique, le surréalisme moulé dans le gant de fer de Fritz Lang. Tout ce qui suit découle précisément de ce qui précède et, pourtant, on avance de surprise en surprise, le cinéaste néerlandais s'appliquant à une compression de ses obsessions pour y mettre le feu et envoyer la fusée flotter dans l'espace intersidéral. Passer du théâtre expérimental à l'hypothèse extraterrestre, si cela permet d'évacuer le kitsch catholique, n'empêche pas d'angoisser face à ceux qui en savent plus que soi sur où l'on va.
Aux Philippines, le crime n'est pas ce que traque la police mais ce dont elle participe. Être policier est un crime, une nuit de l'âme, le venin d'une chair qui pourrit. En plan rapproché, c'est une inflammation de la peau et de l'esprit ; en plan large, du sable comme de la poudre noire qui recouvre les dalles d'une maison de bord de plage. Quand les vagues se retirent, la dernière chronique au long cours de Lav Diaz, consiste à ralentir la narration avec son jeu d'identification policière et, ainsi, mettre la police aux arrêts. Et si l'allégorie pétrifie avant d'effriter, c'est par démoralisation autant que par desquamation, des éructations évangélistes à la virulence du psoriasis.
Une femme est partie. S'est-elle enfuie ? Son absence est un trou qui appelle le récit à proliférer et fuir comme un jardin au sentiers qui bifurquent, une pampa, on n'est pas pour rien en Argentine. La femme qui manque à l'appel s'appelle Laura, comme l'héroïne d'Otto Preminger et la retrouver c'est partir à l'aventure, comme L'Avventura a pour centre fuyant une femme disparue, Anna jouée par Lea Massari. Laura Paredes est son interprète, Laura Citarella est la réalisatrice du film et les deux Laura ont imaginé ensemble une nouvelle aventure de Laura après Ostende (2011).
Trenque Lauquen raconte beaucoup, le film dure 4 heures 22, des histoires de femmes, de faune et de flore, de lettres et de livres. Le jeu des bifurcations narratives est un perspectivisme qui fonctionne mieux dans sa première partie, quand la seconde est une chasse au snark un peu vaine. Mais il s'agit d'aller au bout du noyau de nudité d'une envie de suivre une piste qui cache un désir de se perdre. Le plus beau tient à ce que cette prodigalité de récits, de détails et de motifs représente le versant imaginaire d'un documentaire dédié à la ville de Trenque Lauquen, située à 445 km de Buenos Aires et où Laura Citarella a passé son enfance. En langue mapuche, Trenque Lauquen dit le lac rond et il y a de l'omphalos dans un lieu réel ici considéré tel un ombilic secret pour le cinéma.
À l'image, une écolière anglaise sur le chemin du retour. Au son, le descriptif d'un rapport de police, le ton neutre, factuel. La première coupe à travers champs et n'en reviendra pas. Le second spécule sur les hypothèses en laissant toutes les pistes ouvertes. Sandy a disparu dans un trou noir et sa bouche de feuilles et de tourbe insiste, une exhalaison de mort au cœur du taillis. C'était il y a trois ans. Trois ans plus tard, une autre apprentie violoniste, Joanne, lui emboîte le pas, à ceci près quelle emprunte le même sentier en marchant de l'autre côté de la béance inaugurale. The Appointment est un récit impressionnant de féerie sorcellaire, immunisé contre tout pittoresque folklorique. L'envoûtement enveloppe l'irradiant secret, cette crypte qu'enclavent un père et sa fille quand l'heure est au rendez-vous professionnel (appointment) comme aux déceptions filiales (disappointment), ces catastrophes d'autant plus effroyables quelles sont absolument inévitables.
Hollywood, les gâtés et les gâteux
(Todd Field, Damien Chazelle, Steven Spielberg, Christopher Nolan,
Greta Gerwig, Martin Scorsese, David Fincher, Ridley Scott)
Magistral. Le qualificatif s'imposer aisément sous la plume des critiques et, pour une fois, son usage serait justifié si l'on voulait enfin se poser la question de savoir ce qu'il est vraiment censé signifier. Magistral, Tár l'est en effet et ce n'est pas forcément une qualité, on voudrait encore en discuter. Le magistère y est amer et l'amertume est un goudron qui, non seulement, attire les plumes d'une critique dithyrambique, mais s'accorde également avec le nom de son héroïne, Tár, avant d'enliser un film dans l'aggloméré de ses hautes prétentions dont la distillation est auto-destructive.
Damien Chazelle, lui, est un prodige, mais d'un genre particulier. La vérité du prodige a été établie par un groupe britannique de musique électronique au nom caractéristique, The Prodigy, quand il a intitulé son hit « Smack My Bitch Up » qui pourrait se traduire ainsi : « Claque ma chienne ». Le prodige est ainsi, furieusement adolescent. Ses turgescences sont des pièces montées dont la crème battue l'est au lasso, par des coups de fouet, écœurantes en étant sans cœur. Le prodige tourne des films comme un maquereau claque la croupe de ses « chiennes », avec l'épate et le swing tapageur de celui qui loue le spectacle, tout en assurant que ses réussites acclamées sont des fessées nécessaires à faire gicler du pire le meilleur. Le spectacle est une chienne qu'il faut dresser en la bifflant, ce que Babylon sue à démontrer. L'apologie du cinéma des origines a ainsi le fantasme urologique, mais l'énurésie domine et l'incontinence des larmes est celle du prédateur crocodile.
De quoi The Fabelmans est-il le film ? La grande fable d'un génie précoce du cinéma adoubé par le maître John Ford est une fable amoindrie sur les pouvoirs du médium. Le plus grand chapiteau du monde est coincé dans le nombril d'Œdipe. Voilà qu'à 77 ans, un homme que tout a consacré, box-office et désormais une critique unanime, instruit encore le procès de sa maman en y reconnaissant l'archi-monstre, le premier à l'origine de tous les autres qu'il faudra dompter. Le blockbuster qui fait exploser le quartier y a déposé des trous d'enfance et du trou noir est sorti un Hamelin du troisième type, un enchanteur qui a tiré d'un trauma d'enfance ordinaire l'autorisation de confiner les enfants dans leur chambre, tenus à l'amour de leur kidnappeur, ce capitaine Crochet.
Une fois fait un sort au syndrome de Stockholm, les symptômes peuvent capitonner une histoire de la cinéphilie qui, de contre-culture, est redevenue l'arme des colons qui se font aimer de leurs colonisés. L'enfance captivée l'aura donc été à seule fin d'être convertible en très lucrative puérilité.
Le désastre du nouvel âge ouvert dans le fracas du nucléaire est un spectaculaire désert : Oppenheimer en témoigne, avec tous les tours, pompes et trucs de la manière nolaniennne, toujours colossale. Pourtant le magistère déçoit, encore une fois. Concevoir un film comme un abri antiatomique pour un cerveau dont il faut rétablir le cœur et l'honneur a ses limites. Christopher Nolan sait bien que le monde est mortel, pourtant le fin stratège qu'il est ne le voit pas. Si le conflit des facultés entre faire et imaginer se traduit par le paradoxe classique du visionnaire aveugle, c'est un miroir que se tend à lui-même un auteur qui, si narcissique soit-il, échoue à s'y reconnaître.
En 1997, le groupe danois d'eurodance Aqua sort Barbie Girl, un carton commercial. Mattel, propriétaire de la marque Barbie, porte plainte pour détournement d'image. La justice donne raison au groupe au nom du droit à la parodie. En 2009, Mattel récupère la rythmique de la chanson pour ses réclames. En 2023, Mattel a retenu la leçon des dialectiques de la critique en commandant à Greta Gerwig un Barbie alliant l'offensive publicitaire à la parodie décomplexée. Le rose est une couleur froide, la liquidation par refroidissement d'un féminisme homogène à ce qu'il est censé brocarder, sa critique devenue la publicité d'un capitalisme irrécupérable à force de tout récupérer.
Alien oblige, Napoléon vu par Ridley Scott tient du xénomorphe, le monstre jailli des entrailles sanglantes de la Révolution, avant de valoir lui-même de ventre à toutes les folies totalitaires du XXème siècle. Le paradoxe de l'endoparasite souffrant lui aussi de gastropathie. C'est le dernier duel des duellistes : la momie kubrickienne penche parce que Ridley Scott canonne son apex. Avoir une pyramide en lieu et place de la tête n'empêchera pas une certaine lucidité. D'un côté, Ridley Scott pose qu'il y a deux types de grands hommes, ceux qui ont des manières et ceux qui n'en ont pas, voilà comment s'avère la supériorité morale du Duc de Wellington sur Napoléon. De l'autre, le réalisateur britannique est un entrepreneur au service de l'industrie hollywoodienne et ses nouvelles ramifications (Apple Studios). Et, face à l'Histoire, comme d'habitude (1492), il perd mesure et maturité. L'empereur déchu qui fascine les aspirants de la marine anglaise, avant l'exil où il fanfaronne devant des enfants, figure un bel aveu : la forfanterie n'impressionne que le puéril.
Le tueur à gages est le designer de sa propre vie, la part d'ombre et d'horreur de cette esthétique industrielle et fonctionnelle qu'est le design. Les antinomies de la modernité a ses couples paradigmatiques, Kant avec Sade, Holmes avec Morris. Et David Fincher, son meilleur représentant en cinéma, meilleur même que Michael Mann et Nicholas Winding Refn réunis, quand chaque image, froide, archi-composée et ultra-encodée, sacrifie aux calculabilités stylisées du designer. Le Killer selon lui résout moins ces antinomies qu'il en offre le visage le plus synthétique, homme de principes catégoriques moulés dans l'apathie que l'assassinat ciblé exige, ingénieur qui a designé sa vie au nom d'une rationalité et d'une efficacité appariées aux standards du capitalisme 3.0. Si l'exécuteur ne laisse pas de trace, c'est qu'il a commis un crime – exécuter pour Netflix.
Le cinéma designé en est un autre et son héros, moins le samouraï de Jean-Pierre Melville qu'un mélange du Léon et de Victor, le nettoyeur de Nikita, deux films de Luc Besson. Michael Fassbinder a la beauté du silicium, sans faire oublier qu'il doit beaucoup aux cailloux cassés par Jean Reno.
Un bon Indien est un Indien mort : on connaît l'horrible aphorisme, attribué au général unioniste Philip Sheridan. Un bon Osage est un Osage mort : The Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese le penserait à sa façon quand, à l'ère humanitaire des pénitences et des attritions, la victimologie labellise une vaste machine criminelle, celle qui a toujours emporté ses affections, des mafias contrôlant les casinos aux places boursières en passant par l'industrie hollywoodienne elle-même, qui joue autant sur l'étendue et le perfectionnement de ses ramifications que sur la mobilisation de ses nigauds, ces « rolling stones » qui roulent et que l'on roule.
D'un côté, la victimologie en supplément d'âme pour les tambours battants du crime organisé ; de l'autre, la réflexologie d'indécrottables motifs en ratiocinations de barbon : au milieu, ce long ventre mou qui s'éviscère en fosse commune, le peuple des Osage, les perdants de l'Histoire – sa merde noire – qui le sont encore dans sa représentation même, d'un blême. Le devoir de mémoire se coule dans la moulure des funérailles, les enterrements de première classe mieux que tout sauvetage.
De la grandeur du petit
(Jonás Trueba, Sophie Letourneur, Cyril Schaüblin,
Alain Cavalier, Bruno Podalydès, Christophe Clavert, Narimane Mari)
Venez voir de Jonás Trueba est un film à la modestie nécessaire et sa qualité de je-ne-sais quoi possède un charme fou qui fait passer le presque rien du cinéma, qui est presque tout. Rien à voir avec les petits riens de Hong Sang-soo qui, à chaque nouveau film, déballent leur anémie consentie. La bulle est ici remuée de spirales, des remous imperceptibles, la sphère grosse de l'écume des amitiés qui risqueraient d'avorter, comme Su a dans l'interstice des saisons perdu l'enfant attendu. Le bonheur à respirer ensemble l'air des affections qui se disent et ne se disent pas est l'amitié comme immunisation et climatisation : une beauté soulagée des impératifs de la gâterie.
Sophie Letourneur fait du cinéma marmonné comme on a pu un temps parler outre-atlantique de films mumblecore. Bredouiller aujourd'hui le Rossellini avec Voyages en Italie, ce n'est pas repartir bredouille d'une confrontation avec le Stromboli du cinéma moderne, mais tenter au contraire une expérience in-vivo, en voyant jusqu'où mène le relâchement quand il ne coïncide pas avec une forme de lâcheté. Partir en Italie pour un couple enrayé par la mécanique conjugale comme un disque rayé, c'est faire relâche, soit suspendre et adoucir. C'est encore ralentir en sachant passer du laisser aller au délassement, l'abandon mieux que tout renoncement. Le débraillé nasillard frôle le bidonnage avant la relaxe, inespérée. Le bidon est aussi un ventre où la mort est conjurée.
Oser la reconstitution historique avec l'exactitude de l'horlogerie, et vérifier dans la foulée l'actualité d'un fragment méconnu d'Histoire en posant qu'elle repose sur un ensemble d'effets d'étrangeté, c'est à cette mécanique de précision que s'est attelé avec Désordres Cyril Schäublin.
Quelques années après la Commune de Paris, la vallée de Saint-Imier dans le canton de Berne y est décrite comme un foyer pour l'industrie horlogère, surtout comme un incubateur d'anarchisme dont l'enseignement fut décisif pour Piotr Kropotkine, prince russe et cartographe en mission dans la région. L'intersection de la forme originale adoptée et des exigences d'authenticité de la documentation est une chambre d'écho qui fait différence de la pluralité des voix et leur étrangeté.
Le plus étrange demeure encore que le capitalisme comme synchronisation des temporalités et disciplinarisation du travail, toutes choses décrites en particulier par Edward P. Thompson, représente à Saint-Imier une fabrique de coucous dans laquelle se seront déposés les œufs de coucou de l'anarchisme. Contre la nullité du titre français, on donnera raison au titre original : Unrueh qui dit le balancier désigne d'abord l'inquiétude rédimée dans le battement des révolutions.
Un agent immobilier ne serait intéressant à filmer qu'en montrant qu'il fait autre chose quand il est sur le terrain de ses activités. D'ailleurs, il parle deux langues, sa rengaine professionnelle et la ritournelle de ses petits soucis. Waouh ! tient du plaidoyer pro domo. L'immobilier prête aux séries parallèles (l'appartement avec le personnage de Karin Viard, la maison avec celui de Brun Podalydès) mais c'est surtout avec la seconde que Waouh ! touche au but, qui n'est justement pas de donner au spectateur la possibilité du waouh attendu, l'onomatopée de BD s'en trouvant ici essorée.
Le jeu moelleux et gouleyant de Bruno Podalydès, sosie inattendu et doux de Pierre Brasseur, fait des merveilles en ne se suffisant pas à seulement promouvoir le cossu et le cosy. C'est que l'arrondi est ce qui amollit la rengaine en la faisant ritournelle, tandis que l'attendrissant est ce qui autorise le comique à diffuser des senteurs doux-amères. Ce n'est plus d'immobilier dont il s'agit ici. La sensation prodiguée est d'habiter, le seul temps du film. On habite un film et un film nous habite, voilà bien le genre d'habitat dont le cinéma promet la possibilité, distinct de tout bail d'habitation.
Le bonheur pour Alain Cavalier, c'est de filmer comme Lester Young joue du saxophone dans Stardust (1952). Son aveu aura été soufflé dans son Paradis (2014). Faire un plan comme un souffle, faire du cinéma comme on respire. Un bonheur aérien. Le souffle du filmeur, sa respiration qu'à plusieurs reprises on entend dans ses films précédents comme les suivants, et désormais L’Amitié. Depuis qu'il est s'est émancipé des lourdeurs logistiques du cinéma, Alain Cavalier filme comme il respire, selon les battements de son cœur et les inspirations aléatoires de son désir.
Depuis La Rencontre (1996) et l'apparition de François Widhoff dans sa vie, Alain Cavalier est au paradis. Béatitude comme celle à laquelle a rêvé Spinoza. Le paradis consiste aussi à aller y voir dans le paradis des amis de longue date, le parolier Boris Bergman, l'ancien producteur de cinéma Maurice Bernart et le coursier Thierry Labelle. L'amitié a le mystère de son inconditionnalité, il est une responsabilité dont la réponse ne tient à rien d'autre qu'à son secret, entre rires complices et vices qui demeurent le seul privilège des vieillards. Tout cela offre à la main du filmeur de pouvoir rédimer les mutilations pas que symboliques de l’économie digitale. On pense en particulier à la paluche d'Alain Cavalier, sa main qui, massée de manière experte par Boris Bergman, se met alors à flotter. L'amitié est ainsi une condition du cinéma pour autant qu'elle en est l'allègement garantie.
Un être manque au film sur le bord d'être tourné, en parallèle Paris voit fleurir sur ses murs lépreux des clés ouvrant sur d'impénétrables secrets. Les Nuits d'été de Christophe Clavert baguenaude parmi des choses sérieuses, la vertu dans la nécessité et le cinéma qui tâtonne en sachant compter sur l'amitié, et des champignons de l'obsession variant dans leur degré de toxicité.
Qu'un film puisse briser la mer gelée qui est en nous, moins la hache de Franz Kafka que la plante saxifrage chère à René Char. Qu'un film soit exactement au milieu du cinéma, à chaque fragment une exclamation, de chacun de ses plans un étonnement, un éclat, des cristaux d'intensités pour des différences de potentiel, rires et ritournelles. Des bouts de ficelle pour n'en pas voir le bout, jamais – remontages du temps subi. Des bouts d'enfance qui font tourbillonner l'origine dans les courants du devenir – pied de nez au néant, pirouettes cacahuète face au pire. On a eu la journée bonsoir de Narimane Mari est ce film-là, un poème d'amour et de mort – et du désir demeuré désir.
La préférence des dépendances
(Hong Sang-soo, Pierre Creton)
Cela fait longtemps, on ne sait plus, la frontière s'est estompée dans un nuage de lait : les films de Hong Sang-soo, on les regarde poliment. On y acquiesce mais l'acquiescement est une politesse pareille à celle que s'échangent, en signes de reconnaissance et d'hypocrisie, ces gens de bien qui ont oublié qu'ils se connaissaient, ou qui se retrouvent inopinément après s'être perdus de vue en n'ignorant pas qu'ils se perdront à nouveau, avant l'hypothétique revoyure suivante. C'est en convenant de la gêne qu'occasionnent ses films qui s'enchaînent, quand l'amour noie le mystère de ses gestes muets dans les manières souriantes qui en surexposent le secret. Le soju a cessé de faire effet, l'éther s'est depuis longtemps dissipé. La gêne marque désormais l'indifférence malheureuse face aux films dont le propre aspire à ce qu'ils s'oublient dans la crème des blancheurs surexposées.
On suivait Hong Sang-soo quand ses jeux narratifs reposaient dans le champ des sentiments la question des perspectives. Il intéresse de moins en moins en cultivant son profil de petit joueur qui s'en remet si peu aux nécessités, quand il s'y dédie dans le filigrane de ses micro-récits. L'incrémentation des films qui s'écrasent les uns sur les autres avoue au moins la préférence des dépendances (par exemple à l'alcool) aux nécessités du jeu. Les verres de soju se suivent et se ressemblent, ils finissent par s'équivaloir en attendant le suivant, moins le dernier que le pénultième.
Un prince se dédie à l'arpentage d'un petit jardin cultivant la défoliation des opposés, le rustique et l'érotique. Pour en approcher le secret, lagomorphe comme le lapin d'Alice, une traversée du miroir a la douceur nécessaire à blasonner d'allégorie les entrelacs racinaires de la fiction et du documentaire. Si le maître du domaine y sacrifie par ses dessous à l'autobiographie, c'est en bon propriétaire terrien s'accrochant aux branches de la virilité. Leur taillis abrite en effet les esprits d'un totémisme gay, une serre restreinte dans son hospitalité. Arpenteur de ses terres en bon propriétaire, Pierre Creton ne cesse d'en différencier les mérites, incultes ou fertiles. Gazonner l'exotisme des magies phalliques est loin de réparer des mutismes qui ont depuis longtemps fini d'être innocents.
Si le jardin est un royaume, la serre tient ici du domus. Une autre histoire de dépendances, s'agissant du patrimoine foncier d'un nu-propriétaire. Pour René Schérer, l'hospitalité subvertit en s'accordant à l'érotique. Un prince se plante quand il pique, pique et repique pines et culs d'une cuculiculture.
Vigilance et admiration
(Aki Kaurismäki, Robert Guédiguian)
Si le souci est celui de la dignité dans un monde transi par l'immonde, il tient d'abord dans le refus des humiliations et des commisérations sanctionnant leur représentation. Rien que pour cela, le cinéma d'Aki Kaurismäki reste infiniment plus précieux que celui d'un Ken Loach, immunisé aussi contre le narcissisme hystérique d'un Nanni Moretti, auto-banni dans la dernière région d'un gauchisme mutilé de toute option politique. L'humour pince-sans-rire, à froid, d'Aki Kaurismäki est la politesse finnoise du désespoir. On n'est désespéré que de ce que l'on voit, jamais de ce que l'on sait pouvoir encore sauver. Les feuilles mortes sont le dépôt des rayons verts qu'elles auront portés.
On ne ferait pas autrement des plans, en sauvant ce qui disparaît, en vigilance pour tous les oubliés.
Quand tout s'écroule, fondations pourries, des exercices d'admiration trament, en parallèle d'une pédagogie située les décombres, la possibilité d'un peuple. Avec de nouvelles topiques qui revigorent les lieux communs, les exercices d'admiration de Robert Guédiguian sont d'adoration dédiée aux vivants qui, ne pouvant faire autre chose que lutter, forment un chœur des « insatiés ».
Les auteurs reviennent – du pareil au même
(Wes Anderson, Nanni Moretti, Ken Loach, Kelly Reichardt,
Nuri Bilge Ceylan, Victor Erice, Hayao Miyazaki)
La chambre d'adolescent est la dernière frontière du cinéma US et si Steven Spielberg en a longtemps été le « brainiac » en chef, Wes Anderson en représente aujourd'hui l'un des trois castors juniors, avec Jordan Peele et Damien Chazelle. Le cinéma domestiqué lui tient autant de fab lab que de conciergerie, une partie de Playmobil projetée sur diapositives pour présentation d'entreprise.
Asteroid City aspire ainsi au recodage rétro des illustrations de Norman Rockwell, soit le recyclage de l'esthétique publicitaire à l'ère du CAO (le cinéma assisté par ordinateur). L'extrême lisibilité, signalisée, du cinéma de Wes Anderson est inséparable d'un sérialisme condamnant le concierge à resservir le même plat. Si le « brainiac » a du cœur, c'est en en distribuant les parties amovibles dans le désert américain, ce mirage en toute transparence qui a pour nombril un trou noir. Le cinéma du cerveau de Stanley Kubrick connaît donc aujourd'hui sa miniaturisation domestique avec Wes Anderson. « Comment se réveiller si l'on n'est pas endormi ? » est ainsi le mantra d'un cinéma qui, peut-être, se mettrait à nu comme jamais mais dont la nudité, celle du « brainiac » poseur et miniaturiste, est un scoutisme aigrefin et revanchard, oublieux du rêve autant qu'il l'est de l'éveil.
Les grandes colères morettiennes de naguère ont depuis longtemps viré en ronchonnements d'un vieux tonton respectable, mais remâchant en bout de table que tout était tellement mieux avant.
Vers un avenir radieux augurait d'une reprise en main, le combat contre l'époque mais c'est une comédie. On apprécie l'évocation inactuelle de la Hongrie de 1956, deux ou trois chansons italiennes, un beau dos crawlé. Las, Nanni Moretti revêt sa défroque préférée, c'est plus fort que lui, celle du sujet supposé savoir en reproche vivant. Le curé est plus prosélyte que jamais, et bien moins en difficulté qu'à l'époque de La Messe est finie (1987). Adoptant le modus operandi de l'interruption et de l'interposition, Giovanni-Nanni fait la morale à tout le monde parce que tout le monde a cédé sur les principes, laisser le portable allumé quand on regarde un film, improviser au lieu de respecter la fidélité du texte, filmer avec complaisance la violence en écartant tout questionnement éthique, se livrer pieds et poings liés à Netflix. Tout le monde sauf bien sûr Nanni-Giovanni, l'exception dont le spectateur a besoin pour jouir de ses propres distinctions en miroir.
L'homme du reproche vivant et de la critique systématique a l'interposition hystérique. Ventriloque et souffleur de ses personnages, il les coupe ou les voue au brouhaha, le bateleur en chef et le Lider Maximo, tous derrière et lui devant. Seul Giovanni-Nanni énonce et articule et il a toujours raison, même si c'est seul contre tous. L'autarcique de naguère réitère ainsi à tout bout de champ qu'il y a au moins un maître à qui se fier et c'est lui. Arracher Staline des affiches est le seul geste stalinien que les anticommunistes adorent et Nanni Moretti s'y adonne en jouant la réécriture de l'Histoire plutôt que l'observation curieuse de sa difficile écriture au cours. Le communisme est tellement plus aimable quand il est nostalgique ou sujet à l'uchronie. Le seul communisme auquel croit Nanni Moretti, c'est à la fin le morettisme qui, pourtant, n'est que la dégénérescence sénile du gauchisme.
Dans la banlieue de Durham, l'enseigne du pub est branlante. Le K glisse, décroche, risque de tomber. Le Vieux Chêne (Old Oak) est-il toujours OK ? Les couacs du cinéma du vieux Loach se déduisent des mêmes atermoiements, branlant entre la kermesse (le tournage en fête de village) et la messe (si tous les gars du monde se donnaient la main...). Le grincement des coulisses tantôt résonne avec les articulations arthritiques d'un monde ouvrier exsangue (la résistance épique des mineurs en photographies remisées dans une arrière-salle abandonnée), tantôt fait entendre le grippage des scénarisations poussives (le regain des solidarités populaires gagé sur la distribution des bons et mauvais points). La juste préférence de la solidarité à la charité a pour impasse la résilience en son essence caritative – le cinéma du care est la dead-end de toute politique d'émancipation égalitaire.
Dans la ville d'adoption, Portland en Oregon, le petit monde de l'art est tissé des fils de la convivialité et de l'amitié, mais le cocon est rongé de l'intérieur par l'angoisse recuite d'une rivalité qui sait faire son nid du cosy. D'un côté, Showing Up de Kelly Reichardt et son fidèle ami écrivain et scénariste Jon Raymond glissent dans le four documentaire d'un milieu familier un pain d'anxiétés qui tordent bien peu en réalité le constat d'une reconnaissance largement établie par les festivals (Cannes et Locarno) et les musées (Beaubourg et MoMA). De l'autre, l'attention au réel qui érafle et moleste les volontés de maîtrise, en faisant le mauvais caractère de la sculptrice jouée par Michelle Williams, se trouve anéantie par les conditions de production d'un film dont le luxe ne craint pas en effet de recourir à une équipe dépassant la centaine de personnes et l'emploi d'effets spéciaux numériques pour filmer un simple pigeon. L'impressionnisme y prend un sérieux coup dans l'aile. Le beau et juste souci de la modestie et des petites économies tiendrait-il alors du pigeonnage ?
Le nid douillet, avec ses tissages à la Annette Messager, est une pompe à chaleur qui consomme bien trop pour faire croire qu'elle servirait un plaidoyer militant pour la décroissance et la sobriété.
Partir pour donner au présent le sens de la fuite et de l'inachèvement, revenir pour lui confier à l'oreille celui, intempestif, de la relance. La partance en tant qu'elle appelle à la revenance, en tant qu'il faut être sur le départ pour soutenir qu'aller et devenir, c'est toujours revenir (de) quelque part. Avec Fermer les yeux, Victor Erice revient une nouvelle fois au cinéma – enfin ! –, mais le retour tant attendu du vieux capitaine basque espagnol a toutefois des détours qui sont moins de nouvelles fugues expérimentées, qu'ils gouvernent le sens des achèvements en les menant trop bien à bon port.
Fermer les yeux a les retrouvailles aussi royales que maussades, tristes comme un roi qui a organisé avec tant de componction son retour gagnant, ayant été à l'arrachée relégué dans la sélection Cannes Premières du Festival de Cannes après avoir été d'abord retenu en compétition officielle. Il y a vingt ans, Fermer les yeux aurait eu à l'aise la Palme d'or. Et s'il la reçoit de la part de la presse unanime, c'est en offrant ses lauriers à un roi dont la tristesse pose que gagner n'est rien qu'un passage obligé.
Les Herbes sèches poursuit l'affouillement ouvert avec Winter Sleep (2014) et continué avec Le Poirier sauvage (2018). La troisième partie d'un traité des passions tristes, ces eaux usées, réussit presque à déborder le seul profit du surplomb posant l'universelle permanence de leur infécondité. Il s'agit pourtant de faire émerger, au milieu des plantations habituelles, la fleur d'une nouvelle question, jusque-là laissée en jachère par les deux précédents volets du triptyque, et dont la poussée écarterait enfin les meubles du désenchantement bilieux : le désir féminin et son opacité.
Ce désir croise ici deux figures, Nuray la femme mutilée et Sevim l'adolescente revêche, qui bousculent à distance l'actualité des dossiers de société (le militantisme et la question kurde, la sexualité des mineures et les fausses rumeurs). Le ridicule coiffera plus d'une fois le crâne d'un homme qui ne voit jamais qu'il perd à plusieurs occasions des plumes, et pas seulement au sommet de sa tête. Les Herbes sèches se clôt pourtant par une pelouse des plus cramées. Le soleil attendu est celui de Sirius et sa place, occupée par le cynique qui, déjà, considère en contrebas ses amis avec la distance de celui qui croit en savoir plus qu'eux, avant de repenser à l'adolescente en commençant à lui reconnaître sa liberté d'agir, pour ensuite lui promettre le piteux destin des herbes sèches qu'il vient de fouler dans un plan filmé à ras de motte. L'ironie a l'inélégance de ramener l'homme du sentiment foulé aux pieds dans un ressentiment qui remporte finalement la préférence de l'ironiste.
Couper le souffle en ruant dans les brancards, l'auteur d'inoubliables anime sait toujours y faire et il le fait encore en déposant Le Garçon et le Héron sur le seuil des récits d'initiation d'une enfance endeuillée et de l'art d'être grand-père. Un géant de l'animation a le génie du souffle, la mise poétique des rêveries de l'anima contre les soucis de l'animus selon la distinction bachelardienne.
L'énergie tumescente d'une montagne surpeuplée des esprits d'un animisme indécrassable se déballonne cependant en dispersant ses éboulements dans les lieux communs des héritages par le sang et des deuils auxquels les enfants doivent sacrifier en grandissant. Le Vent se lève examinait le fond de catastrophes originaires dont les feux et bourrasques alimentent le moteur des machines volantes de Hayao Miyazaki. Le Garçon et le Héron leur tourne souverainement le dos, au nom de grandes orgues qui échouent à écraser le son discret, mais à jamais perçant, des sanglots des enfants que la fugue onirique et initiatique de Mahito, aussi animée soit-elle, ne fera jamais oublier, Setsuko et Seita, martyrs du Tombeau des lucioles (1988) de l'autre géant des studios Ghibli, Isao Takahata.
Edmond Jabès l'a dit : aérien ou rien,. L'air qu'inspire le cinéma d'animation trouve ses meilleures respirations quand il vient à manquer. Il faut tenter de vivre, y compris quand le vent est tombé.
Le cinéma d'animation connaît d'autres versants qu'écrasent trop souvent les productions japonaises sous hégémonie du style Ghibli. À des pôles extrêmes, on saluera ainsi Mars Express de Jérémie Perrin qui, s'il maîtrise sans invention les leçons de ses maîtres, Isaac Asimov et Philip K. Dick, déploie un style « ligne claire » habillant tactiquement son scénario un brin nébuleux dédié à l'intelligence artificielle émancipée des servilités de l'espèce humaine. On saluera à l'opposé le travail titanesque accompli par Mad God de Phil Tippett. Un effort courant sur plus de trois décennies afin de sonder un pandémonium de figures et de formes, comme un traité de la fécalité dédié à l'obscénité démiurgique, à l'abjection pornographique de toute représentation post-apocalyptique. Le caca de références malaxées, dégluties ou chiées traduit l'identité matériologique entre la monstruosité de la représentation et celle du représenté. Une Divine Comédie de l'animation en stop-motion et la catabase est un caecum qu'il faut suivre jusqu'au tréfonds de ses entrailles.
Ce qui nous réchauffe, ce qui nous brûle, ce qui nous mine
(Youssef Chebbi, Adila Bendimerad et Damien Ounouri,
Franssou Prenant, Hamé Bourokba et Ekoué Labitey)
Ashkal est un film de feu, un poème de cendre. Il n'y a de cendre que parce qu'il y a eu le feu et il n'y a feu que parce la cendre l'appelle. Le feu est promesse et la cendre est ce qu'il en reste. Tunis brûle-t-il ou bien est-elle une « terre de cendres et de larmes » comme en parlait Léautaud ?
Dans le film de Youssef Chebbi, le genre serait le feu et la cendre aurait son lieu. Le lieu qui est l'abri du feu, son foyer, est aussi le lieu consumé par lui. S'il y a ce qu'indique le titre (Ashkal signifie forme de l'arabe au français), la forme tire du genre policier les flammes d'une alchimie secrète et fantastique qui arrache des ruines d'un lieu (les Jardins de Carthage) les fragments d'un cinérarium. Un film de feu qui se donne, le don sacrifiant l'allégorie à beaucoup d'exigences mais l'holocauste est contrarié (le feu est puissant quand il est réel, moins quand le numérique en dématérialise le degré de concret). C'est aussi l'amitié de son auteur qui fait circuler dans l'abri de la forme, certes tentée par le monumental, l'esprit d'une dette secrète, un secret de cendre, indécidable.
L'imprononçable du sens au-delà du sens, inaccessible restance : Mohamed Bouazizi et d'autres ont brûlé pour moi, je brûle pour eux en échouant à faire de ce feu celui que je leur dois. Ashkal radiographie le chiasma optique de son auteur, un carrefour de formes qui est une croix de douleur.
La Dernière reine est un film zéphyr. D'un pied il se tient droit, de l'autre il balance, d'avant en arrière, d'arrière en avant. Le pied qui en soutient la charpente est son goût du travail bien balancé, ce professionnalisme auquel on ne goûterait guère, sinon quand l'esprit industrieux est un petit oiseau envolé de sa cage, qui souffle dans le désert en éclairant les ténèbres du cinéma en Algérie. L'autre pied qui balance essaie de faire tenir ensemble les bords opposés, traçant les arabesques nécessaires à relier le mythe et l'Histoire (Barberousse a existé ; pour Zaphira, le doute est là), l'épique et le tragique (avec une scène pour le cinéma de genre, pirates et aventures, et une autre pour le théâtre de chambre et la tragédie shakespearienne), le feu (Barberousse) et la glace (Zaphira). Une jambe masculine et une autre féminine pour un film exceptionnellement écrit-produit-réalisé par un couple franco-algérien, homme et femme à égalité dans l'autorité. Avec les eaux partagées de l'Histoire et du mythe, eaux divisées, eaux brassées et mélangées, il y aurait encore une troisième eau, et avec elle l'émergence dune troisième voie : la voix d'un cri étouffé.
Le hurlement d'un présent intolérable, le cri d'un enfant qu'on assassine. Le suicide qui répond à la violence en l'interrompant est un phantom thread dans l'étoffe algérienne. Le fil remonte à loin, aux confins de l'Histoire et du mythe et l'aiguille touche en plein cœur. Quand on se suicide en Algérie, ce serait toujours le geste de Zaphira que l'on répète. Refaire le geste de Zaphira, le rejouer permettrait ainsi d'échapper à tous les Aroudj de la terre, le petit flic zélé, l'administrateur tatillon, le chefaillon pénible, le fonctionnaire borné, le rival mimétique, le prochain qui vous rend constamment la vie impossible. Il n'en manque pas des Aroudj aujourd'hui, en Algérie comme ici.
Toutes et tous sommes reines et rois de royaumes qui suscitent les assauts de l'envieux, toujours coloniaux. Et pourtant. Sidi Abderrahmane at-Thâalibi, saint patron d'Alger issu de la même tribu que le mari de Zaphira, l'aura promis : dans ses épreuves mêmes, l'Algérie est un émerveillement.
Un spectre hante la France contemporaine, celui du colonialisme. Ce spectre hante depuis l'origine les images de Franssou Prenant. Il connaît aujourd'hui son point d'explicitation maximale, paroxystique, qui fait mal et dont le mal est nécessaire à la tradition des opprimés. Il n'y a pas, plus un plan signé Franssou Prenant où ne se ferait pas sentir la résonance du discours colonial assumant l'horreur de son projet. Le paradis perdu de l'enfance a des cavernes où vivent des dragons. L'enfance les voit, les entend, les affronte. Franssou Prenant entend et voit. L'origine dans les flaques d'eau et les ombres mouvantes, dans les contre-jours et à la surface des miroirs, dans les spirales et puis les girandoles, ce devenir qui se double d'un revenir : l'origine qui a été le paradis de l'enfance a été avant l'horreur coloniale. Mais l'enfance c'est aussi un miracle, l'émerveillement d'un peuple encore là. De la conquête est un film de salut public, un vrai de vrai, un grand, au sens où l'on entendait le terme de salut public à l'époque révolutionnaire, en l'an I du calendrier républicain.
L'air de rien, Rue des dames dame le pion à ce qui régente aujourd'hui le grand échiquier du cinéma français. Ce film, pas toujours bien chantourné mais toujours très inspiré, instruit néanmoins au sujet de ce qui est si peu raconté et documenté, à savoir l'économie grise des petits services rendus, ces coups de pouce qui ont pour revers des petits coups de pression, les coups tordus, coups de coude et de pied dans le ventre, et les décompensations qui en sont le solde de tout compte.
La négation est un empire
(Rabah Ameur-Zaïmeche, Radu Jude)
Que raconte Le Gang des bois du temple ? Une bande de grands gamins, aidés par un plus ancien, possible revenant du cinéma fraternel de Jacques Becker, se réjouit de frapper un grand coup en détroussant un prince saoudien. Comme ils ont tapé trop haut, on le leur rend au centuple.
Hier, les gosses appréciaient les crêpes que leur préparait la mère qu'au début du film M. Ponce enterre. Ils s'en contentaient et c'était bien comme il est bon de s'en tenir au PMU. Aujourd'hui, parce qu'ils ont osé péter plus haut que leur cul, les forts les sanctionnent, ils en ont bien les moyens qui les dispensent de toute vergogne. Si la punition est un rappel à l'ordre infligé aux petits qui ont eu la bêtise d'oublier qu'il y a plus fort qu'eux dans le banditisme, la correction revient à celui qui la met en forme avec une raideur sévère d'instituteur. La moraline est noire de chez noire parce qu'elle est coléreuse, bilieuse, venimeuse. L'ami si solidaire de ses pairs, des gamins de Clichy-sous-Bois comme lui l'a été à Montfermeil du côté des Bosquets, si sensible au milieu charnel de leur amitié, vire alors, furieux, en atrabilaire. Les sanctions tombent, expéditives. Oui, tout cela est exécuté.
Le commencement a pourtant l'éclat sublime d'Annkrist. Une immense découverte, une apparition astrale, la bouleversante éclosion d'un autre temps éclipsant le potentat tyrannique de l'actualité. La chanteuse dans la grande tradition du faubourg et des « fortifs », comme une sœur lointaine de Damia ou Fréhel, est une officiante, une prêtresse des temps oubliés. Son chant déploie ici-bas un grand pouvoir d'adoucissement et d'apaisement, même en plongeant dans les profondeurs de pierre du sépulcral. C'est qu'en effet nous sommes endeuillés de tant, et le marbre clair de sa voix est le soin nécessaire à vivre. Même quand la vie est intolérable, même quand est un règne l'irréparable.
Mais il y a des exécutions comme des cérémonies, dans l'emploi très symbolique d'un arbitre de paix, d'un tiers qui tranche à l'exemple de cet homme, même aussi beau et émouvant que M. Ponce (Pilate, forcément – c'est d'ailleurs le même acteur, Régis Laroche). Le voisin endeuillé de sa maman sera alors un ange protecteur (restons-en aux PMU et aux crêpes) autant qu'exterminateur (le tir à distance, à longue focale comme celle d'une caméra) parce qu'il dans la peau le rôle qu'il a joué, taiseux et sans forfanterie, dans les exactions dont la Françafrique demeure encore le nom.
L'écart est celui du plus grand danger, le risque encouru dans la confusion entre l'obscur et l'assombri. Le film de RAZ s'y frotte, on ne dira pas le contraire. C'est là qu'il est un poil-à-gratter, il contrarie et la contrariété invite à s'en expliquer. Mais il y a un hiatus entre l'assombrissement de l'époque, qui jette ses enfants en pâture à l'enrichissement qui les dévore comme Saturne, et l'obscurcissement de son témoin quand il cesse de « peindre du gris sur gris » (Hegel). Quand l'assombrissement est un noircissement censé dégriser, renchérir sur le noir tiendrait de la complaisance, autre dévoration saturnienne accordée à l'époque qu'elle voudrait pourtant critiquer.
« J'étais Hamlet. Je me tenais sur le rivage et je parlais avec le ressac blabla, dans le dos les ruines de l'Europe » : ainsi commence Hamlet-Machine (1977) de Heiner Müller. Aujourd'hui, un dos possible aux ruines de l'Europe se situe en Roumanie. Et N'attendez pas trop de la fin du monde d'en faire entendre le bruit de fond, tout le blabla d'une dévastation sur laquelle se penche le film de Radu Jude, entre vieille accidentologie et nouvelle toxicologie, tout en n'en réchappant pas.
Opposer à la saturation la décompensation, c'est répondre au nihilisme par le cynisme. L'horreur anthropologique des temps actuels serait malgré tout encore tolérable dès lors qu'un esprit en rigole en multipliant les traits d'esprit comme un droit de tirage – le discrédit à crédit. Le mal est fait, la négation est un empire. Mieux vaut en rigoler, il n'y a de toute façon plus rien de rien à rédimer.
Une dialectique unijambiste est un autre mutilé du travail qui tourne en rond dans la bouche d'un film mâchant et remâchant le néant. Dans le précédent film de Radu Jude, Bad Luck Banging or Looney Porn, toute la pornographique de l'époque était mobilisée pour déqualifier et banaliser une sex-tape qui, pourtant, y participait pleinement. Si les haïkus de Basho tombent en rafale lors du générique-fin de son nouveau, c'est en repentir d'un entreprise qui fraie gaiement dans le marigot en se contentant d'en rallonger la sauce. On était en droit d'attendre en terres roumaines un ABC de l'implosion capitaliste, Radu Jude se suffit d'un blablabla moderniste. S'appliquer à faire seulement de l'esprit avec le nihilisme, c'est se compromettre avec lui, surtout en y tenant la place du surmoi.
Monstres domestiques, monstres politiques
(Ari Aster, Alexandre Sokourov)
En 2011, Ari Aster tourne Beau, un court-métrage de sept minutes qui raconte l'histoire d'un homme ravagé d'angoisse à l'idée de revoir sa mère. Dix ans plus tard, il en reprend l'argument pour un film, Beau is Afraid, gonflé d'en durer 132 de plus. Entre-temps, Ari Aster a été couronné nouveau maître de l’horreur avec Hérédité (2018) et Midsommar (2019), précisément obsédés par l'idée de couronnement. La couronne revient aux élus qui peuvent ainsi troquer un legs de traumas familiaux saturés de religion contre un règne inattendu sur une communauté néo-païenne d'élection.
Le petit roitelet qui rêve alors si haut et fort d'être le nouvel empereur du genre après Stanley Kubrick revient avec un film monstre, plein de bourrelets et mal fichu qui, au moins, a le mérite de mettre la pagaille dans une ambition vissée par un esprit de système et le réflexe du monumental.
L’allongement du récit des bobos de Beau fait ainsi gonfler l'outre des ambitions spirituelles du gaz des flatulences qui les tournent en dérision. Le film pivote en particulier autour du motif de l'expulsion, cet ombilic dont la naissance porte la marque archaïque, pour montrer comment Beau est l'enfant qui n'a pas d'autre destin que d'être le sujet unique du royaume maternel, cet empire sans limite. La Mère (juive) est une impératrice despotique et le fils qui voudrait s'en émanciper échouera à la décapiter, motif asterien s'il en est à l'instar de la mère possessive à laquelle il finit parfois aussi par ressembler. Beau is Afraid tient à la fin de l'auto-sabordage, en cela il est très sincèrement désespéré. Une sincérité qui fait un sort aux pitreries lynchiennes et autres coenneries en intriguant davantage que Je veux juste en finir (2020) de Charlie Kaufman (et Joaquin Phoenix en poupon gâteux est un bien meilleur Joker). Côté grandes orgues, mieux vaut en effet la diabolisation des foirades d'Œdipe que les fanfaronnades de ceux qui n'en voient pas la mascarade (The Fabelmans).
Mad God de Phil Tippett, Beau is Afraid d'Ari Aster, il manque un Russe. Dans la vision esthète et eschatologique d'Alexandre Sokourov, l'élégie le dispute à l'apocalypse et la parousie côtoie l'attente du Jugement dernier qui n'a de cesse d'être différé. Si le 20ème siècle est celui des extrêmes, le siècle suivant n'en aurait toujours pas produit le jugement, voilà la vérité. Ce n'est pas que l'Histoire ne soit pas passée, c'est plutôt qu'elle se tiendrait tout juste à côté et la parousie (qui nomme le second avènement du Messie), alors, de n'être jamais tout à fait éloignée de la parodie.
C'est ce que montre Fairytale, audacieuse rumination en noir et blanc, de suie et de farine, qui projette un carré de grands hommes (Mussolini, Hitler, Staline, Churchill) dans un Purgatoire inspiré des peintures de Piranèse et d'Hubert Robert (à qui le cinéaste russe avait dédié un documentaire en 1996), les illustrations de L'Enfer de Dante par Gustave Doré et les allégories gravées d'Albrecht Dürer. Le geste anamorphique caractéristique du cinéaste connaît son dernier développement sous la forme d'un film d'animation qui indexe le stock des archives disponibles sur les principes de l'incrustation et du détournement par l'usage de technologies d'hyper-trucage du genre deepfake.
Entre ratiocination et bougonnement, le résultat est étonnant. Si l'on reconnaît le goût sokourovien du dictateur comme corps gâté et gâteux, l'opération est originale en accouplant deux hétérodoxies. Un : le consensus totalitaire est bousculé par l'intégration de Churchill, sorte de baron Harkonnen. Deux : l'archive est un legs d'images dont la vérité consiste à montrer qu'elles sont truquées, et déjà par les dictateurs eux-mêmes, fortiches en simulacres. Le totalitarisme à l'état diffus montre que le 21ème siècle préfère parodier le siècle précédent, plutôt que d'en sortir positivement en le jugeant.
Carnaval et son procès
(Lars von Trier, Marco Bellocchio)
L'Hôpital et ses fantômes est un divertissement qui fait diversion entre deux avertissements. Son auteur est un roi blessé qui arpente les terres vaines de son Royaume en y pompant toute l'eau au risque de s'y noyer. Car le carnaval à l'hôpital débouche sur le procès de son démiurge qu'il faut brûler parce qu'alors ses larmes pourraient sécher. Lutter contre le nihilisme placentaire de notre temps ne se fait ni sans crainte, ni sans tremblement. Avec cette troisième saison longtemps différée, le démiurge triomphe en sabordant sa série, naufrage et incendie. S'il y a sabordage, c'est que tout déborde pour le malade qui, comme Nietzsche l'a su, a la lucidité de savoir que la pire maladie de l'humanité tient à sa façon de combattre ses maux. L'auto-couronnement est celui du feu, une autre catabase infernale après The House That Jack Built (2018). C'est que le démiurge est lui-même, au terme de son dernier carnaval, Carnaval lui-même, le mannequin de paille qu'il faut brûler après avoir fait son procès. Sa série est son tribunal et s'il est parodique, il est non moins sérieux.
1978, l'Italie est sous haute tension. L'enlèvement d'Aldo Moro par les Bridages Rouges aurait pu mettre le feu à la plaine qui, alors, s'apprêtait à accueillir les mânes du « compromis historique » scellé entre la Démocratie Chrétienne et le Parti Communiste. Marco Bellocchio y est revenu par deux fois, avec un long-métrage en 2003 (Buongiorno, notte) et en 2023 avec une mini-série (Esterno notte). Le redoublement du retour mérite qu'on y soit revenu à notre tour, tant il est le marqueur d'une époque dont il semblerait que l'on ne soit toujours pas sorti. Aldo Moro, ce corps qui manque, apparaît ainsi comme un corps en trop, l'encombrant dont tous conviennent de se débarrasser. Avec un panache certain, mais quelques difficultés aussi, Marco Bellocchio approfondit son obsession, fixée dès son premier film : l'inachèvement historique de l'unité nationale italienne aura accouché d'enfants qui, interminablement, font dans leur chambre le procès de leurs parents. Le procès malheureusement se perd, avec L'Enlèvement, dans l'amphigouri opératique du style.
Dieu est une oreillette, et un illusionniste de Las Vegas son prophète
(Damon Lindelof et Tara Hernandez)
Si Dieu est par tradition une voix venue d'ailleurs, celle du Tout-Autre, il est un oreillette à l'ère de la communication planétaire et des télé-technologies. Damon Lindelof en avait eu l'intuition à l'occasion de l'avant-dernier épisode de The Leftovers (2014-2017) avec Tom Perrotta, il y revient avec Mrs. Davis, une mini-série en huit épisode coécrite avec Tara Hernandez, showrunner de The Big Bang Theory (2007-2019). Le melting-pot des obsessions du démiurge de Lost (2004-2010) et Watchmen (2019) y trouve son point d'ébullition auto-parodique, qui refait en plus hystérique ce que les frères Coen accomplissaient durant les années 90. Mythologies et pop-culture, totémisme animalier et fugues schizophréniques sont ici tant concassés qu'ils finissent en purée référentielle, comme s'il fallait pour Damon Lindelof se purger d'une postmodernité surmoïque, son daïmôn qui va jusqu'à hanter ses meilleures séries sans réussir, heureusement, à opérer sur elles son hégémonie.
La croyance en reste qui résisterait à un monde entièrement calculable, parce qu'il est gouverné par un algorithme, est un mirage dissipé dans l'abondante giclée des rebondissements sur-écrits, annihilant toute confiance dans le pouvoir rédempteur des écarts parallactiques (Lost), des suspensions du sens qui font vérité des trajectoires désorientées par l'événement insensé (The Leftovers), de la critique des violences auto-immunes de la police (Watchmen). Le Magicien d'Oz des réécritures gnostiques fait son Las Vegas Tour. Vivement qu'il reparte faire un tour en Australie.
Avoir revu tout Lost suffit à comprendre l'impasse de Mrs. Davis qui, trop emballé à faire bouillir son creuset de culture pop, échoue à soutenir la relation existentielle que l'on peut nouer avec des personnages de fiction, ces êtres immatériels qui demeurent les gardiens de nos plus secrets affects.
Excitantes exercitations
(Chantal Akerman, David Lynch, Frederick Wiseman,
Manoel de Oliveira, Glauber Rocha, Jacques Rivette, Béla Tarr)
Elle a dit une fois que le film lui était arrivé comme ça, dans la nuit, tombé d'un coup, calme bloc ici-bas chu d'un désastre obscur à l'instar de son jumeau, La Maman et la putain (1973) de Jean Eustache. Comment l'éclair a pu déchirer, et quelque peu éclaircir une nuit agitée, encore une parmi mille et une autres, toutes les nuits blanches et saturniennes qui ont fini par la dévorer toute entière.
Jeanne Dielman, 23, quai du commerce, 1080 Bruxelles n'est pas la radiographie, clinique et critique, des aliénations de la vie quotidienne et domestique, mais la rigoureuse cartographie d'un désir féminin dont la machine s'expose dans la singularité radicale de son architectonie. Et son autrice s'y est mise à nu en dépliant la carte de son désir, comme jamais. Le film de Chantal Akerman est un autoportrait ; son cinéma, une machine obsessionnelle et désirante, maniaque et paranoïaque, un machinisme parano-maniaque dont la carte mémoire n'exclut pas le réel mais sa jouissance, qui est le contraire de l'art, et qui est mortelle. Et elle savait que la perturbation ouvrirait la porte à la folle du logis qui rend la mort possible, impossible. Et l'impossible, un jour, est venu.
Jumeau monstrueux de Mulholland Drive, INLAND EMPIRE est mieux qu'un club Silencio hyper-sélect pour fans lynchiens acharnés. S'il est un film-monstre en assumant que le dédale mène au cul-de-sac, c'est comme exercice radical de spectrographie au nom de cette « inquiétante étrangeté de l'ordinaire » dont Stanley Cavell a parlé. L'aura hollywoodienne, ô combien dégradée, persiste toutefois dans la reconnaissance réciproque des stars déchues et des femmes abaissées.
Si Hollywood est une région impériale dans l'imaginaire mondial, pandémonium et gynécée, le rayonnement fossile rappelle aux étoiles qu'elles ne brillent qu'en ayant scellé avec leurs spectatrices une alliance de haute fidélité, elles qui les sauvent du discrédit en croyant à ce qui leur arrive et qui leur arrive aussi – ce trou pour toutes celles dont la vie aura mal tourné de part et d'autre de l'écran.
L'institution dit ce qu'il en est de ce qui est, sauf quand advient le réel qui l'empêche de coïncider avec elle-même. Cette non-coïncidence de l'institution a des incidences qu'emprunte Frederick Wiseman comme on descend au fond de la mine, comme une taupe creuse ses galeries.
Un film a valeur d'emblème, de paradigme : c'est Welfare. Le propre de l'assistance sociale y est saturé de toutes les formes de l'impropriété, mal-logement et chômage, addictions et pathologies, le porte-monnaie vide et la faim dans le pays le plus riche. À chacune des interactions entre agents et usagers, l'institution frôle la destitution. Une cour des miracles émerge au cœur de l'État-providence et l'on ne sait pas si c'est un miracle ou un cauchemar de voir persévérer l'institution à l'heure critique des nouvelles donnes. Welfare apparaît aujourd'hui comme l'archéologie d'une hégémonie du capital devenue planétaire et totale. Quand elle est gagnée par les plus riches, la lutte des classes renoue alors avec la violence de ses prémisses : la guerre aux pauvres y vaut de guerre à la pauvreté.
Dans Francisca de Manoel de Oliveira, les plans ont valeur de déposition et la frontalité théâtralise la rencontre du tribunal du jugement avec la médecine de civilisation. La visée alors y est celle du dépôt médico-légal en portant sur les nouveaux monstres d'un romantisme à l'agonie, qui ont la littérature et le dandysme pour se doter des permis de dire moi en se justifiant de faire n'importe quoi. Francisca organise la déposition littérale d'une classe dont la culture est le tombeau, au moins le catafalque. La cécité y est le fait des gens qui font en se voyant faire sans regarder ce qu'ils font. Le carré des amours frustrés finit alors avec un carreau dans le cœur de ses littérateurs.
Le trope des amours contrariés a pour soubassement tardivement révélé des amis qui sont aussi de perdition. Le cœur de Francisca appartient à un monde devenu une énigme à force de s'opacifier, et où le recours dandy à la littérature délivre au moi un permis de profaner tout ce qu'il aura sacralisé.
Le Dieu noir et le Diable blond est une chanson de geste qui a grande faim des grands écarts, du récit picaresque espagnol au théâtre épique brechtien, du western, ce genre hollywoodien qu'alors revisitent réalisateurs allemands et italiens, à la tradition littéraire des folhetos de cordel, du documentaire à tendance ethnographique à un fonds légendaire local, avec ses archétypes mythologiques, le retirante (Manuel et Rosa, paysans devenus parias), le beato (Sebastiaõ, le chef de culte exalté, mystique et messianique) et le cangaceiro (Corisco, le fier bandit de grand chemin).
Comme Glauber Rocha a les crocs, et comme son ventre crie famine, avant de bâfrer à l'occasion d'un banquet de carnaval : son esthétique de la faim le montre pyromane (il fait feu de tout bois) et anthropophage (citer, c'est assimiler et régurgiter). À lui tout seul une « Tricontinentale ». Glauber Rocha a faim mais la violence est plus vorace encore. Le massacre des innocents a de l'avenir, comme en a la violence des forts contre les faibles qui, un jour, voudront leur rendre la pareille.
L'Amour fou est une expérience, on en sort transformé. Pour une fois, l'expression n'est pas galvaudée quand, devant le film de Jacques Rivette, on voit ce que l'on n'avait jamais vu au cinéma.
Jamais vu Racine et Andromaque comme cela, jamais vu le rapport du théâtre tragique avec la vie moderne et la jeunesse de 1967, jamais vu le cinéma se faufiler ainsi dans les failles et trous de souris pour faire fuir les images selon une ligne de chant qui est la ritournelle d'une désertion avant le désert qui vient, et qui est omniprésent aujourd'hui. L'Amour fou, rené des cendres de la copie 35 mm. brûlée en 1973. Le feu, toujours, Jeanne et autres filles de feu revenues de Gérard de Nerval. Et Michel Delahaye qui joue ici le gouverneur Phénix. Les films de Jacques Rivette tournent, ils n'en finiront pas de tourner. Son cinéma brûle, il n'en finira jamais de renaître de ses cendres.
Les Harmonies Werckmeister : Béla Tarr ouvre le nouveau millénaire en y déblayant de nouvelles obscurités, un peuple décomposé sur les brisées duquel prospèrent tous les agitateurs en nihilisme, une Europe tellement contente d'en avoir fini avec le communisme qu'elle se jette dans le lit des nouveaux fascismes. Il y a toutefois les éclipses, un idiot qui voit des corps célestes dans les débris d'une taverne, un musicologue empesé de son savoir mais qui sortira de sa tanière pour découvrir la baleine qui fascine le premier avant la rupture et la folie. Chaque plan-séquence extrait de la matière brute du réel sphères et cosmogonies. L'attirail est lourd comme le cétacé, mais il est suffisamment inspiré pour arracher à la pesanteur de la nuit de foudroyantes clartés. Comme la honte qui, à l'encontre d'un État fascisant et policier, arrive à mettre un peuple-Léviathan à l'arrêt.
La vergogne est une antiquité, un reste immémorial comme une baleine. Le cinéma c'est la baleine aussi, c'est le cétacé confiant en un peuple qui se réinventerait en disant, redisant « c'est assez ».
On a eu la journée, merci, bonsoir
(Jean-Marie Straub, Mani Kaul, Jean Eustache,
William Friedkin, Jacques Rozier, Jocelyne Saab, Otar Iosseliani)
Vivre, c'est peut-être passer sa vie à répondre de son nom. Straub, sträuben : se dresser, résister. Se dresser contre tous les dressages culturels et sociaux qui abrutissent nos puissances. S'élever contre les pouvoirs qui vous abêtissent. Se lever et résister, se relever pour se soulever.
Au cinéma, on oublie trop qu'être assis en levant la tête prépare à nous relever à la fin de nos sièges.
Au cinéma, on oublie aussi que résister à la résistance d'un film, c'est-à-dire être réfractaire à la résistance d'un geste reposant sur la résistance de ses matériaux et la dialectisation de leur hétérogénéité, c'est déjà commencer à résister. Parce qu'il n'y a pas de forme sans la friction des matières et de l'idée qui, dialectiquement, les considère à égalité. On fait alors son miel de l'endurance nécessaire aux persévérances ultérieures. On rachâche ainsi la citation du père Brecht qui clôt Antigone, à l'époque où l'acier qui pleuvait en Irak contribuait au nom de la « paix » et du pétrole à fondre le plomb du chaudron actuel où nous nous consumons, à l'âge de Gaza sous les bombes et de la sixième extinction. « La mémoire de l'humanité pour les souffrances subies est étonnamment courte. Son imagination pour les souffrances à venir est presque moindre encore. C'est cette insensibilité que nous avons à combattre. Car l'humanité est menacée par des guerres vis-à-vis desquelles celles passées sont comme de misérables essais et elles viendront sans aucun doute, si à ceux qui tout publiquement les préparent, on ne coupe pas les mains. » On rachâche, donc, en repensant à la réponse donnée un jour à la question de savoir où Straub en était. Un chat en pousse un autre et lui prend la place. Et les câlins d'être dispensés au pauvre matou exproprié. La justice réclame exclamations et ponctuations sismiques, exigeante en poignes autant qu'en caresses.
Les films de Mani Kaul ont cette propension à souffler pour extraire du pétrifié des mouvements, dont les formes sont la signature des idées, l'éternité logée dans les creux du monde, la flamme d'une chandelle dans la moindre parcelle de réel. Un cinéma dont la virtuosité s'engouffre dans l'anfractuosité des bouches d'ombre qui parlent la voix impersonnelle de l'éternel. S'il y a mouvement, c'est par conséquent toujours aberrant. Le mouvement est alors faux-mouvement, les voix disloquées des corps et les raccords comme des failles tectoniques. Cryptogrammes et hiéroglyphes édifient le site des cryptes et des tombeaux en lambeaux. Et puis les esprits divaguant dans l'entre-deux, en nomades de l'intermédiaire, allant et revenant entre le sensible et l'incorporel.
Chez Mani Kaul, la discipline neutralise toute spontanéité, images et sons préservés des évidences mimétiques. Le naturel est un leurre qui fait écran aux passes immobiles de l'éternel. Dans cette perspective, dont la concentration est en visée de l'épure, le plan devient la surface d'inscription de pictogrammes mystérieux, des hiéroglyphes traçant dans le minéral leur déposition sacrale. Le film est la gravure des vérités dont le caractère sacré oblige les profanes à leur initiation mystique, le tracé mystérieux de secrets mutiques et illisibles sur des murs sans mémoire, oubliés de toute éternité, vieilles pierres légendaires ou surfaces polies et vitrifiées des grandes cités de la modernité.
La parole est aux hiéroglyphes qui parlent la langue muette des choses secrètes. La langue du désir a ses cryptogrammes, elle est une crypte, un mausolée abandonné. Et son souffle entre ses ruines de résonner à jamais. L'entendre n'est possible qu'en lisant ce qui s'écrit et qui ne se dit pas, un secret envolé dans une tempête de sable, étouffé dans un puits ou chiffonné dans les draps d'un lit défait.
Le cinéma de Jean Eustache multiplie les plis, il ramifie, des pairs qui poussent au triptyque, tous les remaniements de l'autobiographie. Son cinéma est plein de trous aussi (et d'emblée avec La Soirée, premier court inachevé) comme est troué le manteau de Spinoza.
Ça commence avec deux trous de balles (Du côté de Robinson) avant de finir avec un autre dans le cœur, la balle tirée un jour fatal de novembre 1981. Dans l'intervalle, le cinéma français avec lui se fait jactance comme jamais, avec ses beaux parleurs et ses mauvais coucheurs, ses cochons et ses charniers, ses enfants et ses monstres, ses machines de lecture et d'écriture, ses complots et machinations, du documentaire et de la fiction. Et puis l'archive des mondes disparus qui le sont toujours au présent, du sud-ouest des origines au Saint-Germain d'adoption, la face inséparable de son dos. Parce que tout est répétition, tout rejoue la division originaire entre les sexes comme dans le cinéma, fiction et documentaire qui font ses boiteries. Le manteau a trous et plis comme un lit.
Comme on fait son lit, on se couche et comme on fait un plan, on s'y couche dedans. On y creuse la mine – un abattage. On tombe sur un os – un abattoir. Faire un autoportrait comme on abat le cochon. Le cinéma est un lit que l'on fait pour refaire sa vie et s'y endormir au milieu de ses défaites, ses déchets. Le cinéma de Jean Eustache est un manteau aussi. Ce manteau-là n'est pas celui du Père Noël, c'est le duffle-coat déchiré d'un artiste, l'un des rares maudits du cinéma français avec Jean Vigo, Abel Gance et Jean-Luc Godard. Un cinéaste qui a si bien su jouer avec les cartes biseautées du social parce que son cœur en aura été tôt lardé. Si tout est bon dans le cochon – et les hommes d'être des porcs, et la vie d'être une cochonnerie –, tout est grâce mais elle est cruelle dans son rapport à la vérité. Car la cruauté ne trompe jamais et, toujours, le réel fait mal – à mort.
C'est le manteau revêtu par un garçon tombé dans un trou, et coincé dans un tuyau percé aux deux extrémités. Le dépucelage porte toujours déjà dans ses flancs l'annonce que la vie est un dépeçage.
William Friedkin, son cinéma confine la fiction pour mieux frictionner le cinéma de genre et l'ébouillanter. Isoler fait ainsi monter la température de la friture. La chambre de l'adolescente possédée, les backrooms d'une boîte SM gay, les vestiaires d'un match de basket-ball, la chambre d'un motel paumé d'Oklahoma sont l'indication que le huis-clos peut virer vite à la chaudronnerie.
Le lieu qui les emblématiserait tous, c'est le camion chargé d'explosifs de Sorcerer – Le Convoi de la peur (1977) qui, passé le pont de cordes et la pluie diluvienne, pénètre dans les confins lunaires de la République dominicaine. Si la nitroglycérine est l'extrémisation sorcellaire de l'adrénaline, les explosions sont néanmoins sous-tendues par une dynamique implosive plus profonde. La consumation des cendres prépare en réalité, et paradoxalement, à de terribles refroidissements. Les cloîtres brûlent en effet de se révéler des chambres bleues, toutes ces chambres froides à l'instar de celle de Regan. Le coup de semonce des mégafeux est bien l'annonce d'un nouvel âge glaciaire.
Il existe des films qui ont la grande inspiration de donner à respirer comme jamais. Le cinéma est un monde qu'il faut incessamment déconfiner et c'est bien ce à quoi Jacques Rozier aura travaillé avec un sens inné de la fantaisie, qui est celui d'une liberté hasardée comme une école buissonnière pour Robinson d'occasion et amateurs des arts flibustiers. Car il n'y a d'aventure que dans l'errance et l'improvisation, dont la visée est une gaîté détachée de toute prévision – une émancipation jouée. Le dernier long-métrage de Jacques Rozier, Fifi Martingale (2001), a été aussi son plus malheureux. Le film n'a jamais été distribué, seulement montré en catimini par Canal +. Il reste évidemment à redécouvrir même si son auteur rêvait d'en refaire le montage. Depuis, les rétrospectives ont célébré un génie fragilisé dans son existence, victime de problèmes de logement ses dernières années. Martingale, le mot ne serait pourtant pas anodin. Jouer la martingale est un coup, on double la mise que l'on a perdue lors du coup précédent. En mathématiques, la martingale qualifie également une séquence de variables aléatoires, autrement dit un processus stochastique.
La plus grande martingale de Jacques Rozier serait d'avoir souvent perdu en jouant ses films, mais c'était une feinte, on n'avait pas compris la stratégie, les variables aléatoires ont fonctionné. La mort expose l'immortel à sa vérité universelle. Aujourd'hui, c'est transparent, clair comme de l'eau de roche : Jacques Rozier a gagné, reconnu en l'égal des meilleurs disciples de Renoir et Vigo comme Godard. Le cinéma, lui, a perdu un poumon. Il va lui falloir désormais à réapprendre à respirer.
1975, le Liban part en morceaux. Il s'agit moins d'en accommoder les restes que de tenter, au moins en cinéma, d'en raccommoder les lambeaux. Partir en guerre contre les clichés d'un « Orient compliqué », c'est prendre position en n'oubliant pas que la position se montre en autant de prises de vue que d'écoute ; c'est allier aussi le souci de la lisibilité politique à une étonnante capacité de mobilité, qui est une agilité tactique, une poétique tirant sa nécessité devant d'écrasantes gravités.
Jocelyne Saab a ainsi la mobilité sauvage de l'enfance en prenant le parti des enfants de la guerre, et un sens du déplacement, de la capitale au Sud-Liban, protégé des captures de l'extrémisation des assignations communautaires et des antagonismes partisans et (géo)politiques. Une poétique située consiste en un singulier vagabondage, un maraudage parmi les ruines d'une modernisation du pire qui n'aura pas épargné le Proche-Orient, déblayant parmi les gravats pour trouver les signes de ce qui ne cesse de nous arriver. La sensibilité aux aguets de Jocelyne Saab, dans le dur désir de passer le gué du pire. Regarder le désastre sans être sidéré par lui, sans s'y ensevelir d'images pétrifiées.
Ses images sont des attestations vitales, de petites victoires, précaires et provisoires, sur la mort.
Pour cela, Jocelyne Saab n'oublie pas tout ce qu'elle doit au bouclier d'Athéna. Il y faut de l'enfance, qui est à la fois mobilité (entre les places et les assignations identitaires qu'elles localisent), agilité (tactique quand il faut aller partout et s'entretenir avec tout le monde, un art de négocier autant qu'un dur désir de refuser tout consensus ou neutralité au nom des prises de position dont témoigne la rhapsodie des films, en prises de vue et prises d'écoute) et curiosité (la connaissance est une thérapeutique, une affaire de cure, les images qu'il faut soigner ainsi que ce dont elles assurent la garde). Jocelyne Saab aime l'Égypte, elle y a tourné plusieurs films, de L'Architecte du Louxor (1986) à Dunia (2005). Elle sait que le Livre des Morts des Anciens Égyptiens s'appelle aussi Le Livre pour sortir au jour. Elle a fait du cinéma pour sortir au jour, et renaître avec un nouveau corps – le corpus de tous ses films. L'arche de celle qui aura tellement souffert du mal d'archive est une pyramide comme les archéologues en ont découvert de nouvelles, il y a dix ans, du côté de Louxor.
Mieux Otar que jamais. Otar Iosseliani est le cinéaste des métamorphoses et des métempsycoses, des affairements et des circulations dont les mobiles sont l'image de vérité d'un faux mouvement essentiel. Sa ritournelle préférée, c'est rire des rengaines de l'Histoire, des césures superficielles qui ne rompent en rien avec un fondement d'invariants sédimentés. Le plus grand risque d'un grand poète des cyclicités, travaux, jours et saisons, un hédoniste doublé d'un Hésiode de notre temps, aura été d'hypostasier ce qui devient en ne revenant jamais tout à fait au même.
Maintenant qu'Otar est parti, les années d'hiver semblent promises à durer plus que de raison, en donnant l'illusion de s'éterniser. Comme il fait froid, on se réchauffe alors en revoyant les films d'Otar Iosseliani, qui sont des chansons de saisons, avec leurs coins de campagne (Le Chant de la fleur introuvable, 1959 ; La Chute des feuilles, 1966 ; Pastorale, 1975 ; Euskadi, 1983), avec leurs musiciens et chanteurs (Vieilles chansons géorgiennes, 1969 ; Il était une fois un merle chanteur, 1970), avec les petits coins de paradis, perdus (Et la lumière fut, 1989) et maintenus (Un petit monastère en Toscane, 1988). Le cinéma ressaisi comme un art de vivre, qui réussirait à « tuer la psychologie [et] créer avec soi-même et avec les autres des individualités, des êtres, des relations, des qualités qui soient innomées. » (Michel Foucault, Werner Schroeter de Gérard Courant).
Ainsi, et comme le clame la vieille chanson géorgienne qui aura inspiré le titre de son ultime film : « C'est l'hiver, ça va mal, les fleurs sont fanées, mais rien ne nous empêchera de chanter ».
Pleine de grâce, Algérie !
(Narimane Mari)
Narimane Mari est la cinéaste de la tabula rasa parce quelle a mis l'enfance de son côté.
L'enfance n'est pas la puérilité qui en est la captivité abêtissante, c'est la capacité imaginaire au plus élémentaire déplacement. L'enfance ouvre sur place des brèches au possible, écarte dans tout lieu des espaces autres – nouvelle aire, nouvelle ère. Avec l'enfance, l'histoire redevient au carrefour des possibles un présent désirable, un devenir saturé d'anachronismes comme un coffre au trésor bourré d'explosifs. Tout est à reprendre à zéro, donc, parce que, si le monde n'a pas changé de base, le cinéma si – celui de Narimane Mari, qui est sa vérité basale, révolutionnaire et enfantine – Algérie !
Le bouillonnement d'enfance insurrectionnelle de Loubia Hamra, les grands soulèvements insulaires et tectoniques de l'utopie dans Le Fort des fous, le repos en terre qui est un mystère de Holy days et le deuil qui est une banquet d'amitié dans On a eu la journée bonsoir. Des films qui sont exactement au milieu du cinéma, de notre cinéma, à chaque fragment une exclamation, de chacun de leurs plans un éclat, un éclairement qui fait notre émerveillement. Des cristaux d'intensités pour d'étonnantes différences de potentiel – des bouts de ficelle, des rires et ritournelles.
La table rase, c'est vraiment ainsi que procède Narimane Mari, super nana de l'éternel retour qui a la grâce de sauver le oui, quand bien même règne partout l'empire du négatif. La vie ne serait pas la vie si elle n'était pas irrémédiable. Son jeu est une manière de bricoler de l'enfance dans l'incurable.

Retour à la liste des épiphanies
Jérémy Quicke
Retour sur une belle année de cinéma en dix films, et quelques circulations entre eux : la quête d’un espace où habiter ensemble, la simplicité, les glissements entre noir et blanc et couleur ou encore des figures décentrées (âne, pigeon, alien) pour retrouver un peu d’humanité.
La romancière, le film et le heureux hasard de Hong Sang-soo : nos épiphanies ont commencé au début de l'année avec Hong Sang-soo, Kim Min-hee, le noir et le blanc, les couleurs, et la salle de cinéma. Le film prend un malin plaisir à utiliser le noir et le blanc pour leurs valeurs propres, renforçant l'isolement de son personnage. Lorsqu'elle visite une tour dans l'après-midi, les fenêtres toutes blanches la mettent quasiment hors du monde, l'extérieur n'existe plus. L'apogée semble atteinte dans la salle de cinéma, elle est seule face à un écran ; la lumière s'éteint, reste un écran noir et des petites touches de blanc, nous pourrions presque tomber dans l'abstraction. Alors, le film dans le film, la couleur revient et accompagne les connections retrouvées avec le réel et avec l'autre. Il ne reste plus qu'à murmurer "je t'aime".
Venez Voir de Jonas Trueba : Le hasard du calendrier produit des belles rencontres pour les chercheurs d'épiphanies : la simplicité de la déclaration d'amour d'Hong Sang-soo a rencontré celle de Jonas Trueba, tournée cette fois vers l'amitié. Venez Voir est fait de presque rien, mais raconte tellement de choses. Et peut-être surtout cela : pour venir voir l'essentiel, il n'est pas besoin de savoir jouer au ping-pong. Mieux vaut renoncer au désir de maitriser totalement sa vie, de montrer des signes extérieurs de réussite matérielle ou familiale et déclarer forfait aux compétitions que le monde tente de nous imposer pour ne plus jouer que des matchs amicaux.
Voyages en Italie de Sophie Letourneur : la cinéaste possède elle aussi cette capacité à utiliser le quotidien le plus prosaïque pour en faire une matière de cinéma, ce qui s'incarne entre autres dans son utilisation toute simple du lit. C'est là que se trouve le moment qui nous a fait le plus rire : Sophie surprend Jean-Phi en train de se gratter les parties intimes. C'est surtout depuis le lit que la dernière partie prend une autre dimension en révélant le lien entre le voyage italien et ce que le couple s'en raconte au retour. L'événement et le récit qu'on en fait ne sont plus séparés. De plus, c'est dans ce même lit que le couple passe ensuite à l'acte pour la première fois du film. Se matérialisent devant nos yeux le plaisir et même l'érotisme de l'acte de raconter.
Désordres de Cyril Schäublin : Tout le film parvient à parler de manière singulière du monde ouvrier en utilisant la matérialité de la fabrication des montres, et en instaurant un rapport au temps très particulier. Alors que le film semblait illustrer cette logique de rentabilité du temps qui est de l'argent, le final propose une bifurcation très émouvante. C'est comme un nouveau récit qui peut commencer, mais qui était néanmoins sous nos yeux depuis longtemps. On aimerait tellement suivre ces deux personnages et rester encore un peu avec eux, hors du temps, hors du capitalisme qui a gagné depuis. Reste à rêver de pouvoir nous aussi arrêter notre montre et la pendre à un arbre.
Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese : Scorsese ajoute un nouveau chapitre à cette grande histoire que l'Amérique semble condamnée à devoir répéter : celle du paradis perdu. Le peuple Osage, chassé de ses terres originelles, pense retrouver un espace propice à habiter, incarné par le pétrole qui sort de la terre. Une fois de plus, il faudra faire le deuil de ce mythe, les flots du pétrole devenant vite ceux du sang et du poison qui les mènera à la mort. Un poison qui semble contaminer tout le territoire américain jusqu'à aujourd'hui. Reste seulement la possibilité d'offrir aux Osage le dernier mot le temps d'un film, avec une caméra qui monte au ciel et leur offre cette terre et l'espoir d'y habiter enfin pleinement.
Aftersun et Eternal Daughter : les beaux films de Charlotte Wells et Joanna Hogg peuvent peut-être dialoguer : il y est question d'une relation entre un parent et une fille en lien avec le temps, le souvenir, et l'ombre de la mort. Il y a également un rapport à l'espace qui continue de résonner après la séance. Un hôtel perdu dans la nuit de la campagne anglaise et à l'inverse le ciel bleu ensoleillé d'un centre de vacances méditerranéen : deux lieux de vacances et de célébration, que les deux réalisatrices vont déconstruire pour en révéler la part d’ombre. Joanna Hogg convoque l'imagerie des films de fantômes comme métaphore du deuil et de la transformation du souvenir. Charlotte Wells assemble des fragments de souvenirs de vacances traversés par la puissance de vie de Sophie, mais également hantés par le mystère de Calum et la menace de la séparation irrémédiable à venir. Les deux séquences musicales (karaoké, boite de nuit) sont superbes, mais pour continuer la circulation entre les deux films je voudrais terminer par ces deux belles chansons d'anniversaire ratées : Sophie qui convainc les autres vacanciers de chanter et tenter d'offrir une célébration à Calum, tout seul en haut des marches, et Julie qui révèle son secret en soufflant les bougies pour un contrechamp aussi simple que bouleversant.

Asteroid City de Wes Anderson : Wes Anderson pousse encore plus loin son mouvement fétiche : reconstruire un nouvel espace, assumant ses artifices, pour y faire habiter une famille recomposée. Le parti-pris est radical : la pièce de théâtre et les rôles joués sont en couleur, le réel est en noir et blanc en coulisse, caché derrière la surface. Tout le collectif convoqué ici va apprendre à se réconcilier avec le monde et avec autrui le temps d'un spectacle, grâce à une nouvelle maison trouvée temporairement - l'arrêt imposé dans Asteroid City - et grâce au personnage qui donne au film son pic émotionnel : l'alien. Figure la plus extrême du faux et de l'étranger, en deux apparitions et deux gestes, c'est bien lui qui permet à tout ce petit monde de retrouver un peu de vrai dans leurs vies.
EO (2022) de Jerzy Skolimowski : L'âne a quitté son enclos et erre dans la nuit. Il pénètre dans la forêt. L'eau scintille, une grenouille, une araignée et un hibou prennent des proportions gigantesques. Jerzy Skolimowski ressuscite rien de moins que les plus belles images de La Nuit du Chasseur. Une séquence sensorielle et onirique qui semble donner des yeux et des oreilles à la nature, et qui permet aux humains que nous sommes de regarder autrement le monde qui nous entoure. C'est dans ce décentrement du regard que se loge le cœur du film. Même si les chasseurs ne sont pas loin, l'humanité n'est pas encore tout à fait perdue si un âne peut rejoindre l'inconscient des enfants comme John et Pearl dans la forêt des songes immémoriaux.
Showing Up de Kelly Reichardt : Lizzie tente de s'atteler aux sculptures qu'elle doit terminer avant son exposition. En dessinant le portrait d'une artiste, Kelly Reichardt touche à des choses qui nous concernent tous : le désir de créer entravé par le manque de temps, les obstacles du quotidien, le monde extérieur qui vient se rappeler à nous. Le film est rempli de détails très drôles et terriblement justes sur nos petites imperfections comme un pigeon blessé que l'on balance par la fenêtre ou des feuilles d'un buisson que l'on arrache de manière ridicule parce que l'on est énervé. Lizzie va accepter d'intégrer les imperfections du réel dans sa vie et dans son art, à la manière de sa sculpture ressortie à moitié brûlée du four. Finalement, le pigeon peut s'envoler, et les deux femmes peuvent quitter la salle de l'exposition et marcher paisiblement à la rencontre du monde extérieur, comme pour inviter le spectateur à faire de même en sortant de la salle de cinéma.
Retour à la liste des épiphanies
Marius Jouanny
Hollywood - Deux ruptures et deux belles retrouvailles
L’an passé, je râlais contre l’industrie du cinéma américain de moins en moins capable de laisser s’infiltrer des visions d’auteurs parmi ses productions. Grâce à la plus grande grève du secteur depuis des décennies, on sait maintenant qu’Hollywood menace de remplacer ses scénaristes par une intelligence artificielle. J’ajouterai donc à mon soutien inconditionnel aux grévistes une petite remarque un brin désabusée : un scénariste de Netflix ou Disney doit-il vraiment s’étonner que son poste devienne à terme remplaçable par un robot, alors qu’il est déjà interchangeable avec celui de community manager ?
Je vous laisse méditer là-dessus tandis que je sors de mon chapeau deux cinéastes américains qu’on ne peut pas soupçonner a priori d’être les ventriloques de ChatGPT et Midjourney : Christopher Nolan et Wes Anderson. Pourtant, l’un et l’autre m’ont déçu pour la troisième fois consécutive avec leurs nouveaux films Oppenheimer et Asteroid City. Ces deux visionnages m’ont d’autant plus plongé dans l’embarras qu’il s’agit de deux réalisateurs décisifs dans la construction de ma cinéphilie adolescente. À 25 ans, mes goûts auraient-ils à ce point changé ? Comme le scientifique qui met fébrilement son hypothèse à l’épreuve du réel, j’ai revu Interstellar, La famille Tenenbaum et Moonrise Kingdom, pour me rendre compte que j’aimais toujours autant ces films. Bien qu’ils n’aient pas radicalement changé leurs styles, le problème réside bien dans ce qu’est devenu le cinéma de Nolan et Wes Anderson ces dernières années.
Autrement dit, comment s’opère la transformation d’un geste de cinéma en mimiques lassantes ? La réponse est plus simple pour Nolan, qui coule sa mise en scène dans le moule du genre biopic, ce qui en accentue les faiblesses. On peut dire ce qu’on veut de The Dark Knight, Inception et Interstellar, mais on ne pourra pas leur enlever le souffle épique qui les anime, ni les questionnements moraux passionnants que traversent leurs héros. En tentant de retrouver ces mêmes qualités sur une production « inspirée de faits réels », Oppenheimer espère charger le scientifique inventeur de la bombe atomique d’une aura particulière. De prime abord, l’intention ne paraît pas aberrante, puisque le personnage a le poids de l’Histoire et de l’holocauste nucléaire sur les épaules – ce n’est pas rien. Cette thématique charrie d’ailleurs les quelques scènes réussies du film. Pour le reste, les déboires anecdotiques du physicien avec les pouvoirs publics révèlent toute la lourdeur du dispositif de Nolan, qui entraîne son personnage par le fond en voulant l’élever avec les grandes pompes et l’emphase de sa mise en scène. Au passage, que peut-on attendre d’un film qui attribue à Marx la citation « la propriété, c’est le vol » qu’on doit plutôt à Proudhon ?
Pour Wes Anderson, le glissement est plus subtil car son cinéma n’est pas coulé dans d’autres moules que celui qu’il a lui-même patiemment façonné, en léchant ses décors et ses compositions au point de rendre ses plans instantanément reconnaissables. Voulant célébrer la maîtrise de son dispositif, Wes Anderson s’obstine dans la stratégie du toujours plus – je ne prendrais pas la peine de lister toutes les stars qui apparaissent dans Asteroid City. C’est peu dire que la narration se retrouve éparpillée façon puzzle, sans qu’un personnage ou une émotion ne réussisse à se détacher de la masse. Dans ce contexte, la fascination du cinéaste pour les figures de surdoués et autres petits génies révèle toute sa superficialité. Sa clique d’enfants inventeurs distingués devient même irritante lorsqu’elle se prend au jeu du name dropping et de l’exhibition intellectuelle.
Avec Chris et Wes, nous ne vieillirons pas ensemble, puisque je n’irai plus voir leurs prochaines réalisations, qui peuvent bien être confiées à une intelligence artificielle – elle ne fera qu’acter la détérioration de leur cinéma en marque labellisée. Les nouveaux films de Spielberg et Scorsese pourraient encore plus facilement se ranger du côté des déceptions. N’ayant plus rien à prouver au crépuscule de leurs filmographies, Stevy et Marty optent pour un classicisme sans fioriture, un rôle de storyteller qui bride quelque peu l’inventivité de leur mise en scène. Certains y voient un peu vite un cinéma de la déférence : celle envers la fabrique du cinéma et John Ford pour l’un, et celle envers son sujet (la série de meurtres subie par la tribu Osage au cours des années 20) pour l’autre. Dans ce cas, comment expliquer a contrario le plaisir de cinéma que j’ai ressenti au cours du visionnage de The Fabelmans et Killers of the Flower moon ?
Il faut pour cela m’attarder sur les effets souterrains produits par ces deux films, diamétralement opposés aux effets de manche de Wes Anderson et Nolan. L’exemple le plus marquant au cours de la dernière partie de The Fabelmans réside dans la recomposition des clichés de films de campus, que Spielberg convoque avec le prisme de l’antisémitisme. Son alter-ego Sammy se retrouve harcelé d’un côté par la grosse brute sportive Logan, et fétichisé de l’autre par sa petite amie Monica, dans les deux cas à cause de ses origines juives. Mais lorsqu’il est chargé de réaliser un film de fin d’année sur une sortie à la plage de sa classe, Sammy tient sa revanche. Par des effets de montage et de gros plans ostentatoires quasi-érotiques sur le corps de Logan, il déforme à sa guise et essentialise l’image de son harceleur, retournant le stigmate avec ses propres armes cinématographiques. La reprise des codes éculés du teen movie trouve ainsi une épaisseur et un sous-texte ingénieux qui dépasse l’hommage narcissique à l’art du cinéma.

Alors qu’on l’attendait sur le terrain de la grosse machine formaliste, fresque cruelle et violente sur la fondation des États-Unis dans la lignée de Gangs of New York que Scorsese avait d’ailleurs prévu de continuer sur une trilogie, Killers of the Flower Moon joue sur un autre tableau. À l’image des meurtres relatés, le film se déploie sans en avoir l’air, en égrainant des scènes qui semblent toutes d’une longueur égale, sans recherche d’une virtuosité stylistique. Passé la déception du spectateur-qui-en-veut-pour-son-argent, force est de constater que le dispositif sied très bien à la relation d’amour/oppression entre Ernest et sa femme osage Mollie. Pas d’effusion, mais plutôt une tendresse muette et une violence sourde qui s’entremêlent insidieusement. À pas feutré, Ernest Buckhart s’impose comme une figure de bourreau pathétique et profondément touchant, similaire à celle de Frank Sheeran dans The Irishman. Loin de passer en mode pilote automatique, Scorsese sait donc très bien ce qu’il fait en explorant dans ses deux derniers films une mise en scène de l’effacement, qui culmine durant l’épilogue beau et inattendu de Killers of the Flower Moon.
Cinéma par temps d’orage
Face aux multiples désastres en cours et à une actualité toujours plus maussade, plusieurs films de cette année proposent d’adopter différentes postures, comme autant de choix stratégiques ou de voies de salut pour affronter notre époque. À ce titre, Les herbes sèches de Nuri Bilge Ceylan est exemplaire car il déploie à travers ses personnages principaux deux attitudes opposées sans privilégier l’une sur l’autre, laissant le spectateur libre d’adhérer (ou pas !) aux arguments des personnages. Les longues et passionnantes scènes de discussion entre Samet et Nuray circonscrivent ainsi les figures du professeur désabusé et de la militante engagée en prenant à bras-le-corps leurs implications morales et politiques. Derrière la caméra, Ceylan trouve la bonne distance pour confronter ces points de vue : il rend compréhensible et intensément empathique les explications et les choix des deux personnages, tout en restant assez elliptique sur leurs trajectoires biographiques. La voie ainsi tracée évite l’écueil de la psychologisation ou du regard moralisateur. L’intégrité de Samet et Nuray se maintient au cours d’une relation dialectique qui réserve son lot de beauté et de bassesse. Bien qu’il soit tentant de tomber dans une certaine réprobation morale face au cynisme de Samet, difficile de ne pas faire corps avec son désespoir. De l’autre bord, la dimension sacrificielle du combat politique de Nuray peut laisser autant admiratif qu’interloqué. Au fur et à mesure que les positions s’exacerbent, les contradictions que composent cette union des contraires se révèlent indépassables. En sortant de la séance, je me reconnaissais davantage dans Nuray et mon père dans Samet, mais nous avions le sentiment partagé d’une égale et profonde compréhension des deux subjectivités mises en tension.
D’autres films de 2023 proposent des portes de sortie à ce sentiment d’absurde que Ceylan plie et déplie sans relâche pendant 3h 15. Contre notre régime néolibéral, Radu Jude choisit par exemple la distance ironique, la subversion par la farce. Dans N’attendez pas trop de la fin du monde, le mode de résistance de la conductrice Angela uberexploitée par une entreprise d’équipements de sécurité se révèle jubilatoire. Épuisée par ses semaines de boulot interminables, elle s’invente un personnage obscène au langage très fleuri qui publie des vidéos à longueur de journée sur les réseaux sociaux. Plus qu’une catharsis, il s’agit d’une opération d’anti-communication qui s’apprécie en miroir du projet de film promotionnel de l’entreprise en question sur lequel Angela travaille. Ces derniers utilisent le témoignage biaisé d’un accidenté du travail pour apporter une morale édifiante sur la sécurité. En arrière-plan du tournage, Angela se filme déversant un flot de vulgarité qui ébranle l’hypocrisie de la multinationale. L’impact brut de ses « story » n’a rien à envier à la sextape d’Emilia dans Bad Luck Banging or Loony Porn. Radu Jude radicalise ainsi son esthétique de l’obscène, lorgnant vers un anticapitalisme joueur et outrancier.
Après le visionnage d’un tel film, difficile de croire encore dans un projet politique de transformation sociale. C’est là toute la limite de la farce et du recul ironique qui s’épuisent dans la négativité, même si celle-ci reste bien féconde. À l’inverse, trouver un rapport à l’image qui suscite de l’espoir et de l’adhésion à une alternative au capitalisme reste une autre paire de manche. Sur ce credo, les documentaires que Mila Turajlic consacre au cameraman du président communiste yougoslave Tito forcent l’admiration. Ses deux derniers opus Ciné-guérillas et Non alignés, sous titrés Scènes des archives Labudović, explorent un temps pas si lointain où tout semblait encore possible. Les plans de liesses populaires au cours de la conférence de Belgrade en 1961 touchent du doigt la joie pure théorisée par Simone Weil. Il faut imaginer l’enthousiasme et la rigueur de Stevan Labudović derrière la caméra, une énergie qui semble toujours l’animer un demi-siècle plus tard lorsqu’il formule face caméra des remarques sur les choix de cadrages de Mila Turajlic pour son documentaire. Évidemment, compte tenu de l’échec du mouvement des non-alignés et de l’enlisement de la Révolution algérienne, difficile de ne pas ressentir une mélancolie de gauche au terme du visionnage. Si cette mélancolie n’a rien de démobilisatrice en soi, son efficacité politique reste discutable.
Pour susciter un engouement politique plus direct, d’autres réalisateurs se risquent à emprunter des voies plus balisées, en utilisant des formes cinématographiques dominantes auxquelles ils injectent un message subversif. Cette démarche de contrebande est poussée à son paroxysme par Daniel Goldhaber dans Sabotage, qui utilise toutes les ficelles du thriller pour célébrer le passage à l’action d’un groupe d’écologistes radicaux. Face à une telle proposition de cinéma, il est bien facile pour le spectateur distingué de faire une moue réprobatrice en pestant contre cette société du spectacle qui passe à la moulinette hollywoodienne les velléités léninistes d’Andreas Malm (son livre de théorie politique Comment saboter un pipeline a inspiré le film). Mais si ce spectateur distingué réfléchit en termes d’efficacité stratégique, il n’est pas impossible qu’il se ravise face à un récit qui reste crédible et ne romantise pas à l’excès l’activisme radical contre le capitalisme fossile. Essayez seulement de vous rappeler le précédent film aussi largement distribué qui articule sans pudeur de gazelle ni moralisme surplombant la question de la violence politique...
Du côté du cinéma français, la forme convenue du biopic s’est intéressée cette année à deux figures passionnantes de l’extrême-gauche des années 70 : Pierre Goldman dans Le procès Goldman et Robert Linhart dans L’Établi. Inutile de dire que ça change de Bernard Tapie, Bernadette Chirac ou De Gaulle ! Si ces deux films se démarquent surtout par leurs sujets, l’épure formelle du premier montre une certaine modestie qui se révèle efficace pour rendre hommage à une personnalité comme celle de Pierre Goldman. Au-delà du label « biopic historique édifiant », ces films ont le mérite de rendre intelligibles deux sujets politiques à l’engagement total, en laissant la possibilité au spectateur de considérer leur combat politique toujours actuel.
Cinéma de la douceur
À rebours des films précédemment cités, il faut savoir reconnaître la préciosité du cinéma qui fait la part belle aux éclaircies. Pour éviter d’emblée tout malentendu, je ne cherche pas à valoriser une prétendue fonction réparatrice ou curative de l’art et la culture qui existeraient pour nous faire du bien et nous dorloter. Misère du feel-good movie qui n’a rien d’autre à proposer qu’1h30 de bons sentiments. Un cinéma de la douceur ne propose pas d’idéal voguant au-dessus du monde matériel, mais il se contente de montrer la beauté de celui-ci. Il ne fait pas abstraction de l’adversité et de la brutalité. Il sait seulement ménager des espaces, des pulsions de vie dans lesquels la douceur peut s’engouffrer au gré des intempéries.
C’est toute l’opération du dernier film d’Aki Kaurismäki, qui sort de sa retraite pour réaliser Les feuilles mortes. Amorçant la rencontre amoureuse de deux personnages, il s’évertue à leur mettre des bâtons dans les roues tout au long du récit pour que puisse advenir une rencontre et la naissance d’un couple. Nul sadisme ici : les problèmes sentimentaux de Holappa et Ansa reflètent leur difficulté à joindre les deux bouts et à subir l’exploitation salariale. Ainsi, l’atmosphère romantique ne risque pas de tourner à la niaiserie, mais instaure au contraire un jeu d’ironie avec l’adversité qui prend de multiples formes : numéro de téléphone égaré, alcoolisme, licenciements abusifs, coma suite à un accident… Le moindre effet dramatique se retrouve désamorcé par la douceur qui contamine même les objets (vieux transistor, téléphone à roulette).
Invoquer la figure du couple amoureux reste le motif le plus attendu pour que survienne la douceur au cinéma – et pourtant, impossible de s’en lasser. Le retour des hirondelles de Li Ruijun par exemple active une situation éculée du drame romantique : l’amour et la concordance naissant d’un mariage de raison entre deux personnages mal assortis. Aucun discours amoureux ne vient se greffer autour de ces deux paysans taciturnes et méprisés de tout le village. La réussite du film tient dans un rejet de l’idéalisme des grands sentiments au profit d’opérations matérielles simples et bouleversantes. Lorsque Ma Yutie et Cao Guiying se cuisinent mutuellement de la soupe et de la brioche, qu’ils construisent un nid d’oiseau dans leur piaule sommaire, la rudesse de leur mode de vie semble s’effacer. Les désagréments quotidiens eux-mêmes peuvent constituer des moments de douceur, comme lorsqu’ils doivent sortir en pleine nuit par gros temps pour couvrir de la pluie des briques en terre construites durant la journée. D’abord pathétique, la scène change de registre quand le couple s’enlace et se réconforte en pleine tempête.

La douceur au cinéma passe le plus souvent par le corps des personnages, ses gestes et ses points sensibles. Dans le dernier film de Kelly Reichardt Showing Up, tout repose sur les mains de Lizzie qui sculpte des corps miniaturisés dans l’intimité de sa maison. Sa vie familiale et professionnelle a beau être traversée par de multiples contrariétés, toute pesanteur s’évanouit lorsqu’elle met la main à la pâte. Chaque sculpture représente la somme des gestes et caresses que l’artiste consacre à son œuvre. Rares sont les films à restituer la matérialité d’un processus de création avec une telle attention. Ce motif des mains créatrices se retrouve plus furtivement dans le film d’animation en stop-motion Interdit aux chiens et aux italiens de Alain Ughetto. Durant quelques instants clés du récit, le processus d’animation est révélé par le passage impromptu des mains du réalisateur qui vient toucher les personnages en pâte à modeler issus de son histoire familiale. En filmant les gestes de l’artiste qui modèle son œuvre, ces deux films proposent en fait toute une éthique du processus de création. La pièce prend forme par petites touches, comme si l’artiste devait respecter l’intégrité de son œuvre ou des personnages de son récit en les traitant avec une distance et une douceur mesurées.
Quelques rayons verts
Puisque le cinéma est parait-il un art capable de créer des souvenirs, il est toujours utile de plonger dans sa besace, histoire de voir ce qu’il en ressort. Cette année, quelques rayons verts sont restés gravés dans ma mémoire. Je me souviens de Thomas Salvador explorant les entrailles des sommets alpins aux côtés de mystérieuses créatures minérales rougeoyantes dans La Montagne. Je me souviens de l’image d’un ancien acteur célèbre devenu concierge amnésique d’un hôpital psychiatrique dans Fermer les yeux de Víctor Erice. Je me souviens de la bêtise attendrissante des perruches affamées dans Le garçon et le héron, une belle trouvaille du dernier Miyazaki fraîchement sorti de sa retraite à l’instar de Kaurismäki. Certes, leurs nouveaux films respectifs ne renouvellent ni leurs thématiques ni leur mise en scène, mais je leur pardonne sans hésiter tant ces retrouvailles constituent un grand plaisir de cinéma. Je me souviens des moments tendres d’amitié masculine au bistrot dans Le gang des bois du temple de Rabah Ameur-Zaïmeche. Je me souviens des instants de langueur au bord de la rivière dans L’Envol de Pietro Marcello. Je me souviens d’un fabuleux plan-séquence de trajet en moto dans L’arbre aux papillons d’or de Pham Thien An, comme une réponse à celui de Kaili Blues de Bi Gan. Je me souviens enfin de l’apparition finale des humains devenus animaux réfugiés dans la forêt, bientôt réprimés par l’armée sous un déluge de gaz lacrymogène dans Le règne animal de Thomas Cailley.
Retour à la liste des épiphanies
Pierre Mathieu
Épiphanies 2023 : Sororité(s)
L’année 2023 aura été riche de films stimulants, voire puissants, portés par des réalisateurs ou réalisatrices souvent confirmés (Catherine Breillat pour L’Été dernier, Hayao Miyazaki pour Le Garçon et le Héron, Marco Bellochio pour L’Enlèvement, ou Todd Field pour Tár) ou en devenir (Tina Satter pour Reality). Ces œuvres cinématographiques se sont confrontées à des sujets complexes et résolument ambitieux (l’inceste, le mythe des origines, l’antisémitisme atavique, la tyrannie entremêlée au génie créateur ou la révolution politique qui peut naître chez tout un chacun) autour de parti-pris formels parfois radicaux, mais celles que je retiendrais figurent trop peu ou pas dans les sacro-saintes listes de fin d’année de la critique institutionnelle, peinant souvent à se frayer une petite place entre les volumineux Scorsese et Spielberg.
Il s’agit de Casa Susanna, de Sébastien Lifshitz, Toute la beauté et le sang versé de Laura Poitras et Les Filles d’Olfa de Kaouther Ben Hania. Ces trois films ont en commun de se situer sur le terrain documentaire, à des degrés différents, et laissent à l’écran une place énorme à leurs sujets féminins, soit que le réalisateur ou la réalisatrice s’effacent au profit de l’histoire et des protagonistes qu’ils racontent, soit qu’ils s’épanouissent dans le dialogue avec celles qu’ils filment, se faisant presque absorber et remodeler dans l’épiphanie qui naît de ces rencontres. Ces portraits de femmes, travesties ou transgenres, voilées ou anciennes accros aux opiacées, photographes mondialement reconnues ou vivant de ménages dans la Tunisie de Ben Ali, rentrent singulièrement en écho ; ces films nous enrichissent, spectateurs ou spectatrices, grâce à la complexité et aux ambiguïtés des multiples trajectoires au féminin qu’ils épousent. Ils nous redonnent du souffle dans la morosité que l’on sait, car ils nous rappellent tous trois que les figures les plus utopiques et les plus bouleversantes ne sont pas que des êtres que la fiction invente à renfort d’images.
Casa Susanna de Sébastien Lifshitz : la maison des bois
« Aucun de ces arbres n’était là la dernière fois que je suis venue ». C’est sur une route qui serpente entre les arbres des forêts couleur d’automne des Catskills, dans l’état de New York, que nous guide la voix chevrotante et émue de Katherine – née John. Face à la petite maison qui se trouve au bout de ce chemin, encore intacte, elle se rappelle la balançoire disparue, et ce week-end d’Halloween 1962 où Virginia Prince a fondé, dans ce même lieu, l’association de travestis nommée ETP : Expression Totale de la Liberté. La Casa Susanna est cette maison où, sous la houlette de Tito Arriagada (Susanna quand il se travestit) et de sa femme, Marie, s’est constituée la première communauté américaine de travestis dans les années 1960, un hameau de paix et d’expression pour des hommes venus des quatre coins du monde. C’est à partir de clichés retrouvés par Robert Swope dans une brocante new-yorkaise en 2004 représentant les hommes travestis des Catskills, et du livre que l’antiquaire publie pour les visibiliser, qu’est né le projet documentaire de Lifshitz. Son film entretisse ces nombreux clichés photographiques et le pèlerinage de deux anciennes habituées de cette villégiature aux allures d’utopie, Katherine Cummings et Diana Merry (née David), qui ont toutes deux fait leur transition depuis. L’évocation de leurs souvenirs permet une plongée sensible dans leurs histoires personnelles et collectives, et nous ouvre les portes d’un lieu longtemps clandestin. Le documentaire nous sensibilise également à la complexité de ces existences dissimulées, et nous surprend : les femmes de certains habitués étaient pleinement intégrées dans la communauté, à l’image de Marie, qui, soucieuse du bonheur de son mari, Tito, était même la première artisane de ce havre de paix queer ; Donald Wollheim, écrivain reconnu de science-fiction, s’y rendait fréquemment en compagnie de son épouse, si ce n’est encouragé par elle. Le film nous informe, plus encore, sur les disparités qui modèlent la communauté queer de l’époque, certains hommes trouvant dans le travestissement une forme d’expression sans remettre aucunement en question leurs vies parallèles, souvent traditionnelles et maritales, quand d’autres rêvent résolument à une transition de genre. La grande réussite de Lifshitz tient ainsi tout autant à sa capacité d’exhumer ce passé précieux qu’à son souci de le décliner au présent, à travers notamment la réunion des anciennes occupantes de la Casa Susanna et de leurs descendants. À Katherine et Diana s’adjoignent Betsy Wollheim, fille de Donald, et Gregory Bagarozy, petit-fils de Marie. Sous nos yeux, ils jettent un pont émouvant entre deux époques et reconstituent une communauté. Ils nous rappellent que l’utopie, loin d’être une nostalgie, était et reste vitale.
Toute la beauté et le sang versé de Laura Poitras : l’œilleton et la focale
Laura Poitras, documentariste oscarisée pour son travail sur Julien Assange dans Citizenfour (2014), cherchait initialement à mettre en lumière le combat du collectif américain PAIN (Prescription Addiction Intervention Now), autour des actions spectaculaires et médiatisées qu’il organise dans les nombreux musées ou universités prestigieuses qui bénéficient du mécénat coupable de la richissime famille Sackler ; au cœur de PAIN, le combat acharné qui cherche à dénoncer et à faire reconnaître les ravages de l’Oxycontin, un opiacé hautement addictif qui a causé la mort de centaines de milliers d’américains, tout en condamnant les survivants à la dépendance lourde ou à la toxicomanie. Aux milliards engrangés par le laboratoire pharmaceutique Purdue Pharma, dont les Sackler sont la principale famille d’actionnaires, les militants de PAIN opposent des hapenings spectaculaires et inspirés : la fontaine du Louvre se gorge de colorant couleur sang, les fausses prescriptions maculées de rouge déferlent en spirale depuis les hauteurs circulaires du Guggenheim. L’œil expérimenté qui guide ces actions n’est autre que celui de Nan Goldin, photographe mondialement reconnue du New York underground des seventies et des eighties.

Cherchant à dresser le portrait de cette militante haute en couleurs pour mieux comprendre son collectif, Laura Poitras dérive naturellement vers son travail photographique, qu’elle creuse et restitue à l’écran sous la forme de diapositives sobrement commentées par l’artiste. Cette traversée visuelle et chronologique, qui structure le film en six chapitres – chacun s’ouvre par un diaporama –, éclaire la vision unique d’une femme qui n’a eu de cesse de se définir pour et par le collectif : au sein de la communauté queer et des drag shows des seventies, chez Act Up au cœur des années SIDA, avec PAIN quand elle est elle-même rattrapée par la dépendance aux opiacés.
La beauté renversante du documentaire de Poitras est ainsi liée à cette double trajectoire qui, tout en nous familiarisant avec l’œuvre passionnante et singulière de Goldin, nous ramène vers le sens profond de ce qui fonde toute démarche artistique et politique (les deux apparaissant inextricablement liés à l’écran). Pensant parler de cette photographe qui la fascine par sa rage vitale, Poitras approche la dynamique même des luttes qui traversent les quatre décennies évoquées par le film. Elle est comme juchée sur les épaules d’une ainée qui oriente son regard. Il n’y a ainsi, dans ce film, plus de sujet ou d’objet, mais deux visions féminines qui semblent se reconnaître mutuellement dans la quête de l’image intime et politique.
Les Filles d’Olfa de Kaouther Ben Hania : quatre et un font huit.
Eya se tient assise sur le lit, juste devant sa petite sœur, Tayssir. Allongée, une seringue encore à la main, son beau-père, Abderrahmane, semble déjà anesthésié par les effets de la drogue qu’il vient de s’injecter. Eya, qui joue avec le grand couteau de boucher qu’elle tient à la main, interpelle alors dans une longue diatribe cet homme faible et pervers, qui, sous couvert d’aimer sa mère, abuse sexuellement d’au moins une de ses belles-filles. Soudain, l’homme se redresse à l’écran et s’adresse à la caméra et à la réalisatrice : « Il y a quelque chose qui me gêne. [...] Ça ne va pas être une matière filmique. Ça va être une discussion entre toi et moi, dehors ». Pour cause, l’homme allongé, contrairement aux deux jeunes filles assises sur son lit, est un comédien, perturbé par l’intensité des confessions traumatisantes et de la rage de la cadette des filles d’Olfa.
Le film documentaire de Kaouther Ben Hania a cela de passionnant qu’il se construit autour d’un dispositif sophistiqué, à cheval entre la mise en scène et l’exigence de vérité du documentaire. Il évite ainsi les pièges lacrimaux et voyeuristes du docu-fiction traditionnel, et ce au profit d’un dialogue sur le vif entre le réel et le souvenir recomposé. La réalisatrice centre son documentaire sur Olfa et ses quatre filles. Les deux ainées de cette femme de soixante ans, « dévorées par le loup » de son propre aveu, ont rejoint l’État Islamique et fui en Libye il y a quatre ans de cela. La réalisatrice se propose donc de recourir à des comédiennes et à des comédiens pour combler les vides de la famille Chikraoui, fragmentée, et explorer sans sensationnalisme et sans surplomb moral une histoire déjà très médiatisée en Tunisie. Les deux sœurs absentes, Rahma et Ghofrane, sont remplacées par des comédiennes (Nour Karaoui et Ichraq Matar) ; l’actrice Hend Sabri se substitue elle à Olfa pour rejouer à sa place des scènes passées qu’elle juge trop difficiles à revivre ; enfin, c’est l’acteur Majd Mastoura qui incarne à l’écran tous les hommes de leur vie (le père, le beau-père et le policier), autour de la conviction que le patriarcat n’a qu’un visage. Ce dispositif permet à la réalisatrice d’explorer les facettes multiples d’une mère maltraitée devenue maltraitante, qui, témoin de sa propre violence rejouée par Hend Sabri, semble en mesurer la portée et les conséquences néfastes sur ses filles. Pour ces dernières, les retrouvailles symboliques avec leurs sœurs de fiction sont le lieu d’une sorte d’exorcisme : parfaitement conscientes d’être dans l’espace du jeu, elles l’apprivoisent, apprennent de la distanciation nécessaire du travail des comédiennes en plateau et exploitent le dispositif pensé par Kaouther pour faire entendre leurs vérités à une mère qu’elles aiment en dépit de tout : à vouloir préserver la pureté de ses filles, cette matriarche est devenue une figure plus redoutable que tous les hommes de leur entourage, et a aussi favorisé la radicalisation de ses deux aînées.
La réussite qui naît de cette communauté de femmes artificiellement reconstruite atteint peut-être son paroxysme dans la réponse qu’Eya fait à la réalisatrice suite au départ précipité du comédien, perturbé par le réalisme soudain de la scène qu’il réinterprète avec les deux sœurs cadettes. « Film ou pas, moi, j’ai dépassé ce stade. Ne sois pas gênée. Et qu’il n’ait pas peur, je sais ce que je fais. C’est juste du dialogue. Il est acteur, il connaît ça. Il n’a qu’à se dire que je joue ». Au cœur du film, la fiction est comme percutée par le réel des filles d’Olfa, tout autant qu’elle semble, plus que jamais, s’y épanouir.
Retour à la liste des épiphanies
Lire les épiphanies des années précédentes
-> Lire les épiphanies de 2022
-> Lire les épiphanies de 2021
-> Lire les épiphanies de 2020
-> Lire les épiphanies de 2019
-> Lire les épiphanies de 2018
-> Lire les épiphanies de 2017
