
« Écrits sur le cinéma » de Germaine Dulac : Le temps retrouvé du cinéma ?
Il est émouvant de retrouver une époque, celle des années 20, celle des années 30, vivace encore aujourd’hui dans ses enjeux cinématographiques, époque décisive, à la charnière du muet/du parlant/, du noir/du blanc/de la couleur, et de citer à se donner le tournis, René Clair, Julien Duvivier, Louis Feuillade, Jacques Feyder, Abel Gance, Marcel l’Herbier, Jean Renoir, Maurice Tourneur, Chaplin, Griffith, les débuts des Ford, Hawks, Vidor, Walsh, mais aussi Hitchcock période muet, Eisenstein, Dreyer, Lang, Murnau, Von Stroheim, pour ne pas dire un Âge d’or que Luis Buñuel tournera en1930…, époque que le travail de Prosper Hillairet sur la théoricienne du cinéma Germaine Dulac rend si bien. Époque tremblante où se joue le destin du cinéma comme la main de Gilles Deleuze, dans son mouvement, dit sa reconnaissance à la théoricienne, en page de garde, non pas comme un avertissement au lecteur, mais comme on feuilletterait un album fait de souvenirs commun. Un album qu’il faut donc rouvrir de toute urgence, le contextualisant, l’exposant, le questionnant afin d’en envisager la puissance comme la pertinence.
« Écrits sur le cinéma » de Germaine Dulac, un livre publié aux éditions Paris Expérimental (2021)
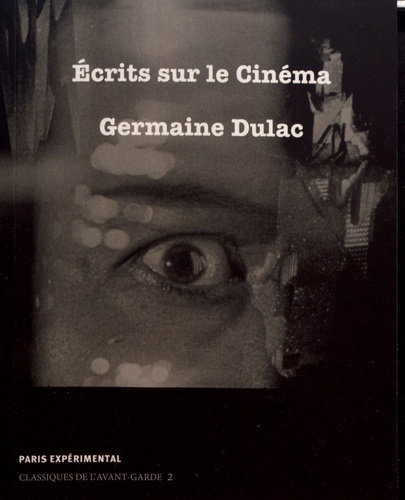
Le travail de Prosper Hillairet, sur la forme comme sur le fond, rend sur papier, dans son expression même, l’œuvre théorique de Germaine Dulac. En effet, Écrits sur le cinéma, de Germaine Dulac, n’est pas un livre de Germaine Dulac, mais un travail, non pas de récollection des écrits théorique et critique de la cinéaste, mais une composition faite par Prosper Hillairet, à partir d’un travail de fouille comme d’excavation dans les archives, où comment Prosper Hillairet se transmue, dans le livre, en homme orchestre, comme Germaine Dulac l’exige du cinéaste au labeur. L’ouvrage est un travail somme, remarquable, au sens où la pensée déborde son propre champ, un travail à la croisée des chemins, de la pensée portée au grand public, de l’université à l’universel, comme le souhaitait Germaine Dulac, car le grand malheur serait de croire que cet ouvrage ne serait à l’adresse que des « intéressés » de l’intéressement : chercheurs, étudiants en cinéma, voire aux lecteurs des Cahiers comme à l’homme honnête, disait-on autrefois. Non. C’est un livre pour chacun, ce spectateur qu’il faut éduquer, travail tout critique, à l’adresse de la critique, selon Germaine Dulac. Un livre intime et extime à la fois. Un livre pour le spectateur qui entendrait ressaisir le sens de son expérience vécu un jour au cinéma lorsqu’il ouvrit les yeux dans le noir comme si c’était la première fois, incapable de mettre des mots sur les « sensations » qui furent les siennes, comme le cinéma devrait en être l’« expression » écrit Germaine Dulac, l’« émotion » contre la logique de narration qui lui ferait tant de mal.
Les journalistes aiment dire, à ce propos, « œuvre d’utilité publique ». Œuvre publique, tout court, dira-t-on. Car des têtes vont tomber, le cinéma n’ayant rien d’« utilitaire ». A battre ce fer, Germaine Dulac s’y emploiera. Une approche du cinéma dont Prosper Hillairet entend, non pas réduire mais agrandir la focale, en présentant le travail de l’avant-gardiste Germaine Dulac la théoricienne du cinéma, elle qui cumulait les casquettes pour atteindre le haut-de forme (cinéaste, critique, féministe [on rappellera, contre Germaine Dulac, qui fait de la profession de réalisateur un « métier d’homme », que la première fiction cinématographique d’une réalisatrice date de 1896, La fée aux choux d’Alice Guy, un an après seulement celle des frères Lumière, L’arroseur arrosé, considérée comme la première véritable fiction de cinéma], mais aussi journaliste…). Théoricienne. Le mot ferait peur. Théorie...peur… Tendez l’oreille, ceux qui ne craindraient pas de se la voir coupée, même si ne serait pas Van Gogh qui veut. Théorie...peur... voici les mots proches, euphoniquement, de terreur. Ne dissipons pas les malentendus, car c’est bien à terrasser les « préjugés » (Germaine Dulac, p. 154), à propos du cinéma, que Germaine Dulac s’est employée.
L’ouvrage est ainsi le produit d’une entreprise (même si Germaine Dulac n’aurait sans doute pas aimé la formule à ce point fordisée par homo economicus, faisant entrer sa logique carrée dans les têtes rondes des contemporains), fruit d’une entreprise éprouvante de documentation (sur les écrits de Germaine Dulac, innombrables) comme de recherche, l’ouvrage, chronologiquement, recomposant le travail théorique de la cinéaste des années 20 à la fin des années 30, à travers un choix de textes illustrant sa pensée, présentation précédée d’un travail bienvenu comme essentiel d’explication mais aussi de compréhension de l’œuvre labyrinthique de Germaine Dulac, labyrinthique au sens de Borges, en ce sens singulier où le labyrinthe ouvrirait pour celui qui cherche l’issue favorable sur d’autres labyrinthes et à l’infini, mais en un mouvement paradoxal non pas de dépliement mais de repliement. En effet, Germaine Dulac construit une œuvre non pas linéaire, qui s’accomplirait se déployant/se dépliant dans le temps, mais effectue au contraire une trajectoire en forme de repli systématique, ces chemins de la pensée dont Heidegger disait qu’il devrait toujours s’effectuer en spirales. Une œuvre critique et théorique faite d’aller-retour, autant de coups qu’il s’agirait de jouer comme d’asséner, revenant sans cesse sur ses pas, s’auto-citant, copiant-collant des passages entiers d’un texte à l’autre, produisant un hypertexte jamais terminé, parce qu’il n’y a pas de guerre, qui signifierait l’espoir d’une trêve comme d’une paix, le repos de la guerrière, mais rien que des batailles inlassables à mener. Alors Germaine Dulac, dont les autres combats, pour les droits des femmes, seront encore nombreux, fourbit ses armes parce qu’elle sait bien que le repos de la guerrière n’est qu’un mythe. Le combat ne sera jamais abouti.
Le repos du guerrier, celui de la guerrière Germaine Dulac ? L’expression serait contemporaine de l’époque de la cinéaste théoricienne. Expression machiste, que le Dictionnaire des expressions (Robert) imputerait à Nietzsche, dont l’origine se trouverait dans Ainsi parlait Zarathoustra : « L’homme doit être élevé pour la guerre, et la femme pour le délassement du guerrier : tout le reste est folie ». Germaine Dulac a bien appris la leçon, la tournant contre l’adversaire. Son combat, que rapporte le travail de Prosper Hillairet : l’homme doit être élevé pour le cinéma, sans jamais connaître ni congé ni rémission. Germaine Dulac martèle : le cinéma ne saurait être une récréation. Quelque chose d’absolument vital s’y joue, qu’elle s’efforce de saisir dans son mouvement, définissant précisément et essentiellement le cinéma par le mouvement (Germaine Dulac, p. 101), quête sans fin, harassante, usante jusqu’à la corde, le mouvement ne connaissant jamais de fin, le mouvement n’ayant pas de Happy End. C’est dès lors à éduquer les foules, celle des spectateurs comme des acteurs du cinéma, que s’emploie Germaine Dulac. Œuvre importante, iconoclaste, à l’époque où le cinéma parlant fait son apparition, Germaine Dulac dans l’antre, l’entre des choses, entre le muet et le parlant, faisant partie de ce que l’on pourrait appeler la seconde génération, celle d’après Méliès, dans La roue d’Abel Gance (Germaine Dulac, p. 82, pour en dire sa haute estime), qui a vu sortir le cinéma des foires pour entrer dans sa cachette, s’exposer pour la première fois dans des salles de cinéma. C’est à excaver ce qui se joue dans l’obscurité, dans cette Œuvre au noir, que Germaine Dulac va s’employer. Pour tâcher de comprendre ce qui se joue là, ce qui ferait la spécificité du cinéma notamment à l’égard des autres Arts, « dégager le cinéma des autres formes de l’art, lui révéler sa propre voie, sa propre grandeur, sa propre personnalité [...] » (ibid., p. 43, p. 94, 95), qui anoblirait le cinéma comme le 7e du nom, mais plus généralement, à l’égard de tous les autres champs de la connaissance, il faudrait sans doute le faire en trois directions : contextualiser d’abord la pensée de Germaine Dulac, l’exposer ensuite, la soumettre à l’épreuve enfin.
Contextualisation
Pour bien comprendre la portée des thèses qui sont autant de propositions sur le cinéma qu’il s’agirait de soumettre au feu, il faut dans un premier temps apercevoir combien Germaine Dulac est fille autant qu’orpheline de son époque. Un détour comme un décours pour mieux penser sa singularité, faire un cinéma soucieux de son drame, pour se réinventer au matin.
Germaine Dulac, inlassablement, de colloque en entretien, en passant par l’exercice critique, parlant de son cinéma comme généreusement de celui des autres, s’efforce d’apporter la preuve comme de signifier ce qui ferait la patte du cinéma. L’objectif de Germaine Dulac ? Démontrer que le cinéma possède un langage propre comme une manière à nulle autre pareille de dire le monde, qui ne soit pas simplement celui d’« histoires, drames, belles images, foules, décors », qui sont une « hérésie » (Germaine Dulac, p. 89) pour parler la langue-cinéma. Germaine Dulac s’efforce, Crabe-tambour, de frapper, répétant coup après coup, que le cinéma gagne d’abord à s’émanciper de tous les autres arts, auxquels on le tiendrait trop facilement en servage (« servile », écrit-elle, p. 154), notamment la photographie (sur le plan de l’image), la littérature comme le théâtre (au sens où le cinéma n’en serait qu’un sous-genre, reprenant leur schéma, du dénouement de l’intrigue au terme de la narration comme leurs enjeux dramatiques).
A cet égard, le travail de Germaine Dulac est absolument contemporain d’une époque, celle du 19e siècle finissant comme germine déjà le 20e siècle lorsqu’elle écrit sur « la science des metteurs en scène » (Germaine Dulac, p. 158), période durant laquelle tous les champs de la connaissance, qu’ils soient récents ou anciens, qu’il s’agisse des sciences humaines ou des sciences dures, de l’anthropologie, du droit, de l’ethnologie, des mathématiques, de la psychanalyse jusqu’à la sociologie, sans que cette liste soit exhaustive mais suffisamment représentative d’un mouvement d’ampleur auquel participe la théoricienne, qui se demande, pour sa part, « Pourquoi le cinéaste, seul parmi les savants n’aurait-il pas la permission de dire :’Notre art évoluera encore, notre science est à parfaire’ » (pp. 100-101). Une période durant laquelle, donc, chacune de ses disciplines, comme le cinéma auquel aspire Germaine Dulac, se cherche et cherche à élaborer les conditions de leur réussite dans un langage qui leur soit propre, toutes prétendant à la scientificité de leur discours tout en s’efforçant de marquer leur territoire comme d’en expulser toute forme d’immixtion qui leur soit étrangère. Époque de grand déballage scientifique, grand ménage du printemps quand Avril n’a pourtant pas encore découvert tout à fait son fil.
Pour prendre un premier exemple de ce mouvement d’ampleur, la psychanalyse, essentiellement sous l’impulsion de Freud, voit le jour et s’efforce d’apparaître d’emblée comme une science, cette science à qui le cinéma doit son origine, dit Germaine Dulac, à partir de 1896 le terme « psycho-analyse » faisant son apparition pour la première fois, puis, plus spécifiquement, à partir d’une série de conférences données en 1909, à partir desquelles Freud dira que « Ce qui caractérise la psychanalyse, en tant que science, c’est moins la matière sur laquelle elle travaille, que la technique dont elle se sert ». Même tendance pour l’anthropologie naissante comme l’ethnologie, qui entendent se débarrasser de la sociologie, afin de marquer leur territoire respectif. L’ethnologie, en ce sens, entendra privilégier non plus l’étude des phénomènes sociaux des pays industrialisés à l’instar de la sociologie, mais au contraire les communautés traditionnelles extra-européennes ; de la même façon, ethnologues comme sociologues, à l’instar d’Émile Durkheim dans Les règles de la méthode sociologique, souhaitent de concert délimiter leurs frontières sur le plan épistémologique : à la sociologie une approche quantitative, faite d’entretiens et autres sondages et questionnaires, insistant sur la représentativité de ces études ; à l’ethnologie une approche qualitative telles que l’observation participante comme l’enquête de longue durée. Même quête de pureté que dans le cinéma désiré par Germaine Dulac, dans le champ du droit, que le héraut du positivisme juridique, Hans Kelsen, présentera dans sa Théorie pure du droit, thèses encore aujourd’hui dominantes dans les universités. Kelsen, en un double mouvement, souhaite en effet à la fois débarrasser la science du droit naissante de toute forme de contamination comme d’en ériger les principes à hauteur de l’objectivité, de l’impartialité comme de la neutralité des sciences dures. A l’instar des sciences de la nature, dont Germaine Dulac dit autant que « tous les arts puisent dans [cette] nature » (p. 236), il entend de ce fait montrer que la science du droit doit d’abord se débarrasser des scories de la métaphysique, de la morale, comme du discours religieux, consistant en autant d’énoncés invérifiables, donc non scientifiques. Dans le même temps, à cette science du droit de gagner son autonomie en s’extrayant de l’emprise des sciences humaines de son époque, au premier chef, la sociologie dans sa superbe comme ses prétentions à dire tous les mondes. Cette science du droit doit dès lors disposer de la même objectivité que les sciences de la nature, selon Kelsen, mais à partir d’un objet qui lui soit propre. Cet objet sera la norme juridique. Précisément, les sciences du vivant disposeraient de faits directement observables dans la nature, leur conférant leur objectivité ; la science du droit, pour sa part, s’intéressera aux mêmes faits, mais dans leur préhension juridique - comme le cinéma, pour Germaine Dulac, mais dans son langage singulier pour les rendre à leur part cinégénique -, c’est-à-dire, pour le droit, à travers la manière dont celui-ci entendra qualifier ces mêmes faits mais à partir d’une langue qui lui soit propre, la norme juridique attribuant une signification spécifique à ces faits, autrement dit une qualification juridique, dans une langue neuve et renouvelée, de sorte que, langue qui possède son lyrisme de bureau, un oiseau ne soit plus un animal, comme pour les sciences de la nature, mais un meuble selon le Code civil.
Ce positivisme juridique, par effet de contagion, se trouve évidemment, à l’époque de Germaine Dulac, pour qui « la composition d’une image [a une] valeur quasi mathématique » (p. 59), sous perfusion du positivisme logique comme du Cercle de Vienne (Kelsen étant lui-même autrichien), dont le positivisme juridique ne ferait qu’appliquer les idées, selon lesquelles les affirmations métaphysiques ne seraient que des pseudo-propositions dépourvues de signification car non vérifiables, positivisme logique dont le philosophe allemand Carnap, et le philosophe et logicien américain Quine, sont les figures emblématiques. Chefs de file dans les années 30 d’un courant de pensée franchement anti-métaphysique au sein du Cercle de Vienne, Carnap considère tout d’abord que les énoncés de la métaphysique, ceux de Heidegger par exemple, n’ont pas de conditions de vérité claires. Tout y est ambigu, indéterminé, donc dénué de sens. Il faudrait dès lors réduire, selon Carnap, toute proposition sous la forme d’énoncés protocolaires. Ou bien tout énoncé est mathématisable, ou bien il est indémontrable, autant dire qu’il ne sert à rien.

Cependant, et voici l’essentiel, chacune de ces tentatives finira par s’avérer vaine et contre-productive. En ne prenant qu’un seul exemple, emblématique et paradigmatique de cette tentative de purifier tous les champs du savoir de toute forme d’immixtion comme Germaine Dulac en appelle à un « cinéma pur » (p. 162), celui, une nouvelle fois, du positivisme logique. Car c’est le même Carnap – dans son débat avec Quine – qui, s’efforçant de fixer une ontologie des mathématiques, va participer plus tard au renouveau de la métaphysique, notamment nord-américaine aujourd’hui (avec les travaux d’Hilary Putnam). L’empirisme vérificationniste, constate finalement Carnap, est effectivement un échec. Les critères de vérification, l’empirisme fort où tout énoncé devait être corrélé à des énoncés décrivant des états de choses vérifiables dans l’expérience, ne permettraient pas dans les faits de capturer des énoncés universels. Carnap, confronté à la présence dans les théories scientifiques d’énoncés à propos d’inobservables comme les électrons, s’est dès lors résolu à assouplir le critère de vérifiabilité empirique, amendant dès lors les critères de vérifiabilité des expériences scientifiques. Quine, va montrer quant à lui les limites de la prétention à vouloir classer tout jugement (y compris les jugements mathématiques purs) dans la catégorie des jugements « de fait » ou dans celle des jugements « conventionnels ». Certes, quand on parle de questions de fait on se réfère à l’expérience, mais la perception des faits elle-même serait chargée de valeurs et, par conséquent, posséderait un aspect normatif duquel toutes les sciences entendaient pourtant se débarrasser. Les amendements de Quine et Carnap montrent alors qu’il n’y a pas de fait brut et que les jugements de fait présupposent toujours des concepts et des théories. Selon Putnam, qui s’inspire ici du philosophe-économiste Walsh, en amendant leur épistémologie de la sorte, les positivistes logiques ont permis de penser que la science présuppose des valeurs. En conséquence Carnap et Quine vont-ils ouvrir la voie à une refondation du concept de métaphysique qu’ils entendaient bien pourtant détruire. Le même constat pourrait être fait pour l’anthropologie, l’ethnologie, le positivisme juridique, la psychanalyse, la sociologie de Durkheim, en reprenant, pour les éprouver, le théorème du génial mathématicien Gödel mais néanmoins fou, fou parce que génial ou bien génial parce que fou, d’après lequel, y compris au premier plan les mathématiques, aucun système ne se bouclerait sur lui-même, toutes les sciences reposant sur des axiomes qui en constitueraient en quelque sorte les règles du jeu, de sorte que ces axiomes échapperaient par définition à toute forme de vérification de leurs présupposés, ces axiomes déterminant eux-mêmes les conditions de possibilité du développement des sciences auxquels ils se rapporteraient. Bref, le constat est fait par et dans les sciences : rien ne serait pur, tout serait contrarié, pour ne pas dire mêlé.
Il y a peut-être, cependant, davantage encore Malaise dans la civilisation à l’époque de Germaine Dulac, exprimée par cette tentative de purification du champ des savoirs comme tendance, à laquelle semble participer, a priori, et sous réserve de vérification, les thèses de la théoricienne. A proprement parler, ce qui est encore commun à cette entreprise d’objectivité comme quête de pureté c’est, finalement et paradoxalement, à s’efforcer de connaître le monde en toute objectivité, de le priver de ses étrangetés comme de ses bigarrures, de tout ce qui était précisément enchevêtré : c’est se débarrasser de l’homme comme le spectateur pose un problème à Germaine Dulac. En effet, chacune de ces sciences entend bel et bien déposséder l’homme de ses facultés comme de sa liberté : par le jeu de l’inconscient (la psychanalyse) ; en raison de sa nature humaine comme de sa situation, qui impliquerait un devoir, une charge que nul ne saurait abdiquer (l’anthropologie) ; par le biais des effets de structure (l’ethnologie), comme les faits sociaux (la sociologie) ; mais aussi en raison également, à la même époque, de sa position de classe (le marxisme), tout autant en raison de l’incapacité des individus à créer du droit sous le seul effet de leur volonté souveraine (magie, dira Kelsen, seul le droit pouvant créer du droit, non l’individu)...
Précisément, en voulant débarrasser leur discipline de tout corps étranger, de toute impureté comme de la métaphysique, ces auteurs ont accéléré un mouvement ancien, induit par la modernité, accélérant cette modernité de sorte que l’on parlera désormais de post-modernité, phénomène décrit par un sociologue du 19e siècle, Max Weber, celui du désenchantement du monde. En s’efforçant de rendre ce monde connaissable de la façon la plus pure qui soit, chacune de ces sciences, au fond, s’est efforcée dans un mouvement herculéen de se débarrasser de toute forme de jugement a priori, non synthétique, c’est-à-dire de déformation de perspective comme de vue induites par les jugements personnels, individuels et donc toujours situés à partir d’une position. Autant dire que chacune de ces sciences, se nettoyant de toute forme de subjectivité à l’œuvre, s’est débarrassée dans le même tempo définitivement de l’homme (voir Foucault, Les mots et les choses), après que Nietzsche ait proclamé la mort (incomprise) de Dieu.
Ce siècle à haute prétention scientifique, pour ne pas dire scientiste, désenchanté, engendrerait-il lui-même chez Germaine Dulac, en quête également d’un langage propre au cinéma, un cinéma sans spectateur, ce spectateur impur, que critique en permanence Germaine Dulac, qui rendrait le cinéma médiocre, parce qu’à son (mauvais) goût, produire donc à rebours, pour Germaine Dulac, un cinéma idéal pour un spectateur idéal, autant dire un spectateur comme un cinéma qui n’existent pas, un cinéma mort à vouloir se montrer dans son or, se révéler dans sa pureté, dans un siècle qui a vu également naître durant la même période, dans son délire tout scientiste, et la phrénologie comme la théorisation des races, Germaine Dulac, symptomatiquement, utilisant le terme de « race » (p. 254, 273, 297) pour la première fois à partir de 1931, non pas sans doute en un sens raciste mais racialiste, plaidant pour un cinéma national (ibid., ce que les américains comme les russes et allemands auraient compris selon elle), mais un cinéma qui, national, devrait être alors l’occasion d’un mutuel « progrès moral et matériel » (ibid.) à partir des spécificités de chacun.
Tentative de pureté, malgré tout, cette pureté dont Jankélévitch dira plus tard qu’elle est toujours le contraire de la vie ; qu’à faire place nette, la pureté tue. C’est peut-être en cela que Germaine Dulac, si elle est fille de son époque, en est également, cependant, orpheline car, précisément, elle entend bien plutôt réenchanter ce qui aurait été désenchanté en son temps. En effet, si le cinéma est d’abord né du génie mécanique, dans un siècle tout positiviste, c’est à se prétendre comme à se hisser au rang d’un art véritable que va travailler Germaine Dulac. Proprement, si le cinéma, sans doute invention conjointe des scientifiques français Etienne Jules-Marey (à travers son travail, dès les années 1870, sur la décomposition du mouvement du cheval comme des activités sportives et de la vie quotidienne, décomposition mise en image par son invention, en 1882, du fusil photographique et de la « chronophotographie ») comme celle de son collègue américain Eadweard Muybridge, avec lequel il travaillera ensuite de concert (qui, de 1872 à 1885, met en mouvement les images dans Animal Locomotion, à travers l’invention de son Zoopraxiscope), travail scientifique tout autant de Thomas Edison (« théâtre optique », dira son brevet, théâtre dont Germaine Dulac entendra débarrasser le cinéma), inventions scientifiques sans doute couplées au génie des frères Lumière (auquel le collaborateur de Marey vendra l’invention de son maître), dans un siècle tout positiviste dont Auguste Comte avait fixé les principes dès la moitié du 19e, si le cinéma, donc, s’inscrit dans son époque, qu’il est d’abord « une technique de connaissance scientifique du monde » (Prosper Hillairet, Préface, p. 27), un moyen pour « analyser et reproduire les mouvements du monde » (ibid.), c’est à travailler à l’émanciper de sa seule technicité que Germaine Dulac va s’appliquer, afin de l’élever au rang d’art véritable. Le cinéma ne se bornerait pas simplement, à l’ère de la reproductibilité technique (W. Benjamin), à reproduire des mouvements comme des phénomènes extérieurs (« mouvement extérieur, mouvement intérieur l’un commentant l’autre pour former la phrase cinématographique », écrit-elle, p. 87), il renverrait essentiellement à une dimension intérieure, un « élan spirituel » dira Germaine Dulac, dont les images ne seraient pas des évocations, le cinéma ayant plutôt vocation à « former des mouvements », à « faire entrer en des rythmes des mouvements » (Prosper Hillairet, Préface, p . 30). Élan spirituel ; ce qui avait été desséché pour ne pas dire nécrosé dans tous les champs de la connaissance du monde, à l’époque de Germaine Dulac, retrouverait sa magie dans un certain cinéma défendu par la théoricienne. « Instrument scientifique », il entrerait « dans celui de l’art » (Germaine Dulac, p. 103) par le jeu comme la combinaison de ses caractères propres.
Exposition
Dans le cadre de cette recension, il ne peut évidemment pas être rendu justice au travail de Prosper Hillairet en s’efforçant de retranscrire la totalité des propositions de Germaine Dulac, sauf à y renvoyer en permanence. A l’exhaustif, on optera plutôt pour le caractéristique comme l’exemplaire, retenant quelques idées forces de la théoricienne, pour les soumettre ensuite à l’épreuve. Quel est donc, à ce propos, ce qui constituerait le langage propre du cinéma, « qui lui confère sa valeur et son indépendance » (Germaine Dulac, p. 154) ? Pour l’essentiel, on retiendra d’abord ce qu’il n’est pas, la théoricienne définissant au premier chef le cinéma de manière apophatique, puis, à l’avoir débourbé, lui attribuera ensuite positivement sa qualité spécifique :
1/ Le cinéma n’est pas une « application » des autres arts qui, tous, possèdent leur propre médium : à la musique le son, à la peinture la couleur, à la littérature la narration, au théâtre le drame, à la photographie l’image (qui est fixe quand le cinéma serait à rebours de cette fixité)… Le tour de force théorique est à la hauteur des ambitions de Germaine Dulac, le cinéma comme phénomène de foire, le cinéma lui étant assimilé (Germaine Dulac, p.69), il fallait dès lors le coup de poing du forain pour l’en dégager. Mais à évider le cinéma de la séquence du drame, de la narration, d’un certain type d’image, on pourrait bien se demander ce qu’il en reste, sauf à l’avoir fait disparaître. Germaine Dulac n’a pas de mots assez dur, notamment, à l’endroit de ce cinéma narratif, elle qui, dans ce procès à charge, plaide pour un cinéma non-narratif, un cinéma fait de « sensations » (ibid., p. 99) exprimé visuellement, afin de le sortir de la gangue, qui est une fange pour la théoricienne, de la littérature comme du théâtre, ce cinéma étant trop souvent considéré à tort comme n’étant qu’une « copie » de ces autres arts (Prosper Hillairet, Préface, p. 25).
Cinéma de sensations, ce faisant, il n’aurait pas davantage besoin du parlant (« Le cinéma est un art muet », dit-elle, p. 53), à l’époque où le parlant des studios américains envahit les écrans. Le parlant, par les divers bruits périphériques qu’ils ne manqueraient pas d’occasionner, parasiterait l’élan spirituel du cinéaste « créateur » (Prosper Hillairet, Préface, p. 29, mais aussi Germaine Dulac, p. 239), l’expression de ses sensations, vendrait le cinéma à la littérature, rendrait le cinéma au théâtre. Germaine Dulac plaiderait-elle, ce faisant, pour un cinéma purement formel, un cinéma de l’abstraction qui l’éconduirait paradoxalement du public auquel elle voudrait s’adresser ? Plutôt, plaide-t-elle pour un « cinéma total », que le cinéma « commercial » (au sens de « cinéma compris par tout le monde », Germaine Dulac, p. 221) pourrait rendre possible, si ce dernier, idéalement, savait être au rendez-vous de deux types de cinémas aux antipodes, celui de l’avant-garde, cinéma « abstrait ou intégral » (ibid., p. 136) qui serait tout du côté de l’art, tandis que le « cinéma récréatif » ne flatterait que les goûts vils du public pour qui il ne serait qu’une « simple distraction » (ibid., pp. 47, 249). En sorte que la quadrature du cercle serait résolue de façon additionnelle : cinéma d’avant-garde+cinéma récréatif=cinéma commercial. De cette rencontre surgirait l’art académique du futur (ibid., p. 249, 250), par « l’équilibre [de leurs] tendances » (pp. 253, 277).
De la sorte, si le cinéma expérimental irait parfois à contre-courant des normes cinématographiques habituelles, notamment en matière de durée, avec des films de 25 heures (Four Stards, d’Andy Warhol) ou a contrario d’1/24 de seconde (Le Film le plus court du monde, d’Erwin Huppert et Very Important Image [V.I.I] de Manuel Gomez), ou de narration (Empire de Warhol, film de huit heures composé de bobines mises bout à bout et cadrant en plan fixe l’Empire State Building), le « cinéma commercial » pourrait permettre la rencontre de ces propositions avec le « public », qu’on trouvera bien plus tard chez des cinéastes comme David Lynch, qualifié par la critique Pauline Kael de « premier surréaliste populaire » (mais Luis Buñuel n’en était-il pas à l’inauguration, avec Un Chien Andalou, dès 1929, que ne cite pourtant jamais Germaine Dulac, sous réserve d’une mention non retranscrite dans l’ouvrage) ou encore Ingmar Bergman, étirant l’instant d’une vie sur la durée d’un film (Monika) ou encore Béla Tarr, dans Le tango de Satan, en 415 minutes, « longueur » qui n’interdira pas son encensement international voire, de manière moins extrêmement expérimentale/plus « récréative » chez Théo Angelopoulos, étirant et compressant le temps en un même mouvement dans L’éternité et un jour (1998).
Cette approche du cinéma en forme de solution est essentielle pour comprendre le travail de Germaine Dulac, la cinéaste concédant elle-même que son cinéma serait essentiellement encore par trop narratif (Germaine Dulac, p. 47), qui « rêve » d’un « ‘film symphonique’ » (ibid., p. 96), rêve empêché par les producteurs, pris dans la grande mécanique économique des Temps modernes (ibid., p. 92) comme les goûts du spectateur, « nos pires ennemis » (p. 89), « seuls responsables de la médiocrité de notre art » (ibid., p. 93) entravant l’émergence de cet autre cinéma qui serait à-venir : « L’avenir est au film qui ne pourra se raconter » (ibid., p. 153), comme ce « grain de blé qui croît » rendu à l’écran, dont parle si souvent Germaine Dulac, mouvement réalisant une « cinégraphie intégrale », une « cinégraphie de formes » (ibid., p. 163). Ce cinéma que voudrait tenter Germaine Dulac est donc une confession singulière, confession comme expression d’une curieuse nostalgie, d’une nostalgie non pas d’un Age d’or, d’un cinéma qui aurait été perdu/qui se serait perdu, mais d’un cinéma non encore advenu. C’est à éduquer les foules, mieux, le « convaincre […] que son goût, ses désirs, ne sont pas conformes à l’esprit du cinéma » (ibid., p.104), dès lors, afin d’inverser la mécanique économique, qu’il faudrait (pour la critique cinéma notamment) se dépenser.

2/ Si le cinéma ne se loge ni dans l’image, ni dans le drame, ni dans la narration, se camperait-il autrement que dans un pur fantasme, Désert des Tartares illusoire? Expurgé de ces rondeurs, resterait pourtant au cinéma sa seule matière : le mouvement, dont elle écrit qu’il n’est pas « simplement le déplacement, mais aussi et surtout, l’évolution, la transformation. […] Lignes, volumes, surfaces, lumière envisagés dans leur métamorphose constante » (Germaine Dulac, p. 140). C’est à oublier, rappelle la théoricienne, que dès le départ, le cinéma a enregistré le mouvement du monde, que le cinéma se serait malheureusement rendu. Or, chez Germaine Dulac, tout est mouvement : écrire, penser, aucune activité n’est immobile, le monde suspendu en autant de mobiles, dans un fluide que le cinéma devrait tâcher de rendre dans sa circularité comme chaque art possède son propre mouvement (Germaine Dulac, pp. 156-157). Mobilité pour tâcher d’exprimer à l’écran l’intimité du réalisateur, plutôt, « rechercher le mouvement émotif » (Prosper Hillairet, Préface, p. 28), en quoi consisterait le mouvement du cinéma. Le point est capital. Le cinéma doit être l’expression, à l’écran, du monde intérieur du « créateur », qui permet de développer deux points, qu’il faudra questionner ensuite.
Premièrement, le cinéma devrait toujours être l’expression de son auteur, d’un auteur, mieux, être l’œuvre comme l’acte d’un « créateur » : « […] la grande œuvre cinématographique est individuelle comme toutes les œuvres belles » (Germaine Dulac, p. 44), fruit d’un « travail solitaire » (Germaine Dulac, p. 45), le cinéaste étant celui qui fait « sortir du néant l’idée visuelle » (p. 274). Deuxièmement, de façon décisive, l’extérieur, ce qui est montré comme vu à l’écran, par le choix d’un décor, d’un scénario, de plans, de fondu, de la lumière (qui serait « la vérité du cinéma », vérité grâce à laquelle se traduiraient le mieux à l’écran les sensations du cinéaste), ne doit jamais être purement décoratif : l’extérieur, au cinéma, ne serait jamais que la retranscription de l’intériorité du « créateur » comme de ce qui se joue sur l’écran : « la ‘cause’ spirituelle des mouvements extérieurs ». Du monde extérieur au monde intérieur, rien de ce qu’aurait fait l’ermite de Farö, Ingmar Bergman, dont Jean-Luc Godard dira, notamment de Monika, que son cinéma est « un vingt-quatrième de seconde qui se métamorphose et s’étire pendant une heure et demie. C’est le monde entre deux battements de paupières, la tristesse entre deux battements de cœur, la joie de vivre entre deux battements de mains. »
Reprenons : œuvre d’un seul, œuvre originale, d’un « créateur », donc, le cinéma serait mouvement, tout contenu dans ce mouvement, qui, partant de l’intérieur, effectuerait une transmigration de l’« âme » (Germaine Dulac, p. 159) du cinéaste sur l’écran, vers l’extérieur, qui en serait la toile rendue au spectateur, en un « cinéma suggestif » (ibid.). Dans ce cadre, jouerait contre le cinéma deux tendances néfastes : certaines innovations techniques qui, après lui avoir pourtant donné donné sa chance, le cinéma étant une invention technique, comporteraient aussi un versant maléfice, l’avènement du parlant en tête, auquel Germaine Dulac fait part de son hostilité ; mais aussi le goût du public, toujours en retard d’un train, ce train inaugural par lequel débutait pourtant le cinéma des frères Lumière, dont parle tant Germaine Dulac (ibid., p. 156), ce train que n’aurait cependant pas pris le public, toujours en retard d’un train, entravant la réalisation de ce cinéma « pur », obliquant la logique économique, la faisant ployer vers un cinéma de mauvais goût. Autant d’éléments qu’il faudrait mettre en perspective à présent.
Mise à l’épreuve
1/ Tout d’abord, en insistant négativement sur ce que ne serait pas le cinéma, Germaine Dulac n’essentialiserait-elle pas les autres arts comme le cinéma aurait une « essence », technique, morale, spirituelle (« L’essence du cinéma – L’idée visuelle », de Germaine Dulac, p. 102, mais aussi p. 154), « essence du cinéma [qui] porte l’éternité en elle puisqu’elle ressort de l’essence de l’univers : le Mouvement » (ibid., p. 165) ? Essentialisation faite le plus souvent du spectateur aussi, rabattu au rang du seul diverti pascalien (même si elle reconnaît tardivement, p. 251, que le « public se divise en classes différentes », une approche qui permet de mesurer l’écart qui existe, en vingt ans, entre ces thèses et celle de Stanley Cavell qui, en une approche ontologique également, abordera cependant le premier le cinéma à partir de l’expérience du spectateur, dans La Projection du Monde, en 1960) comme elle lui permettrait de réduire, par exemple, « le littérateur par une histoire » (ibid., p.80), à l’instar des autres arts. Une réduction qui l’autoriserait, ce faisant, à réussir parfaitement son coup de force théorique. En effet, après avoir enfermé dans le bloc marmoréen/monolithique/monocolore et insécable de leur expression les autres arts (ibid., p. 104), la théoricienne ne se rendrait-elle pas la tâche d’autant plus commode pour en démarquer le cinéma : assigner quoi que ce soit, comme qui que ce soit à une identité fixe et immuable, en en délimitant le périmètre, permettrait d’autant mieux d’établir des distinctions comme des démarcations promptes à préserver le cinéma de tout ce qui serait ainsi fixé comme élément hétéro-pathogène ?
Au fond, la quête de ce cinéma « pur » provient peut-être en la croyance que l’avant-garde dont se revendique Germaine Dulac serait à ce point aux avant-postes du cinéma, qu’elle en dirait la vérité tout comme elle en exprimerait les conditions de possibilité, terme dont elle essentialiserait autant la conception. Germaine Dulac (bien avant Luc-Ferry-le-philosophe, donc, in Le Sens du Beau) soulève, en effet, la question du sens de l’art cinématographique dans une société qui en aurait fini avec le sacré, et où la banalité aurait triomphé de toute transcendance, qui montre combien il est encore question de l’Être dans ce type d’avant-garde, dans son projet comme sa nomination.
A l’évidence, le terme « avant-garde » (notamment, pp. 250-251, 252) prend ses accents chez Germaine Dulac dans une acception classique, la valeur d’une œuvre se confondant avec son caractère inouï, en avance sur son temps, l’avant-gardisme renvoyant à une conception individualiste de la création. Dans cette conception, l’avant-gardiste refusera toute affiliation avec ses prédécesseurs comme il refusera tout art antérieur. L’avant-gardiste serait bien, en ce sens, en avance sur son époque cinématographique, qu’il aurait pour tâche, selon Germaine Dulac, d’éclairer, aidé par la critique cinématographique (Germaine Dulac, p. 232). L’artiste avant-gardiste serait bien celui qui, en avance, créerait l’art.
Cette conception de l’avant-garde n’est pourtant pas définitive. Certains avant-gardistes, a contrario, vont puiser dans les pratiques expressives de ces autres arts dont pourtant Germaine Dulac aimerait débarrasser le cinéma, y puiser afin de les épuiser. Ce sera le cas du côté des techniques ou des modes de représentation propres à la musique dans le cinéma lettriste d’Isidore Isou comme chez Roland Sabatier, mais aussi, y compris, chez un contemporain de Germaine Dulac, le peintre/réalisateur Maurice Lemaître, techniques de la peinture où d’autres avant-gardistes ultérieurs puiseront tout autant leur lyrisme comme chez Stan Brakhage, ou encore Len Lye et Leighton Pierce. C’est que les avant-gardes se sont efforcées de rendre explicites les a priori de la conception d’une œuvre comme de l’artiste, selon, pour schématiser, une double voie : en proposant d’explorer certainement de nouvelles propositions, une conception que retient Germaine Dulac, mais en explorant ces propositions symétriquement à celles de l’esthétique constituée ; tout autant, les avant-gardes ont maintenu leur effort en poussant à leurs limites, c’est-à-dire en tentant de dérouler la logique interne des conceptions classiques de l’art comme de l’artiste jusqu’à leur terme afin d’en faire émerger la singularité jusqu’à l’absurde, de pousser, donc, les propositions de l’art jusque dans leur retranchement, une conception de l’avant-garde que ne retient pas Germaine Dulac. Or, cette conception de l’avant-garde déconstruit l’idée d’avant-garde dont se prévaut Germaine Dulac, celle de l’œuvre comme de l’auteur. Ainsi, la sérialité mettra en question l’idée de l’unicité de l’œuvre (comme la musique atonale contestera la mélodie), autant que la production mécanique contestera l’idée de création, où, de façon plus absurde encore sera mise à la torture la conception d’une différence essentielle entre l’art et la trivialité, comme Duchamp et son célèbre urinoir Fontaine, jusqu’à la « Merde d’artiste » de Piero Manzoni, dans une boîte fermée censée contenir ses propres excréments, tendance poursuivie dans cette machine à produire artificiellement des excréments, la Cloaca de Wim Delvoye. Donc, y compris le cinéma d’avant-garde, qui serait seulement du côté de l’art selon Germaine Dulac, dans cette seconde acception du terme comme dans son application, emporterait un art cinématographique mêlé aux autres arts comme il déferait l’idée d’artiste, thèmes auxquels l’avant-gardisme dulacien est très attaché.
À cet égard, et pour parler seulement des autres arts, quid, et pour le dire trop massivement, du surréalisme contemporain de l’époque de Germaine Dulac, dont le Manifeste inscrit son projet contre la raison, projet qui, sous le coup de « l’automatisme du psychisme », et par quelque moyen que ce soit - par l’écriture ou encore visuellement, en utilisant les matériaux du rêve comme de l’inconscient -, entend faire éclater les frontières entre les arts que Germaine Dulac consentirait à garder ? Quid, encore, en peinture, de l’impressionnisme tout autant contemporain de l’époque de Germaine Dulac, dont le projet artistique est de rendre sur la toile le mouvement du monde, le scintillement des rayons du soleil sur la Seine, ses sensations ? Mais Germaine Dulac, citant précisément l’impressionnisme (Germaine Dulac, p. 160), reconnaissant cette puissance de la peinture, comme de tous les autres arts, qui sont aussi l’expression d’un mouvement, mais d’un mouvement qui serait tellement propre à chacun qu’il en serait non-miscible dans le cinéma, quand l’impressionnisme entend au contraire rendre justice de l’éclat de ce monde dans son exultation, monde de sensations mêlées, monde composé d’entrelacs dira Merleau Ponty, fait d’une « chair » dont il serait vain, sauf à le sacrifier, d’en distinguer les éléments les uns des autres, inextricablement agglomérés qu’il serait les uns dans les autres : autrement dit, mouvement.
Dès lors, à vouloir fixer les autres arts dans une essence inaltérable qui, au fond, n’existerait pas, Germaine Dulac ne combattrait-elle pas des moulins d’autant plus facile à abattre que l’ennemi n’aurait d’autre existence que supposée dans l’esprit comme le viseur de celle qui les tient en joue ?
2/ Positivement, la thèse essentielle et forte, il va sans dire, de Germaine Dulac, consiste à identifier le cinéma comme « élan spirituel ». Un élan/mouvement qui partirait de l’intérieur du « monde » du réalisateur pour aller vers l’extérieur, se projetant sur l’écran de cinéma, puis, réciproquement, de l’extérieur de la toile vers l’intériorité du spectateur « le cinéma [étant] ce qui ne peut pas se raconter – mais dans l’effet physique qu’il provoque chez le spectateur », cité p. 32), ce dernier éprouvant dans ce mouvement de balancier, par le jeu des sensations, l’intériorité du cinéaste comme il atteindrait les siennes propres. Thèse essentielle, cinéma d’affect dirait Le Rayon Vert, à partir de laquelle on pourrait percevoir tout le cinéma.
On ne prendra qu’un seul exemple, d’un cinéaste classique, pris au hasard de nos pérégrinations, pour un film postérieur à l’époque de Germaine Dulac. Non pas pour verser dans l’illusion rétrospective mais éprouver la fécondité de cette thèse, Germaine Dulac considérant que ce cinéma « pur » serait encore à produire/à-venir, l’éprouver, donc, dans le film Le Sergent Noir de John Ford (1960). L’histoire, tout d’abord, même si elle n’importe jamais pour Germaine Dulac : le sergent Rutledge, soldat noir, est accusé du viol d’une jeune fille blanche et du meurtre de son père. Il est alors jugé en cours martiale. Qui de l’accusation, qui dresse un portrait accablant et raciste du sergent, ou de Mary Beecher, seul témoin à décharge, que le sergent noir aurait prétendument violé plutôt que sauvé, saura convaincre le juge et faire éclater la vérité ? Mais, au fond, peu importe l’histoire comme l’écrit Germaine Dulac, pour quiconque n’aurait pas vu le film, il suffirait de n’en voir que les premières minutes gestatrices pour en percevoir tout l’intérêt, premiers instants qui illustrent la thèse de Germaine Dulac.
A l’instant de sa déposition, lorsque Mary Beecher prend la parole devant la cour, mouvement, « vérité du cinéma » ajouterait encore Germaine Dulac : la pénombre gagne la salle d’audience comme les esprits, car il s’agit de juger de la vie d’un homme comme des souvenirs de chacun pour la garantir ou non, ou comment, sans mots dire, par le jeu de la lumière, le spectateur s’immerge dans les souvenirs de Mary Beecher, monde ni tout à fait vivant, ni tout à fait mort, antre des spectres pour que se déchaîne la vérité. Le plan suivant, précédé de la pénombre de la salle d’audience, monde clos, fermé, replié sur lui-même, s’ouvre pour gagner l’extérieur de nuit, ce qu’il s’agit d’aller quêter, mouvement vers la vérité, qui montre à l’écran un train (après celui des frères Lumière comme d’Abel Gance, le train de Ford, donc) dont les lumières blanches de la locomotive de tête éclairent la voie comme le plan, coupent la nuit en deux : vérité et mensonge, monde du noir sergent comme des blancs. Un train qui n’arrive pas de nulle part dans le cadre, qui le coupe par le bas en venant de la gauche, mouvement qui l’emporte vers sa droite, en s’élevant. De la gauche vers la droite, du bas vers le haut. L’extérieur par l’intérieur, dit Germaine Dulac (p. 109) : la locomotive, tout comme le décor de nuit dans lequel elle effectue sa trajectoire plein cadre, est la transfiguration du témoignage de Mary Bleecher comme de ceux qui viendront à la barre. De nuit, car c’est bien à faire surgir la vérité dont il s’agit, vérité encore prise dans la compacité de l’obscurité des faits comme des témoignages contradictoires qu’il s’agira pour la cour de démêler. La nuit, encore, parce que nous voici au cœur des souvenirs de Mary Bleecheer comme de chacun, dont on sait bien combien la mémoire s’amuse, reconfigurant en permanence les pôles des événements, les retravaillant pour les rendre à ce point antipodes qu’un chat ne reconnaîtrait pas ses petits dans la nuit : ce qui était blanc devient noir, ce qui était noir devient blanc. Un choix de réalisation (Germaine Dulac n’aime pas « metteur en scène », p. 46) pour montrer combien la mémoire est sélective, en faisant arriver le train par la gauche, la gauche incarnant l’imaginaire/la folle du logis, la main gauche, maladroite, maladresse des réminiscences qui font des souvenirs des ressouvenirs, quand la droite du cadre, vers laquelle tend le train, figure la droite raison/la vérité qu’il s’agit d’établir. Vérité pourtant inassignable à un lieu près, le témoin suivant se perdant dans les noms comme les horaires à propos d’une autre scène de crime dont est accusé également le Sergent Noir.
Inatteignable vérité, quête illusoire, illustrées par ce plan du train, précisément par son mouvement, le train allant de la gauche, des souvenirs donc, pour aller vers la droite, les faits, soit la vérité, mais en partant du bas du cadre, pour s’élever. C’est que la vérité doit se gagner de haute lutte, en s’élevant, la vérité ne pouvant être qu’une élévation. Mais élévation contrariée précisément par la vitesse de la locomotive, figurant les si nombreux témoignages à venir, cette logorrhée qui voudrait combler les écarts, des souvenirs à la vérité, qui de la gauche et de la droite du cadre voudraient les cristalliser. Mouvement du train qui, dans son élévation vers cette vérité, coupe dans le même temps le cadre comme il en barre l’horizon : la vérité, et non plus le mensonge, dissimulerait-elle aussi une menterie ? Ne serait-elle pas une fiction de plus ?
Le mouvement de la locomotive, de la gauche vers la droite, du bas du cadre vers le haut, dans un décor de nuit traversé plein phare, illustre combien la vérité à un double problème, jamais formulé ni théorisé par qui que ce soit dans le film, incarné par le mouvement : 1/ la vérité est belle, la vérité est blanche, la vérité est toujours du bon côté, à droite, vers la droite, « Levez la main droite et dites, ‘Je le jure !’ », du côté des blancs contre le si noir sergent. Mais, à tant de blancheur, plutôt que d’éclairer, la vérité finit par aveugler, à prendre chacun dans ses phares (de la locomotive). Vérité inatteignable/inassignable : comment l’établir dans de si grands espaces, la vérité se jouant dans l’immensité des déserts comme d’une gare aussi vide de lieu que de présence humaine, là où se serait déroulé le viol ? Vérité encore intouchable car, pour être aussi belle, aussi lumineuse que les phares de la locomotive, la vérité ne peut gagner sa beauté qu’à s’élever, s’extraire de l’enveloppe de la nuit, car son royaume n’est pas celui des ténèbres mais des cieux, que la locomotive gagne par son mouvement même. Mais à s’élever, la vérité en devient tout autant inattingible. Comment donc la faire éclater Cette sacrée vérité, dira Léo McCarey en 1937, quand ceux missionnés de le faire sont tour à tour mis en accusation, avocat de la défense du sergent noir sommé de témoigner à son tour, femme du juge tout autant, la présupposée victime elle-même s’efforçant de faire jaillir cette vérité quand son témoignage paraît accabler le prévenu ?
On perçoit à l’image combien cette proposition de Germaine Dulac (gagner l’intériorité par l’extériorité) n’est absolument pas accessoire mais essentielle. Et s’il faut rendre cette expérience par les mots, c’est d’abord d’avoir été ressentie qu’elle peut trouver à s’exprimer ensuite, l’extériorité de l’écran s’infusant dans l’intériorité du spectateur. Au cinéma, donc, la narration ne précède pas ce qui est montré, c’est ce qui est montré qui fait narration : mieux, qui est narratif, dans et par sa monstration même. On perçoit tout autant, par l’effet des sensations ressenties, que l’action ne peut pas/ne peut plus être simplement entendue comme dénouement d’une intrigue, mais l’action exprimée par et dans un mouvement. Est atteinte, par le train, la « psychologie de ce mouvement » (Germaine Dulac, p. 167) comme la morale des personnages et du film : Ford ne montre pas un train traversant le cadre, mais une ligne de fuite, un mouvement : la vérité échappant toujours à qui voudra la saisir.

Une mise à l’épreuve des thèses de Germaine Dulac, apportant la preuve de sa fécondité, qui doit sans doute être contrebalancée par la mésestime dans laquelle Germaine Dulac tient cependant à son époque le cinéma parlant (« L’art du cinéma […] ? Lui adjoindre le verbe, c’est le détruire dans son sens le plus profond », ibid., p. 177), qui illustrerait les situations davantage qu’il ne les ferait ressentir au spectateur (Prosper Hillairet, Préface, p. 33).
Un contre-exemple de cette thèse de Germaine Dulac, toujours tiré du Sergent Noir. En effet, tôt dans le film, se pose la question de savoir si la loi est elle-même du côté de la vérité, lorsqu’il s’agit d’établir s’il faut ou non récuser la défense de l’accusé, son avocat qui est aussi son ami ? Or, à l’instant d’en décider, l’un des assesseurs au juge, qui doit l’éclairer en lisant le code juridique des armées, est incapable de prononcer le mot « irrécusable », butant, accrochant sur le terme. « Irrécusable » l’avocat de la défense pour avoir des sympathies pour l’accusé ? Mot qui sitôt prononcé est imprononçable, qui défait la lettre comme l’esprit de la loi, langue incapable de se déplier, c’est-à-dire, dans le vocabulaire de Germaine Dulac, incapable de son mouvement. La parole montre combien l’extérieur, ce qui est extériorisé par la parole dit l’intérieur/l’intériorité des personnages comme il fait le mouvement du film : la vérité comme la loi, pour être atteinte, devrait être claire, accessible, intelligible, autant dire qu’elle ne conviendrait qu’à un peuple de dieux. La loi, son mouvement, comme la vérité, est bien plutôt le produit d’une interprétation sans fin, interprétation circulaire, toujours en mouvement, du cercle duquel chacun des personnages sera incapable de sortir.
Prenons encore un autre contre-exemple issu du cinéma parlant, contemporain celui-ci de Germaine Dulac, à propos d’un cinéaste dont elle dit l’admiration, Charles Chaplin, dans son film Les temps modernes (1936). Ce dernier est précisément le premier film parlant de Chaplin, où le parlant fait irruption dans un film pourtant quasiment muet, par des inserts. Or, le parlant du film illustre la thèse de la théoricienne, par devers-elle cependant, d’atteindre tout ce qui est extérieur dans le film par l’intérieur comme par l’effet du mouvement. Dans Les temps modernes, en effet, seuls les personnages d’autorité ont droit à la parole. Le mouvement en est interdit aux autres, réduit à la mécanique de la reproductibilité de gestes techniques, mouvement incapable de langue, Chaplin libérant la sienne seulement à la fin du film, non pas de n’importe quelle façon : à sa manière ; à la façon de s’inventer dans une langue qui lui soit désormais propre, non plus celle de ceux qui se trouvent dans une position d’autorité, toute forme de discours assujettissant (Chaplin avant Bourdieu le montre cinématographiquement), mais une langue qui ouvre à l’infini des possibles, Chaplin, dans une scène mémorable, ne parlant pas précisément puisque le spectateur découvre pour la première sa voix l’entendant chanter, mouvement qui dit l’affranchissement à l’égard du discours comme celle de son émancipation, cette chanson étant sa chanson, en un effet de libération redoublé, puisque les paroles en sont incompréhensibles, faites d’un curieux esperanto qui entend faire bouger les lignes de la lutte des classes comme de la lutte des places sur lesquelles est construit le récit comme l’espace et le temps dans le film. La parole est ainsi montrée à la fois dans son mouvement circulaire pour les puissants, interrompue comme la ligne de courant pour les dominés, qu’un Chaplin survolté, chantant/dansant, non pas rétabli mais établi en une sorte de geste inaugural, Fiat Lux pour les opprimés. Extérieur par l’intérieur : la parole, dans son mouvement, n’est jamais donnée ab initio ; elle n’est pas innée, elle est conquête permanente. L’avènement du parlant n’est pas l’envers du mouvement au cinéma, il participe aussi de l’expression des sensations dont parle Germaine Dulac (voir, à cet égard, le documentaire diffusé sur Arte, Making Waves : The Art Of Cinematic Sound, 2019).
3/ Après avoir envisagé le rapport de certains mouvements artistiques entre eux contemporains de Germaine Dulac, comme dans leur rapport au monde qu’ils s’efforcent de dire/de lire, il faudrait à présent éprouver cette thèse à partir du seul cinéma comme penser le statut du réalisateur entendu comme « créateur » chez la théoricienne.
Autre thèse, donc, de Germaine Dulac à éprouver : le film doit être l’expression de la singularité de son créateur, thèse qui fera sans doute le lit de la politique des auteurs installée par Truffaut en 1955, à propos du film de Jacques Becker, Ali Baba et les Quarante voleurs, voire par Alexandre Astruc, dès 1948, comparant le réalisateur qui, avec sa « caméra stylo », composerait son œuvre avec la toute-puissance de l’écrivain, ou encore André Bazin défendant Welles, même si l’on ne peut pas encore parler de la mise en place d’une ligne politique nette. Toutefois, sur ce terrain, il faut noter une inflexion dans la pensée de la théoricienne. En effet, les premiers écrits, ceux de 1925 notamment, ne laissent aucune place au doute. A la question posée par un journaliste, lui demandant si l’avenir du cinéma ne se jouerait pas dans une « étroite collaboration entre metteurs en scène et scénaristes », Germaine Dulac répond sans ambages que « l’œuvre cinématographique [doit être] la vision d’un seul être […]. Le metteur en scène doit être scénariste ou le scénariste metteur en scène » (Germaine Dulac, p. 49). Toutefois, la Germaine Dulac tardive consentira à désacoupler scénariste et metteur en scène, envisageant l’auteur, pour la première fois, au pluriel (ibid., p. 275), parlant même d’un travail « en équipe » avec les techniciens, en 1936 (ibid., p. 318), l’année de La belle équipe de Julien Duvivier, mais aussi considérant « la science […], l’effort de ceux des laboratoires » (p. 317).
Dans le cas contraire – d’une œuvre plurielle et non singulière -, et quoi qu’on juge de leur valeur esthétique, comment penser le statut de ces films qui sont allés encore plus loin que ne l’aurait imaginé en 1936 Germaine Dulac, de ces films devenus sans doute dans la langue vernaculaire du cinéma des « classiques », qui pourtant ne sont pas l’œuvre d’un réalisateur mais de plusieurs, tour à tour prenant le relais des uns comme des autres, l’époque des grands studios hollywoodiens étant reine en ce domaine, et pour ne citer que les plus célèbres, du vivant de Germaine Dulac, en 1939, Le magicien d’Oz (Victor Fleming, King Vidor, George Cukor) ou encore Autant en emporte le vent (Victor Fleming, toujours en spécialiste de la remontada, terminant le film à la suite de George Cukor et Sam Wood) ? Comment, dès lors, considérer la place de ceux ayant œuvré dans l’ombre comme à la manœuvre, sauf à dire que le cinéma puisse s’écrire aussi de façon réticulaire/tentaculaire ?
Dans la même veine, comment considérer ces films passant, de projet en projet, entre les mains de réalisateurs différents, pour exemple, de façon non plus contemporaine à Germaine Dulac, le jeu de passe-passe entre Eastwood et Spielberg ? Qu’aurait été Sur la route de Madison, sans doute le chef-d’œuvre de Eastwood pour un film qui ne sera pourtant pas tant celui d’un second couteau que le fruit d’une collaboration, Spielberg devant en être au départ du projet le réalisateur en 1993 (mais déjà tellement pris à la même époque par Jurassic Park et La liste de Schindler). Idem pour Flags Of Our Fathers (2006), que Eastwood tournera pour le studio Dreamworks de Spielberg, mais aussi, plus tard, en 2013, pour American Sniper, que Spielberg délaissera pour n’avoir pas le budget adéquat afin de réaliser le film qu’il souhaitait, permettant à Eastwood de le récupérer, œuvre de seconde main, mais pour en faire une œuvre toute personnelle, Eastwood de conter encore l’Amérique qui se fait, se réappropriant ses mythes. Le cas Richard Jewell sera tout autant repris par Eastwood, mais des mains de Paul Greengrass cette fois-ci. Ces films, pour n’avoir pas été pensé dès le départ par leur « auteur », ne seraient-ils pourtant pas personnels, au sens dulacien de singulier ?
Un film doit-il, en effet, être nécessairement l’œuvre d’un créateur, en en maîtrisant l’écriture, du scénario à la réalisation ? Que penser, dès lors, toujours de l’œuvre de Clint Eastwood, qui n’a jamais écrit le moindre scénario, déléguant cette tâche à d’autres, transposant à l’écran des « histoires », en en reconquérant la narration de façon personnelle ? Que signifie encore, au regard des thèses de Germaine Dulac, l’idée selon laquelle le public serait à la commande de la logique économique, et non l’inverse, contraignant le cinéma à un univers formaté ? Sans doute la marvelisation en guise de merveillisation en cours à Hollywood donnerait-elle raison à la théoricienne, comme celle de la victoire d’un cinéma narratif. Faudrait-il réduire pour autant le cinéma à un effet de loupe ? Oublier comment, à l’époque des grands studios, des cinéastes, dans des genres très codifiés, vont pratiquer la technique du cheval de Troie, y insérant non pas des pastilles personnelles mais charriant tout leur univers (voir Un voyage avec Martin Scorsese à travers le cinéma américain, III. Le cinéaste-contrebandier) ? François Truffaut ne disait-il pas autre chose en 1953, dans son article aux Cahiers « Aimer Fritz Lang », consacré à The Big Heat (Règlement de comptes) : « Tout ceci ne donne-t-il pas à penser que Fritz Lang pourrait être un véritable auteur de films, et que si ses thèmes, son histoire empruntent, pour venir jusqu’à nous, l’apparence banale d’un thriller de série, d’un film de genre ou de western, il faut peut-être voir là le signe d’une grande probité d’un cinéma qui n’éprouve pas la nécessité de se parer d’étiquettes alléchantes ? Il faut aimer Fritz Lang. » Alexandre Astruc ne le signifiait-il pas autant, à propos de Hitchcock, dans un numéro spécial des Cahiers : « Quand un homme depuis trente ans, et à travers cinquante films, raconte à peu près toujours la même histoire : celle d’une âme aux prises avec le mal , et maintient, le long de cette ligne unique, le même style fait essentiellement d’une façon exemplaire de dépouiller les personnages et de les plonger dans l’univers abstrait de leurs passions, il me paraît difficile de ne pas admettre que l’on se trouve, pour une fois, en face de ce qu'il y a après tout de plus rare dans cette industrie : un auteur de films. »
Ce cinéma aurait-il tout à fait disparu ? Comment expliquer, par exemple, et toujours pour raisonner à partir du cas Eastwood, que les studios aient accepté de financer un projet aussi improbable que celui de Impitoyable, l’histoire d’un cow-boy sadique, repenti, tueur d’enfant, film qui déconstruit jusqu’à l’idée même de western, œuvre à ce point crépusculaire, en 1992, à une époque, pourtant, du revival du western après le succès de Danse avec les loups (1991), si crépusculaire qu’elle en fera tomber de cheval Clint le superbe lui-même comme déjà Pike Bishop (William Holden), dans La horde sauvage (1969) de Sam Peckinpah s’efforçait péniblement au trajet inverse, simplement se mettre en selle ? Une exception, peut-être. Mais Germaine Dulac elle-même, s’essayant aux statistiques dans ses analyses critiques (peu de films, selon elle, méritant chaque année l’attention comme le respect), ne réduit-elle pas ce faisant déjà le cinéma qu’elle appelle de ses vœux au statut d’exception : pour espérer voir surgir un Clint Eastwood, ne faut-il pas comparativement des centaines de tâcherons pour simplement l’accueillir l’apercevant ?
Pour prendre encore un exemple récent de la difficulté à saisir ce que peut bien être « l’auteur » d’une somme cinématographique, celui dont chacun s’accorde pourtant à considérer qu’il possède un univers comme il fait œuvre, le cas Paul Thomas Anderson, dans Phantom Thread (2017), l’histoire de ce styliste-couturier dans le Londres des années 50 étant une métonymie de l’intimité de PTA. Mais une intimité retranscrite extérieurement de façon complexe puisque, de l’aveu du réalisateur, le film serait tenu par plusieurs fils difficiles pour ne pas dire impossible à démêler, ceux de PTA sans doute tout autant que de son acteur principal, Daniel Day-Lewis, composant un bien singulier autoportrait cinématographique à quatre mains.
Comment penser, également, le statut de ces films de commande, qui n’en feront pas moins œuvre, films de commande qui intiment pourtant l’ordre au cinéaste d’opérer sous contrainte, qui n’interdirait pas cependant de les ouvrir, depuis l’intérieur, à l’univers personnel d’un cinéaste ? En tête, reviennent, sans distinction ni hiérarchie, puisant dans nos propres souvenirs, par exemple, Peggy Sue s’est mariée, en 1986 et, un an plus tard, Jardins de pierre, films de commande pour Francis Ford Coppola, ou comment un cinéaste s’accapare intimement ce qui est a priori impersonnel ? Dans le premier, Peggy Sue (Kathleen Turner qui, après la question de son remariage qui se pose dans ce film, se retrouvera plus tard chez Sofia Coppola en mère des soeurs Lisbon, dans Virgin Suicides, en 1999), Peggy Sue, donc, par l’effet d’un choc, se retrouve vingt-cinq ans plus tôt, dans son passé, avec possibilité de rejouer son destin, qui choisira pourtant de ne pas dévier de son cours comme de ses choix, décidera de se remarier avec le même mauvais type, dans cette comédie aux accents de remariage (comédies que l’on trouve de façon essentielle chez Hawks, avec La dame du vendredi, en 1940 ou encore classiquement avec New York-Miami de Capra, en 1934), comédie dans laquelle Peggy Sue décide de ne jamais réparer ses erreurs, ne cherchant pas à se construire un futur meilleur, le film de commande devenant intime : Coppola lui-même, traversant plusieurs échecs (commerciaux) dans son cinéma à travers son studio, American Zoetrope, signifiant combien par ce geste cinématographique il continuera de bégayer son cinéma, combien il l’assumera au risque de la banqueroute et du désaveu public, ce qu’il confiera encore récemment dans un entretien donné à Marcos Uzal pour les Cahiers ; combien Francis Ford Coppola souhaitera toujours expérimenter, persévérer dans une forme d’art qui lui est propre, au sens où nul ne pourrait lui imposer un genre, y compris dans un film de commande, Coppola désirant encore aujourd’hui réaliser un très vieux projet, Megalopolis.
Dans le même temps, l’exemple de Coppola permet de revenir sur une autre sentence de Germaine Dulac, que le film, une fois terminé, serait abouti (œuvre de « création », dit-elle), Coppola, comme par exemple Michael Mann, à l’occasion de la ressortie de certains de leurs films, ne cessant pas de remettre sur le chantier leur cinéma, remontant leurs films, d’Apocalypse Now, dont on ne compte plus les versions (ressorti récemment), mais aussi Le Parrain III (ressorti à la fin de l’année dernière), comme Conversation secrète ou encore Dracula. Retoucher un film, la Germaine Dulac tardive ne s’y oppose pourtant plus, parlant de cette possibilité offerte au théâtre, interdite au cinéma en raison des droits d’auteur sur le film (Germaine Dulac, p. 275). Mais une reprise qui, chez Coppola, devrait servir à la grande œuvre, l’objectif étant de gagner suffisamment d’argent pour ce projet tout personnel, Megalopolis.
Reprenons, donc. Un film, aussi abouti soit-il, au sens d’unique pour Germaine Dulac, comme le peut être sans doute Apocalypse Now, peut faire l’objet d’un remontage, dans un but économique (cette logique économique critiquée par Germaine Dulac, du moins qu’il faudrait inverser), afin de développer un projet éminemment personnel, où comment l’économie devrait permettre l’avènement d’une œuvre cinématographique. Cette même logique économique qui avait conduit Coppola à faire pour des raisons financières Le Parrain III, lorsque son studio était en faillite. Ces remontages montrent encore que le film n’est jamais tout à fait terminé, qu’il ne peut pas être simplement le fruit d’un acte de création au sens de réalisé, parfait. Que le film est le produit d’une impureté comme la réponse, pour un réalisateur, souvent, à une somme de contraintes techniques (l’irruption du parlant, que l’on reverra avec plaisir et dans ses travers, filmé par Stanley Donen et Gene Kelly, film aussi produit d’une double collaboration comme dans Chantons sous la pluie, en 1952, mais aussi la couleur dans d’autres films comme les possibilités offertes par les caméras, la pellicule, le numérique...), carcan financier aussi, autant de contraintes qui se posent à lui en manière de défi dans son cinéma, qui ne serait donc pas nécessairement et simplement, dans le meilleur des cas, la transposition d’un univers personnel quand Germaine Dulac appelle de ses vœux à un « cinéma pur ». Le cinéma comme somme de contraintes techniques qui expliquerait en retour l’hostilité de certains cinéastes tels que John Ford, Hitchcok/De Palma (même si l’on ne saurait réduire le cinéma de De Palma à l’hommage, bien au contraire), Michael Mann encore… de parler de leur univers, surtout de manière théorique.
Cette problématique, on la retrouve encore, en 1987, dans un autre film de Coppola père, Jardins de pierre, film de commande sur la guerre du Vietnam, anti-Apocalypse Now, durant la projection duquel le spectateur ne verra jamais la moindre image de combat sur le théâtre des opérations militaires. Fait notable à une époque où, tourné douze ans après la chute à Saïgon de l’armée américaine, se rejoue fictionnellement à l’écran la guerre perdue, Rambo II triomphant dans les salles (en 1985), comme L’enfer du devoir avec Gene Hackman, la même année que le film de Coppola, mais aussi Portés disparus, déjà, en 1984, avec l’inénarrable Chuck Norris. Jardins de Pierre, film de commande, n’en devient pas moins intimiste sous Coppola, classique dans sa facture, à rebours des effets du Parrain III. Ce film de commande sur la guerre montre que la guerre n’aura pas lieu, qu’elle n’a peut-être jamais eu lieu, une guerre incompréhensible pour les américains : sur quel front la guerre du Vietnam, elle qui les multiplie sur tous les territoires en pleine période de guerre froide ? Quel ennemi, lui qui est sans cesse caché dans la forêt, qui procède par attentats, guerre qui défait l’idée de guerre. Une guerre doublement perdue pour les États-Unis, et sur le terrain et dans les esprits, nul américain ne sachant pourquoi cette guerre a été perdue à l’époque de l’Amérique triomphante.
De l’Amérique il faut peut-être revenir à présent, repartant pour le continent, sur le territoire de Germaine Dulac, afin, pourquoi pas, au regard des thèses de Germaine Dulac, de considérer la trajectoire d’un cinéaste comme Claude Sautet, sur le plan de son rapport à la musique (art que la théoricienne entend démarquer du cinéma), comme sur le statut de ce que peut être encore un réalisateur, s’il fallait lire cette trajectoire dans la grammaire dulacienne, parlant de l’expression des « sensations » dans un art qu’il s’agirait de transcrire dans le langage-cinéma, « sensations » qui expriment autant le cinéma de Sautet, qui ne filmait pas des histoires mais des sentiments ? Comment ressaisir, en effet, le cinéma de ce passionné de musique baroque et de jazz, cinéaste se définissant précisément à partir du vocabulaire de la théoricienne, comme « cinéaste compositeur » plutôt qu’auteur-réalisateur, mais pour signifier tout ce que son cinéma emprunte à la musique, le mouvement de la liberté (le jazz) dans un cadre contraint et formaté (la musique classique), comment se construire dans un espace – un pays, une famille, un couple, des amis – qui oriente autant qu’il balise les destins ? Comment, donc, la musique dans le film fait la petite musique de chacun, Germaine Dulac qui cite pourtant volontiers Debussy (Germaine Dulac, p. 109) ? Le cinéma, dirait sans doute Claude Sautet, dans le vocabulaire de Germaine Dulac, est « Rythme » (au sens où «on fait entrer les mouvements en des rythmes », (Prosper Hillairet, Préface, p. 30), Sautet qui, comme Germaine Dulac aspirerait à ce « film intégral, […] une symphonie visuelle faite d’images rythmées [...] » (cité p. 31 par Prosper Hillairet, Préface, mais aussi Germaine Dulac, pp. 90-91, 96), un cinéma qui soit la « musique des yeux » (ibid., p.162), Sautet qui écrit, en effet, un film comme le musicien compose, mais à la manière du musicien, qui dit sa dette à l’égard de la musique quand Germaine Dulac souhaite en tirer le cinéma : « Ma façon de concevoir le cinéma comme mes films, c’est lié à la structure musicale. La structure musicale est une construction exacte, dans laquelle les voix sont comptées, les temps sont placés. La musique est exacte ! » (in Claude Sautet, Le calme et la dissonance). Comment penser encore le statut de réalisateur quand Claude Sautet, après l’échec de ses deux premiers films (Classe tous risques, 1960, L’arme à gauche, 1965), se consacrant uniquement à l’écriture et à la réparation des scenarios des autres, devient leur « ressemeleur » selon l’expression de François Truffaut, compositeur travaillant pour les meilleurs : Georges (Franju), Alain (Cavalier), Philippe (de Broca), comment penser finalement le statut de ce cinéaste qui deviendra le cinéaste de ces autres, Vincent, François, Paul et tous les autres en 1974 ? Cinéaste de tous les autres, d’abord avec les autres, Jean-Loup Dabadie, en tant que scénariste, lui permettant de reprendre carrière pour son troisième film, Les choses de la vie (1970), écrit ensemble, à la manière d’une composition musicale, un cinéma de chef d’orchestre multiple, auquel il faudrait ajouter la femme de Claude Sautet, présente à chaque instant, conseillère sur les tournages, dont il faudrait ajouter le nom au générique des films, Claude Sautet cinéaste de tous les autres pour se dire finalement soi, de l’extérieur vers l’intérieur, terminant sa carrière par le triptyque, Quelques jours avec moi (1988), Un cœur en hiver (1992), Nelly et Monsieur Arnaud (1995), pour ne plus finalement parler que de lui.
Que dire encore, pour le signifier trop rapidement, de l’œuvre d’Agnès Varda, « protéiforme », dit le critique Serge Kaganski, mêlant sans doute le très long au très court format, tout autant la fiction au documentaire comme l’autoportrait, mais aussi et surtout, pour ce qui nous intéresse, la photographie au cinéma, la photographie qui « rentre dans mes films », dit la cinéaste, comme dans Visages, villages (réalisé avec JR, en 2017), Agnès Varda qui n’a pas oublié qu’elle a été aussi photographe à l’instar de Germaine Dulac. Pourquoi donc, dès lors, « se donner une case »/une cause, le monde, que veut pourtant rendre dans son mouvement la théoricienne Germaine Dulac, « n’ayant pas de cases », Agnès Varda, entre les films, pour nourrir les films, écrivant, photographiant, faisant des installations (Leçon de cinéma avec Agnès Varda) : une artiste « totale » pour un « cinéma total », comme Germaine Dulac s’est essayée, aussi, pratiquement à tous les arts, y compris la photographie (ibid., p.73) ? Si tout est mouvement, pourquoi en effet le barrer dans sa forme d’expression, la vie étant ouverte à l’accidentel ? Que dire alors du cinéma d’un contemporain d’Agnès Varda, Chris Marker, un cinéma qualifié par André Bazin de « film-essai », qui insère des commentaires dans ses documentaires, idée sono-visuelle que reprendra Agnès Varda, Chris Marker d’abord écrivain, cinéaste, photographe aussi, cinéaste avant-gardiste, sans doute, dont son plus célèbre film ferait pourtant machine arrière à bien suivre Germaine Dulac, La Jetée, en 1962, étant composé comme un roman photo, à partir d’images fixes ?
Après la musique et la photographie, que dire, cette fois-ci, de la théâtralisation de l’intime comme du monde chez des cinéastes comme Wes Anderson et Charlie Kaufman aujourd’hui? Un cinéma impur ? Un non-cinéma ?
Idem pour la littérature, du continent à l’Amérique, de l’Amérique au continent, que penser en effet de Melville, qui se définit comme auteur, au sens de Germaine Dulac, qui entend imprimer sa marque, non pas faire des films réalistes, mais des rêveries de la réalité, mais dans un cinéma jamais fait à partir d’un scénario, que Melville n’écrit jamais malgré sa volonté de maîtrise, transposant le plus souvent au cinéma une œuvre littéraire, mouvement d’emprunt hostile à Germaine Dulac, ce par quoi il débute avec Le silence de la mer (1949) de Vercors ?
De la même façon, pour demeurer en territoire melvillien, pourtant si dépeuplé, que penser d’un cinéaste qui considère, non pas comme Brassens pour qui, lorsqu’on est plus de deux, « on est une bande de cons », mais qu’à deux, les problèmes (au sens des trahisons) surgissent aussitôt, d’un cinéaste qui ne croit qu’à la solitude, filmant des zombies comme les silences qu’appellent de ses vœux la théoricienne (Germaine Dulac, p. 196), étirant les situations, privilégiant le silence à la parole (le si peu bavard Samouraï Jeff Costello/Delon, en 1967), mais qui pourtant passait un temps tout aussi étiré jusqu’à provoquer la folie de ses acteurs en post-synchronisation, les faisant répéter jusqu’à ce qu’il obtienne le « bon ton » ? Le dialogue, le parlant chez Melville, dans un univers fait de silence, fait autant partie de la bande-son, quand Germaine Dulac les distingue (parlant et son, p. 196 : « je suis pour le film sonore »), comme la musique et les bruitages. Melville est en effet obsédé par le rythme de ses acteurs, leur mouvement qu’il appelait lui-même « le rythme Melville », de sorte qu’à écouter le rythme Lautner, le rythme Verneuil, de la même époque, il apparaît que ce rythme n’est pas en partage, chacun n’ayant ni le même rythme ni la même langue ni la même tessiture, Melville doublant encore lui-même certains de ses personnages en post-synchronisation. Rien d’autre de ce que pourrait dire Germaine Dulac, car n’écrit-elle pas : « Ce n’est donc pas […] le jeu de l’artiste qui crée l’émotion, mais le point même où ce jeu est placé […]. C’est le compositeur du film qui doit vouloir cette harmonie, la placer et créer son rythme » (ibid., p. 226) ? La voix n’y participerait-elle donc pas ?
Melville qui utilise encore sa propre voix en voix off au début de certains de ses films, (Bob le flambeur, en 1955, s’ouvrant sur « Des gens vont se croiser dont les destins resteront étrangers ») ou celle de ses acteurs, Delon, en 1972, au début d’Un flic, Belmondo, déjà en 1963, pour L’aîné des Ferchaux, Lino Ventura décrivant Simone Signoret au début de L’Armée des ombres, en 1969, voix-off qui dit leur solitude, le parlant déparlant la langue de ceux qui l’utilisent. Que dire encore, non pas simplement de l’utilisation de la musique, mais de voir les acteurs de Melville s’accorder au rythme musical du film, jouant du piano (Belmondo, en 1961, dans Léon Morin prêtre; Delon, dans Un flic, dans une scène avec Catherine Deneuve ; un soldat allemand jouant du Bach à l’harmonium, dans Le silence de la mer), consoner tout autant avec la musique des Juke-Box, Sinatra dans la tête, Belmondo jouant du poing contre un soldat de l’armée US, en 1955, dans Deux hommes dans Manhattan ; mais aussi s’apparier avec cette musique des night-clubs, que Melville préférait à Bach, Brahms, Chopin (« dégueulasse », dit-il), Delon, dans Le samouraï, toujours Delon, avec cette danse africaine, mouvement de l’envoûtement qui dit le mort-vivant, en 1970 dans Le cercle rouge, la musique encore et toujours, que plus personne n’écoute, dans ce bar new-yorkais After Hours, où, fatigué, s’arrête un homme, un orchestre qui continue de jouer même si plus personne n’écoute, comme si du rythme du monde, de son mouvement, ne restait plus que sa musique. Germaine Dulac dirait sans doute, mais il faudrait y ajouter le parlant contre la théoricienne : le cinéaste, homme orchestre de la vie, composant la somme de ses silences.
Conclusion
Un cinéma « pur » ? Plutôt, le cinéma endure en permanence le risque de sa ruine (le parlant, la logique économique, le public). Il y a un nerf brisé en lui ; un sanglot rendu. Sa seule royauté, dit Germaine Dulac : le domaine du mouvant, le devenir, le « continu et créateur », écrit-elle (Germaine Dulac, p. 155). Son étoffe n’est donc pas faite des songes théoriques : mais d’un réel rêvé, réel non pas des faits mais des émotions, des sensations, cinéma de l’expression contre la narration. Le cinéma, dès lors, le vrai cinéma, consiste donc bien à tenir la route du naufrage, tel celui qui boite a en partage la claudication du monde. Tenir la route malgré les embûches. S’ouvre ainsi et roule dans le cinéma une tempête permanente, avec l’inquiétude du monde, où une respiration se réserve (de la salle de cinéma jusque chez soi face à son écran, toujours dans l’intériorité de chacun).
Il y a finalement du Bergson la-dessous, Germaine Dulac parlant de la « Matière-vie » sur laquelle opère le cinéma (ibid., p. 237), Bergson qui a déjà écrit Matière et mémoire, en 1896 et L’évolution créatrice, en 1907. Bergson, qui croit à l’expérimentation de chaque instant, lui le penseur du mouvant comme du sensible. On a toujours beau se représenter, dit Bergson, le détail de ce qui va nous arriver, combien cette représentation est pauvre, abstraite schématiquement, en comparaison de l’événement qui, effectivement, se produit : « la réalisation apporte avec elle un imprévisible rien qui change tout ». Bergson donne ainsi l’exemple d’une réunion à laquelle il doit se rendre : « je sais quelle personne j’y trouverai, autour de quelle table, dans quel ordre, pour la discussion de quel problème. Mais qu’elle vienne s’asseoir et cause comme je m’y attendais, qu’elle dise ce que je pensais bien qu’elle dirait, l’ensemble me donne une impression unique et neuve comme s’il était maintenant dessiné d’un seul trait original par une main d’artiste. Adieu l’image que je m’en étais faite, simple juxtaposition figurable par avance de choses déjà connues. Je veux bien que le tableau n’ait pas la valeur d’un Rembrandt et d’un Velázquez. Il est tout aussi inattendu et, en ce sens, aussi original ». Ce que décrit Bergson dans cet épisode de la réunion est une expérience cruciale que l’on peut attendre du cinéma : l’idée selon laquelle on a beau s’attendre à quelque chose de nouveau n’en ôte pas moins la surprise de son surgissement, mais en même temps l’idée paradoxale qui détache la surprise de l’arrivée de quelque chose ou de la valeur d’inattendue que contient la chose qui arrive ; qui débarrasse la surprise de l’imprévu. Au fond, pour faire de la surprise le langage de l’expérience que nous faisons de quelque chose qu’on ne peut prévoir, cette idée décline une vérité profonde d’où l’on peut décliner toute la pensée de Bergson. Il s’agit de convertir ce qui relève de l’imagination, de tout ce que l’Homme projette comme désir sur le monde, en ce qui relève de la sensibilité, qui rejoint les préoccupations de Germaine Dulac : qui fait lien avec l’idée de « mouvement » qui s’esquisse dans l’action au cinéma, où il faut du reste accoutumer son esprit à une conception plus « dynamique » que « statique » (Germaine Dulac, p. 125) de ce dont il s’agit de rendre compte, qui implique qu’à chaque instant l’accession à du nouveau, à de l’inédit, soit notre plus prochaine possibilité.
Le point de référence du cinéma ne peut donc pas être le stable, ou sa visée dans la quête d’une « identité », mais le « mouvant » de l’intériorité des individus tel qu’implanté en son vécu comme de l’extériorité de l’action en prise avec son économie vivante, qui est un « devenir ». Le cinéma n’a dès lors pas d’« essence », comme le dit Germaine Dulac, sauf à dire qu’à n’en pas avoir il en aurait une, ce cinéma dont il peut être dit à la fois, sans que cela soit pour autant contradictoire, que « c’est la Vérité 24 fois par seconde » (Godard, dont serait proche, sur ce point, Germaine Dulac, parlant des « images faites de vérité », p. 239, 243), mais tout autant « 24 mensonges par seconde » (Brian De Palma). En friction permanente, le cinéma est placé sous tension, traversé comme il traverse les choses, ne fixe rien : une tendance, écartelé entre des orientations contraires et variées, tendance du mouvement, la vie dans son rythme, en somme. Le cinéma, à s’inscrire nécessairement dans le mouvement qu’appelle la théoricienne, choisit d’habiter alors dans cette région imprenable, dans le royaume du faux bond. Le cinéma, dans cet effort, filme en effet depuis toujours le mouvement d’une balle envoyée un jour en l’air par l’enfant Dylan Thomas le poète, dans un parc, cet enfant qui dit : « la balle que j’ai lancée dans le parc n’a pas encore touchée le sol », balle imprenable jamais retombée, qui ne retombera pas sauf à ne plus rêver, mouvement que le cinéma rend pour sa part afin que, peut-être, la mort n’ait jamais d’empire.
